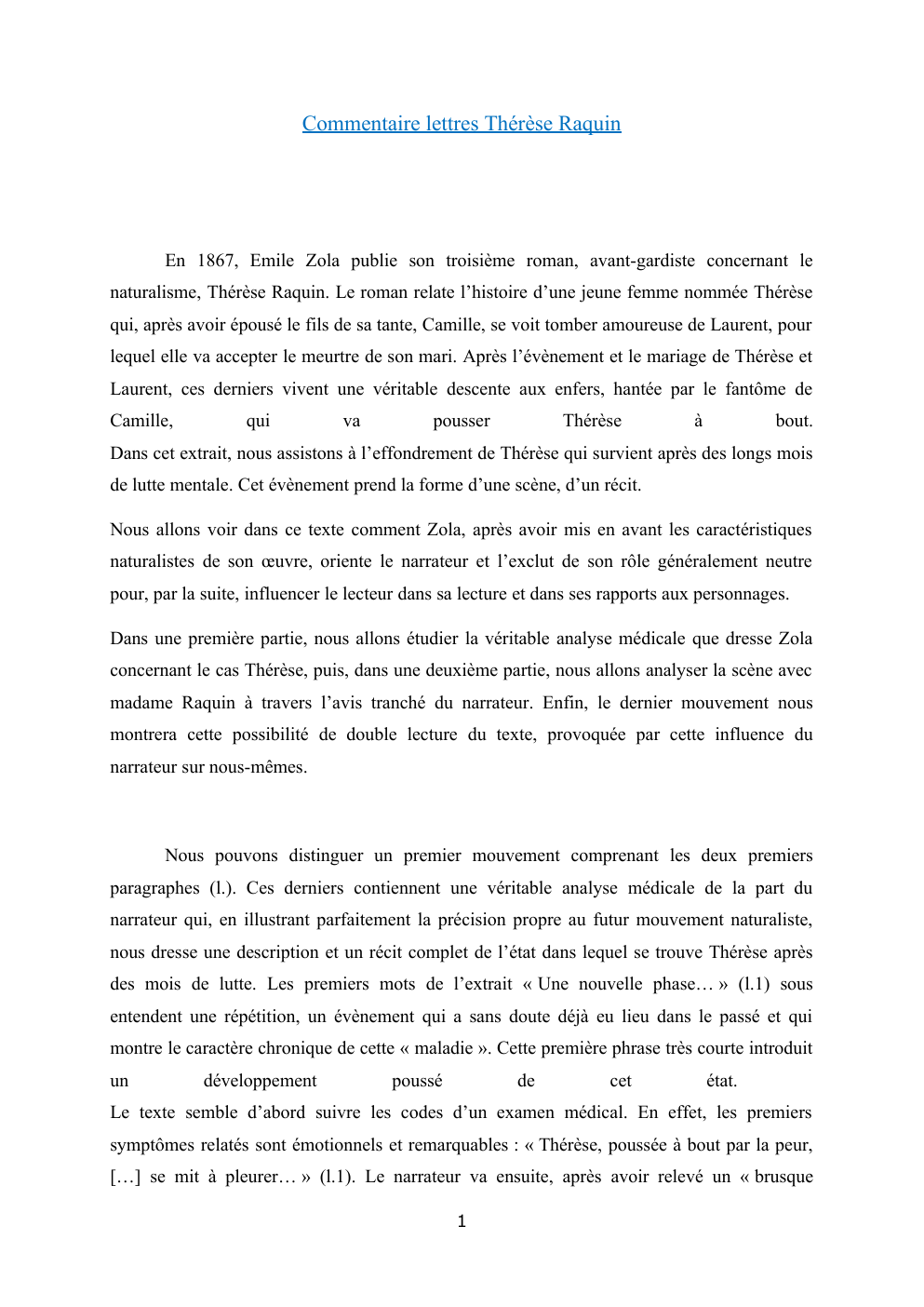Commentaire Thérèse Raquin
Publié le 09/04/2023
Extrait du document
«
Commentaire lettres Thérèse Raquin
En 1867, Emile Zola publie son troisième roman, avant-gardiste concernant le
naturalisme, Thérèse Raquin.
Le roman relate l’histoire d’une jeune femme nommée Thérèse
qui, après avoir épousé le fils de sa tante, Camille, se voit tomber amoureuse de Laurent, pour
lequel elle va accepter le meurtre de son mari.
Après l’évènement et le mariage de Thérèse et
Laurent, ces derniers vivent une véritable descente aux enfers, hantée par le fantôme de
Camille,
qui
va
pousser
Thérèse
à
bout.
Dans cet extrait, nous assistons à l’effondrement de Thérèse qui survient après des longs mois
de lutte mentale.
Cet évènement prend la forme d’une scène, d’un récit.
Nous allons voir dans ce texte comment Zola, après avoir mis en avant les caractéristiques
naturalistes de son œuvre, oriente le narrateur et l’exclut de son rôle généralement neutre
pour, par la suite, influencer le lecteur dans sa lecture et dans ses rapports aux personnages.
Dans une première partie, nous allons étudier la véritable analyse médicale que dresse Zola
concernant le cas Thérèse, puis, dans une deuxième partie, nous allons analyser la scène avec
madame Raquin à travers l’avis tranché du narrateur.
Enfin, le dernier mouvement nous
montrera cette possibilité de double lecture du texte, provoquée par cette influence du
narrateur sur nous-mêmes.
Nous pouvons distinguer un premier mouvement comprenant les deux premiers
paragraphes (l.).
Ces derniers contiennent une véritable analyse médicale de la part du
narrateur qui, en illustrant parfaitement la précision propre au futur mouvement naturaliste,
nous dresse une description et un récit complet de l’état dans lequel se trouve Thérèse après
des mois de lutte.
Les premiers mots de l’extrait « Une nouvelle phase… » (l.1) sous
entendent une répétition, un évènement qui a sans doute déjà eu lieu dans le passé et qui
montre le caractère chronique de cette « maladie ».
Cette première phrase très courte introduit
un
développement
poussé
de
cet
état.
Le texte semble d’abord suivre les codes d’un examen médical.
En effet, les premiers
symptômes relatés sont émotionnels et remarquables : « Thérèse, poussée à bout par la peur,
[…] se mit à pleurer… » (l.1).
Le narrateur va ensuite, après avoir relevé un « brusque
1
affaiblissement en elle » (3), recontextualiser la situation de la victime en citant le
tempérament initial, si cher à Zola dans cet ouvrage, de Thérèse.
Sa « nature sèche et
violente » (l.3), provenant de son origine algérienne, équivaut à son tempérament sanguin et
nerveux décrit précédemment par Zola, on trouve d’ailleurs le terme « nerveux » à plusieurs
reprises dans l’extrait (l.3 et 6).
De plus, les premières phrases du deuxième paragraphe sont
très courtes, brusques, tout comme le « brusque affaissement en elle »(3).
Ces courtes phrases
(l.3 à 5), jalonnées de points, montrent le caractère de panique et rapide de l’effondrement de
Thérèse.
Zola dresse ensuite un diagnostic pour lequel il utilise le passé simple.
Dans ce paragraphe, Zola analyse les problèmes physiques et psychiques de Thérèse.
Les
troubles physiques sont exposés à travers la présence d’un vocabulaire montrant une
déficience corporelle.
On peut citer : « les nerfs tendus se brisèrent »(3) ; « toute son énergie
nerveuse » (l.6) ; « plus la force de se roidir, de se tenir […] debout »(10) ou encore « à se
sentir molle et brisée » (l.18).
Outre cette souffrance physique, la douleur mentale est
omniprésente dans ce premier mouvement.
On retrouve d’abord une flottée de termes
renvoyant à la tristesse, la mélancolie et suscitant même une certaine pitié du lecteur :
« pleurs »(13) ; « irritée »(7), « souffrances » (l.7) ; « les larmes et le regret »(11).
Tous ces
termes montrent à quel point une douleur pourtant originellement mentale peut provoquer des
troubles physiques.
De surcroît, ce craquage psychologique est l’œuvre d’une accumulation
de souffrance pendant de longs mois.
Cette accumulation est représentée dans le texte par un
emploi récurrent d’adjectif associés à la souffrance : « …lorsqu’elle ait vécu pendant
plusieurs mois sourdement irritée, révoltée contre ses souffrances, […] elle éprouva tout d’un
coup une telle lassitude qu’elle plia et fut vaincue.
» (6).
L’accumulation silencieuse de la
souffrance a fini par exploser et atteindre sa chute brutale (« tout d’un coup »).
Nous savons
que Zola à cette volonté de rendre compte de phénomènes médicaux et comportementaux.
Et
le fait que l’un influence l’autre semble montrer son désir de prévenir, d’avertir les lecteurs.
Ces deux domaines, le corps et l’esprit, se « rassemble » à la fin du paragraphe, à travers le
« plaisir physique à s’abandonner » (l.18) que ressent Thérèse.
Cet état illustre le besoin
d’aide envers Thérèse qui envisage de mettre fin à ces jours.
Nous pouvons d’ailleurs
retrouver cette sorte de dualité dans l’emploi de deux adjectifs ou noms côte à côte : « sèche
et violente »(3), « de chair et d’esprit »(12), « molle et brisée »(18) ou « nécessaire et
fatale »(5).
Ces derniers termes appuient le côté tragique du récit ou le narrateur semble
prévoir la fin du récit avec cette notion de fatalité.
C’est donc à travers une focalisation
2
interne, du point de vue de Thérèse, que Zola nous transmet toutes les émotions qu’elle
ressent.
Après cette analyse médicale du narrateur qui n’omet que très peu de détails, Thérèse
semble mener de véritables combats lors de ce récit.
Le premier est personnel dans lequel
l’expression « se battre contre la maladie » prendrait tout son sens.
En effet, on trouve d’abord
un vocabulaire relevant du combat : « brisèrent » (3) ; « vaincue » (9) ; « céderait » (13) ;
« résistance » (19) ou encore « frappa » (16).
En outre, de nombreux verbes de mouvements
peuvent être relevés, référence aux gestes que l’on peut faire lors d’un duel.
Nous pouvons
citer les termes « revinrent » (5), « se tenir » (10), « plia » (9), « se jeta » (10).
On peut
également distinguer un combat parallèle avec un véritable adversaire, représenté par Camille.
Thérèse semble à un moment parler à travers le narrateur, qui use donc d’un discours indirect
libre dans la phrase : « Peut-être le noyé qui n’avait pas cédé devant ses irritations, cèderait-il
devant ses pleurs.
» (12).
On remarque une femme déjà perdue à travers : « peut-être » et
« cèderait-il ».
Mais surtout, la façon dont Thérèse nomme son ancien mari en dit long.
On a
l’impression qu’elle ne veut plus prononcer son prénom, en étant appelé « le noyé », Camille
est donc représenté à travers sa mort, il y a que cela qui semble être resté dans les mémoires.
Camille est d’ailleurs présent dans ce récit et mentionné sous forme de spectre, en référence
aux hallucinations des deux époux.
Camille, malgré son allure représente, à travers sa volonté
de
vengeance,
une
menace
pour
Thérèse
et
mène
un
véritable
combat.
Cependant, ces combats semblent être des échecs, elle se dénature et « sa nature
violente et sèche s’amollit ».
Ces luttes ont pris le dessus sur la jeune femme qui semble en
plus être la cible d’une ironie de Zola.
Ce dernier, au milieu de ce récit fort, semble critiqué la
démarche de Thérèse en la rapprochant à « certaines dévotes qui pensent tromper Dieu (15).
A travers les termes « pensent tromper », « arracher » et « prenant », Zola qualifie cette
démarche d’espérer un pardon après avoir péché à plusieurs reprises comme une tromperie,
une analogie peut être faite avec la tromperie de Thérèse envers Camille.
Cette ironie
stendhalienne qui se déplace et vise, et le personnage, et la société, traduit une sorte de
désolidarisation de la part du narrateur envers Thérèse, il semble ne pas avoir la volonté que
l’on s’identifie au désespoir de Thérèse.
Le deuxième mouvement met en scène la tante de Thérèse, Madame Raquin, paralysée
et réduite à sa paire d’yeux.
Dans ce paragraphe, le narrateur semble en vouloir à Thérèse et le
fait comprendre à travers un vocabulaire fort, parfois hyperbolique.
Il délégitimise le
3
désespoir de Thérèse.
Les premières phrases du paragraphe semble avoir pour objectif
d’éviter que l’on éprouve quoique ce soit de positifs envers Thérèse.
« Elle accabla madame
Raquin de son désespoir larmoyant » (20).
Dans cette phrase le terme « accabler » qui semble
sûrement démesuré ou encore l’ironie présente à travers l’adjectif « larmoyant » qui sousentend une plainte qui serait injustifiée de la part de Thérèse.
Cette dernière, d’après les mots
du narrateur, semble presque réduire à l’esclavage madame Raquin : « La paralytique lui
devînt d’un usage journalier… » (20).
Zola insiste sur la paralysie de madame Raquin pour
rendre compte au lecteur des mauvaises volontés de Thérèse.
Et il continue : « Elle lui servait
en quelque sorte de prie-Dieu, de meuble devant lequel elle pouvait sans crainte avouer ses
fautes » (21).
Dans cette phrase, il compare Mme Raquin à un meuble ou un prie-Dieu,
déshumanisée, il veut montrer que Thérèse en profite.
En outre il souligne....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Thérèse Raquin chapitre XXXII
- commentaire: Emile Zola, Thérèse Raquin
- Commentaire Littéraire d’un extrait du chapitre XI de Thérèse Raquin
- Correction du commentaire composé Emile Zola, Thérèse Raquin (la scène du meurtre)
- Commentaire composé sur le dénouement de Thérèse Raquin