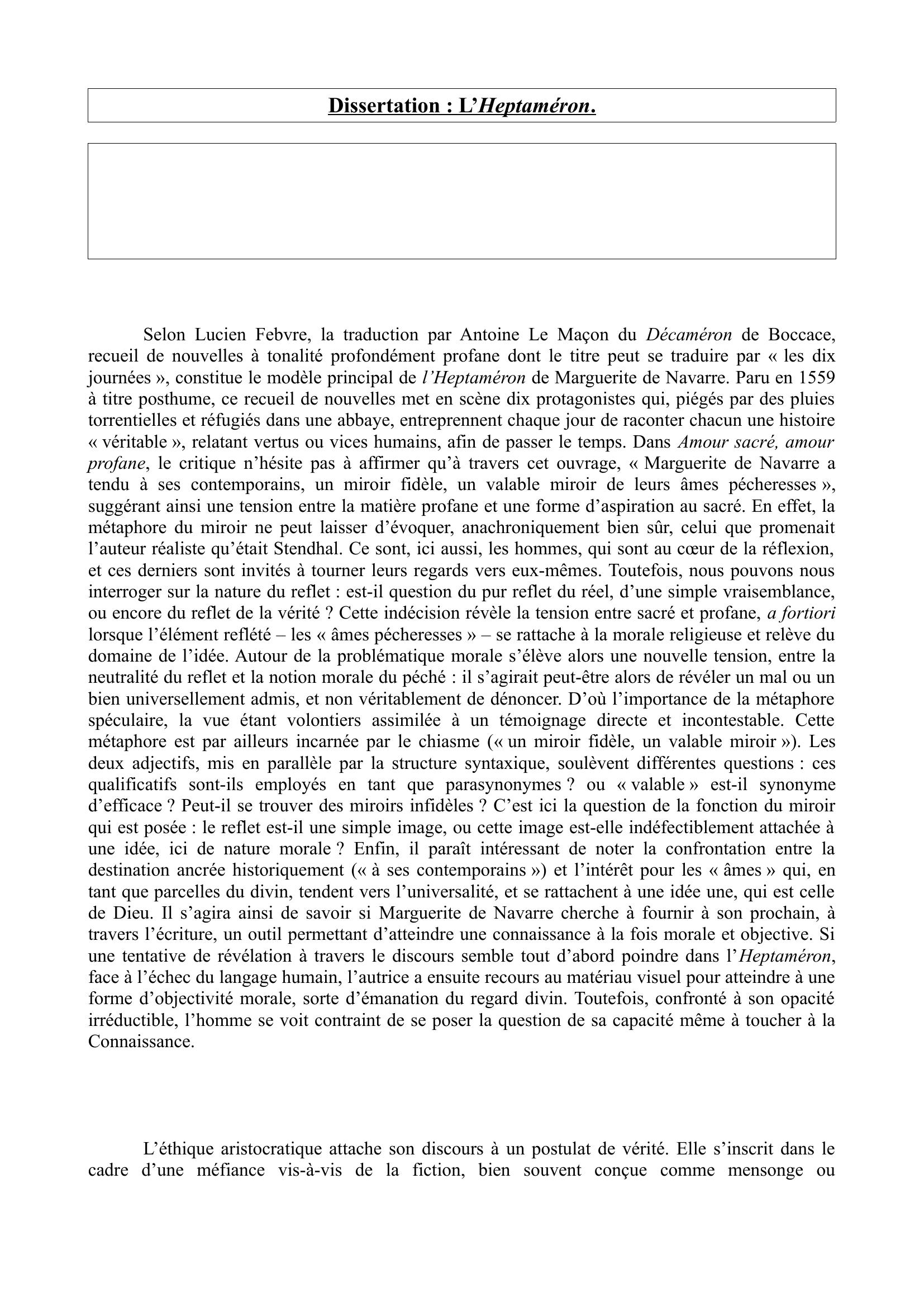Dissertation l'Heptaméron
Publié le 24/02/2022

Extrait du document
«
Dissertation : L’Heptaméron.
Selon Lucien Febvre, la traduction par Antoine Le Maçon du Décaméron de Boccace,
recueil de nouvelles à tonalité profondément profane dont le titre peut se traduire par « les dix
journées », constitue le modèle principal de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre.
Paru en 1559
à titre posthume, ce recueil de nouvelles met en scène dix protagonistes qui, piégés par des pluies
torrentielles et réfugiés dans une abbaye, entreprennent chaque jour de raconter chacun une histoire
« véritable », relatant vertus ou vices humains, afin de passer le temps.
Dans Amour sacré, amour
profane, le critique n’hésite pas à affirmer qu’à travers cet ouvrage, « Marguerite de Navarre a
tendu à ses contemporains, un miroir fidèle, un valable miroir de leurs âmes pécheresses »,
suggérant ainsi une tension entre la matière profane et une forme d’aspiration au sacré.
En effet, la
métaphore du miroir ne peut laisser d’évoquer, anachroniquement bien sûr, celui que promenait
l’auteur réaliste qu’était Stendhal.
Ce sont, ici aussi, les hommes, qui sont au cœur de la réflexion,
et ces derniers sont invités à tourner leurs regards vers eux-mêmes.
Toutefois, nous pouvons nous
interroger sur la nature du reflet : est-il question du pur reflet du réel, d’une simple vraisemblance,
ou encore du reflet de la vérité ? Cette indécision révèle la tension entre sacré et profane, a fortiori
lorsque l’élément reflété – les « âmes pécheresses » – se rattache à la morale religieuse et relève du
domaine de l’idée.
Autour de la problématique morale s’élève alors une nouvelle tension, entre la
neutralité du reflet et la notion morale du péché : il s’agirait peut-être alors de révéler un mal ou un
bien universellement admis, et non véritablement de dénoncer.
D’où l’importance de la métaphore
spéculaire, la vue étant volontiers assimilée à un témoignage directe et incontestable.
Cette
métaphore est par ailleurs incarnée par le chiasme (« un miroir fidèle, un valable miroir »).
Les
deux adjectifs, mis en parallèle par la structure syntaxique, soulèvent différentes questions : ces
qualificatifs sont-ils employés en tant que parasynonymes ? ou « valable » est-il synonyme
d’efficace ? Peut-il se trouver des miroirs infidèles ? C’est ici la question de la fonction du miroir
qui est posée : le reflet est-il une simple image, ou cette image est-elle indéfectiblement attachée à
une idée, ici de nature morale ? Enfin, il paraît intéressant de noter la confrontation entre la
destination ancrée historiquement (« à ses contemporains ») et l’intérêt pour les « âmes » qui, en
tant que parcelles du divin, tendent vers l’universalité, et se rattachent à une idée une, qui est celle
de Dieu.
Il s’agira ainsi de savoir si Marguerite de Navarre cherche à fournir à son prochain, à
travers l’écriture, un outil permettant d’atteindre une connaissance à la fois morale et objective.
Si
une tentative de révélation à travers le discours semble tout d’abord poindre dans l’Heptaméron,
face à l’échec du langage humain, l’autrice a ensuite recours au matériau visuel pour atteindre à une
forme d’objectivité morale, sorte d’émanation du regard divin.
Toutefois, confronté à son opacité
irréductible, l’homme se voit contraint de se poser la question de sa capacité même à toucher à la
Connaissance.
L’éthique aristocratique attache son discours à un postulat de vérité.
Elle s’inscrit dans le
cadre d’une méfiance vis-à-vis de la fiction, bien souvent conçue comme mensonge ou.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation de droit : La hiérarchie des normes
- philo: Méthode de la dissertation.
- Dissertation: Peut-on considérer que la métropolisation engendre à la fois un processus de concentration et d’accentuation des inégalités ?
- Dissertation: conseils
- dissertation des cannibales et des coches