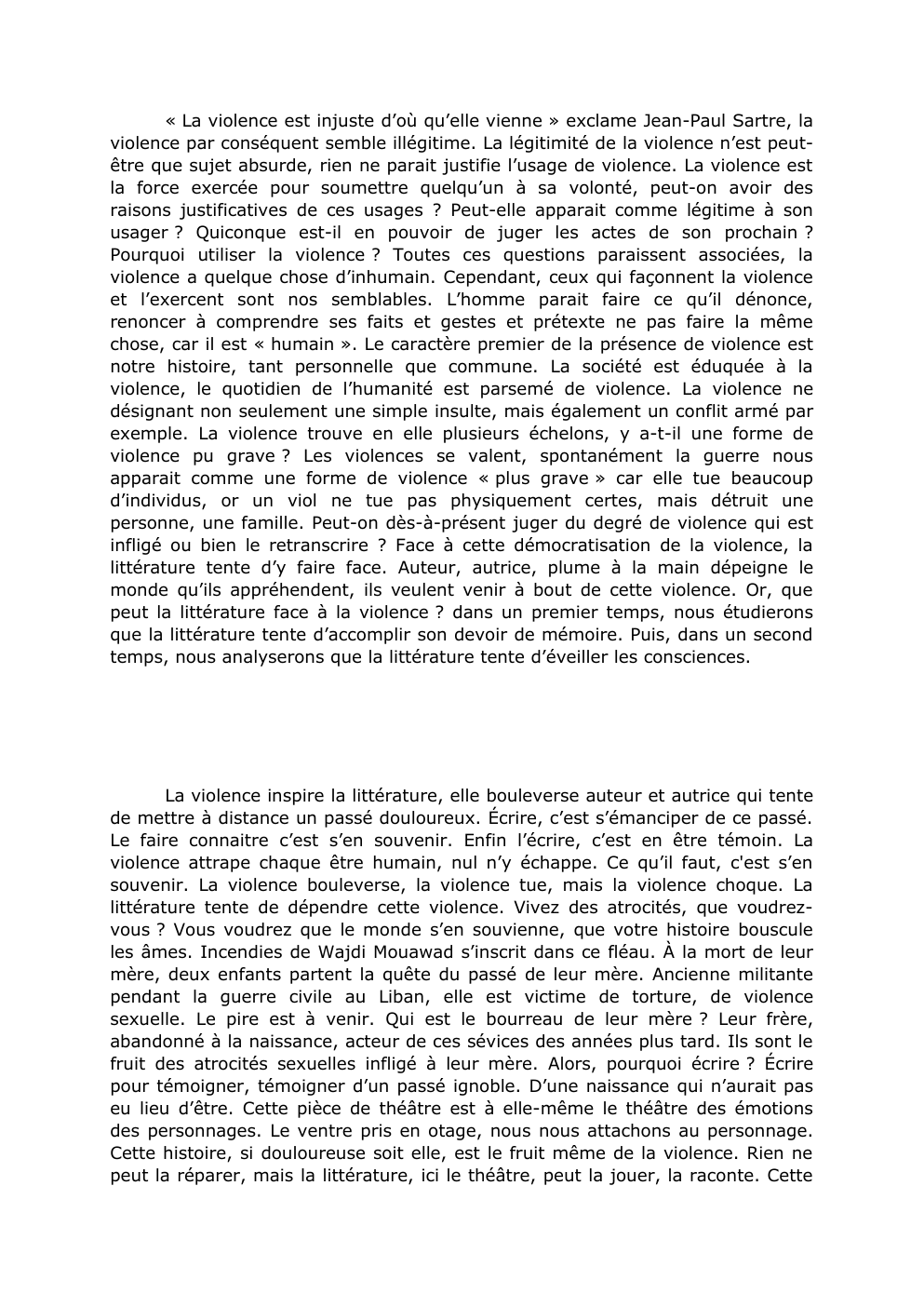Essai littéraire: pourquoi utiliser la violence ?
Publié le 17/04/2023
Extrait du document
«
« La violence est injuste d’où qu’elle vienne » exclame Jean-Paul Sartre, la
violence par conséquent semble illégitime.
La légitimité de la violence n’est peutêtre que sujet absurde, rien ne parait justifie l’usage de violence.
La violence est
la force exercée pour soumettre quelqu’un à sa volonté, peut-on avoir des
raisons justificatives de ces usages ? Peut-elle apparait comme légitime à son
usager ? Quiconque est-il en pouvoir de juger les actes de son prochain ?
Pourquoi utiliser la violence ? Toutes ces questions paraissent associées, la
violence a quelque chose d’inhumain.
Cependant, ceux qui façonnent la violence
et l’exercent sont nos semblables.
L’homme parait faire ce qu’il dénonce,
renoncer à comprendre ses faits et gestes et prétexte ne pas faire la même
chose, car il est « humain ».
Le caractère premier de la présence de violence est
notre histoire, tant personnelle que commune.
La société est éduquée à la
violence, le quotidien de l’humanité est parsemé de violence.
La violence ne
désignant non seulement une simple insulte, mais également un conflit armé par
exemple.
La violence trouve en elle plusieurs échelons, y a-t-il une forme de
violence pu grave ? Les violences se valent, spontanément la guerre nous
apparait comme une forme de violence « plus grave » car elle tue beaucoup
d’individus, or un viol ne tue pas physiquement certes, mais détruit une
personne, une famille.
Peut-on dès-à-présent juger du degré de violence qui est
infligé ou bien le retranscrire ? Face à cette démocratisation de la violence, la
littérature tente d’y faire face.
Auteur, autrice, plume à la main dépeigne le
monde qu’ils appréhendent, ils veulent venir à bout de cette violence.
Or, que
peut la littérature face à la violence ? dans un premier temps, nous étudierons
que la littérature tente d’accomplir son devoir de mémoire.
Puis, dans un second
temps, nous analyserons que la littérature tente d’éveiller les consciences.
La violence inspire la littérature, elle bouleverse auteur et autrice qui tente
de mettre à distance un passé douloureux.
Écrire, c’est s’émanciper de ce passé.
Le faire connaitre c’est s’en souvenir.
Enfin l’écrire, c’est en être témoin.
La
violence attrape chaque être humain, nul n’y échappe.
Ce qu’il faut, c'est s’en
souvenir.
La violence bouleverse, la violence tue, mais la violence choque.
La
littérature tente de dépendre cette violence.
Vivez des atrocités, que voudrezvous ? Vous voudrez que le monde s’en souvienne, que votre histoire bouscule
les âmes.
Incendies de Wajdi Mouawad s’inscrit dans ce fléau.
À la mort de leur
mère, deux enfants partent la quête du passé de leur mère.
Ancienne militante
pendant la guerre civile au Liban, elle est victime de torture, de violence
sexuelle.
Le pire est à venir.
Qui est le bourreau de leur mère ? Leur frère,
abandonné à la naissance, acteur de ces sévices des années plus tard.
Ils sont le
fruit des atrocités sexuelles infligé à leur mère.
Alors, pourquoi écrire ? Écrire
pour témoigner, témoigner d’un passé ignoble.
D’une naissance qui n’aurait pas
eu lieu d’être.
Cette pièce de théâtre est à elle-même le théâtre des émotions
des personnages.
Le ventre pris en otage, nous nous attachons au personnage.
Cette histoire, si douloureuse soit elle, est le fruit même de la violence.
Rien ne
peut la réparer, mais la littérature, ici le théâtre, peut la jouer, la raconte.
Cette
histoire fictive est inspirée de faits réels.
Ces violences ont existé ; les oublier
n’est pas la solution.
Au nom de l’injustice, la littérature peut seulement les faire
perdurer dans le temps, à la quête d’une justice pour leur mère.
La littérature
met en lumière les atrocités qui marquent les générations futures.
De plus, l’homme est témoin de diverses atrocités.
Les atrocités
parsèment l’histoire commune de l’être humain.
Du meurtre de Jules César à la
Seconde Guerre mondiale en passant par les massacres de la Saint-Barthélémy,
la violence est omniprésente.
L’écrire, c’est encore une fois en être témoin.
Il
faut écrire pour raconter, mais dans ce cadre, écrire pour oublier, du moins
tenter d’oublier.
Comment oublier quand l’on voit des milliers de personnes
mourir ? Comment oublier quand nos jours sont comptés ? Simplement,
comment oublier la souffrance ? Plus que des corps brisés, ce sont des âmes
meurtries qui émerge de cette guerre, qui émerge de cette absurdité, théâtre de
violences, sans limites.
Des lires nous changent, transforment notre vision du
monde.
Si c’est un homme de Primo Levi, c'est ce livre, le livre qui change votre
vie.
Italien juif, antifasciste, il est fait prisonnier puis déporté Auschwitz.
Il écrit
pour transmettre l’horreur qu’il a vu de son arrivée où l’on ouvrait les deux côtés
du wagon sans en prévenir les occupants pour les trier, ceux du bon côté
vivaient, eux du mauvais, mourraient.
À sa libération, en 1945, par l’armée
soviétique.
Auschwitz, c'est un traumatisme.
Témoins d’horreur, de meurtre
d’enfants qui apparente « nécessaire » aux allemands.
La réalité même en
découle les relations de pouvoir entre les SS, les kapos et les différents groupes
de déportés façonnent le quotidien de ces juifs innocents, mais enfermés, jugés
coupables d’être juifs.
Également, le portrait d’un quotidien douloureux émerge
entre travaille incessant et famine.
Le quotidien s’apparente à une quête de
nourriture au prix de tout ce qu’il nous reste.
C’est l’instinct de survie qui nourrit
le quotidien là-bas, l’humain est déshumanisé, la vie là-bas ne tient qu’un fil.
Cet
ouvrage est un livre de transmission « N’oubliez pas que cela fût.
Non, ne
l’oubliez pas.
Gravez ses mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
en vous couchant, en vous levant.
Répétez-les à vos enfants ».
La littérature
n’efface rien à la misère, mais ici, elle perpétue un héritage.
Elle transmet ce qui
peut être trop dur à entendre.
Ce qui est fait est fait, mais, il ne faut pas
l'oublier.
La littérature tente d’apaiser la violence, la littérature tente d’y
remédier, mais en vain.
Notre histoire commune constitue les bases de notre identité.
L’humain
s’identifie à ses ancêtres.
Les descendants s’approprient le comportement des
anciens comme modèles.
L’enfant voudrait devenir son père ou sa mère.
Dans
certains cas, la violence est ce qui forge l’adulte à qui l’on s’identifie.
Marqueurs
du passé et de notre avenir, la violence nous façonne, à son grès.
C’est ainsi que
dans un roman Vers la violence, l’autrice Blandine Rinkel.
Écrire, c’est se
souvenir de ses racines.
Dans ce roman, elle dresse le portrait de son père,
Gérard, un homme violent.
Dès son enfance, elle évolue dans un climat de peur
face à cet homme qui l’impressionne tant.
Accompagnée d’une mère
impuissante, la petite Lou est éduqué entre l’absence d’un père et sa violence.
Le
père, lui-même victime de violence de la part de ses parents, semble être touché
par ce virus, transmis par le sang.
Il n’est pas né violent, mais il a hérité de la
violence.
L’atmosphère nous plonge dans un climat de tensions, il va peut-être
arriver quelque chose, de quoi s’agit-il, nous ne savons pas, mais nous avons
peur.
Phrase clé de cette œuvre, l’autrice déclare que ce dont elle a hérité de son
père, c'est la joie, l’absence et la violence.
« C’est un père qui fait peur à sa fille,
peut-être pour tenir ses propres démons à distance.
» Seule échappatoire qui
parait s’offrir à l’enfant, c’est la danse.
Lou veut fuir cette violence et y échapper,
comme si celle-ci était une malédiction.
Écrire parait par conséquent être un
moyen de se souvenir, d’ancré nos origines, nos modèles dans du papier.
Rinkel
écrit pour ne pas oublier, elle veut se souvenir d’où elle vient, ce qu’il l’aide....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le pouvoir politique doit-il dépasser ou utiliser la violence à son profit ?
- Peut-on utiliser la violence pour défendre la justice ?
- Est-il légitime d'utiliser la violence pour défendre ses droits ?
- Doit-on utiliser la violence pour faire respecter la loi ?
- « La révolution n'est pas un dîner de gala; elle ne se fait pas comme une oeuvre littéraire, un dessin ou une broderie [...]. C'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. » Mao Tsé-toung, Le Petit Livre rouge, 1966. Commentez cette citation.