FARGUE Léon-Paul : sa vie et son oeuvre
Publié le 06/12/2018

Extrait du document
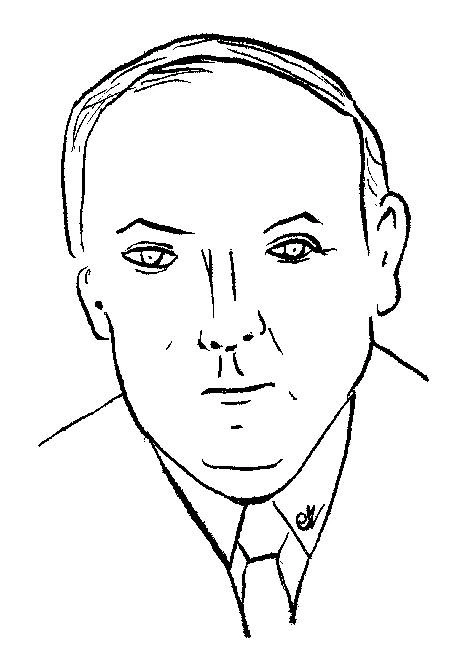
FARGUE Léon-Paul (1876-1947). Poète et chroniqueur français, Fargue fut une véritable figure littéraire, bien représentative de son époque, combinant une personnalité qui ne manquait pas de pittoresque et une conception de la poésie originale en cette période de transition.
Un fantaisiste tranquille
L’existence de Léon-Paul Fargue se place, dès l’abord, sous le signe de la marginalité. Il naît en effet à Paris, le 6 mars 1876, au foyer d’un couple illégitime et assez disparate : sa mère, couturière, a gardé de son Berry natal et de ses origines paysannes le goût du concret; son père, qui ne le reconnaîtra que seize ans plus tard, est diplômé de l’École centrale et dirige, sans beaucoup d’intérêt ni de réalisme, une fabrique de céramique. L’enfant, qui assume mal cette situation, se réfugie dans des rêves, alimentés par la lecture de récits de voyages, et se passionne pour l’histoire naturelle (il élève un rat blanc, des vers à soie et visite assidûment le Jardin des Plantes). Sa scolarité se poursuit sans difficultés notables au lycée Condorcet où il suit l’enseignement de Mallarmé, puis à Janson-de-Sailly où il chahute le critique Émile Faguet. Fargue, qui hésite encore entre l’écriture et la peinture, choisit finalement d’entrer en khâgne à Henri-IV en 1892, où il aura comme condisciples Jarry et Thibaudet. Mais, incapable de se plier à une discipline intellectuelle stricte, il délaisse ses études pour s’absorber dans des lectures encyclopédiques, écrire, peindre ou jouer du piano...
De ce dilettantisme devaient émerger un sens aigu de l’observation critique et un humour particulièrement corrosif. Dans le même temps, il commence à se mêler au monde littéraire parisien, en pleine effervescence à cette époque : il assiste aux « mardis » de Mallarmé, publie des articles critiques dans l'Art littéraire, se lie à des écrivains (Claudel, Valéry, H. de Régnier, M. Schwob). Vers 1895, il écrit Tancrède (paru en 1911), sorte de roman lyrique à mi-chemin entre le récit et le poème. Étonnamment réceptif aux courants de son temps, Fargue mène alors une vie de noctambule, et joue un rôle d'animateur actif dans les milieux artistiques. Avec ses amis des « Apaches d'Auteuil », il participe notamment au lancement des Ballets russes de Diaghilev et défend les peintres impressionnistes (Van Gogh, Bonnard, Cézanne). Sa production est intense, mais il refuse le plus souvent de publier ses écrits, rature, déchire, dans un souci maladif de perfection inaccessible. Son esprit caustique, sa drôlerie lui valent des invitations à dîner dans le monde parisien; il arrive dans son légendaire taxi, régulièrement avec deux heures de retard, se créant bien vite une solide réputation de bohème.
La mort de son père, qu’il vit comme un drame, confère à ses lextes un caractère de gravité dont témoignent Poèmes (1905) et Pour la musique (1912). Il fait cependant partie des « Patassons », groupe d’écrivains fantaisistes qui comprend aussi Valéry Larbaud. Après la Grande Guerre à laquelle, réformé, il n'a pas pris part, il s’intéresse un temps aux méthodes des surréalistes, mais, trop classique et trop individualiste, ne peut s’intégrer au groupe. Au demeurant, sa célébrité lui fait occuper un rôle plus officiel dans le monde littéraire; il accepte de diriger avec Larbaud et Valéry la revue Commerce (1924), est décoré de la Légion d'honneur, fait l’objet d'un numéro d’hommage de Feuilles Libres en 1927, reçoit le prix de la Renaissance, fait partie de l’Académie Mallarmé, tout en poursuivant à un rythme plus rapide la publication de ses écrits : Banalité, Vul-turne, Epaisseurs (1928), Sous la lampe, les Ludions (1930), D’après Paris (1932), le Piéton de Paris (1939), Haute Solitude (1941). La maladie — il est frappé d’hémiplégie en 1943 à la terrasse d’un café — n’interrompt pas cette suite de brillants succès : entouré par sa femme, le peintre Chériane, qu’il avait épousée en 1935, et de ses amis qu’il reçoit chaque dimanche dans sa chambre, il connaît jusqu’à sa mort en 1947 une période d’activité intense, poursuivant notamment la rédaction de ses souvenirs (Refuge, 1942; la Lanterne magique, 1944; Méandres, 1946; Portraits de famille, 1947).
Mais Fargue n’occupe pas seulement une place de « personnage littéraire », de découvreur et de coordonnateur des différents courants de son temps; il a également élaboré une œuvre qui, par ses aspects multiples et ses
thématiques, reflète fidèlement ses préoccupations personnelles.
La prolifération du réel
A beaucoup d’égards, la poésie de Fargue se constitue comme une réaction devant la diversité angoissante de la réalité. Refusant une quelconque intégration — comme en atteste sa biographie —, cet éternel errant s’érige le plus souvent en spectateur qui, grâce à sa sensualité profonde et à l’acuité de son regard, sait appréhender les choses du quotidien : « Des enfants jouent et crient, doucement, dans un square étroit et noir, au crépuscule. Des ruelles serrées, sans oreilles, des murs criblés se consument. Des cheminées s'ennuient contre le ciel de haute lisse. Dans leurs chaînons de fumée grasse, on lit des foules qui dégorgent » (Poèmes). La promenade sera le lieu privilégié de l’étude du Réel pour cet observateur si disponible :
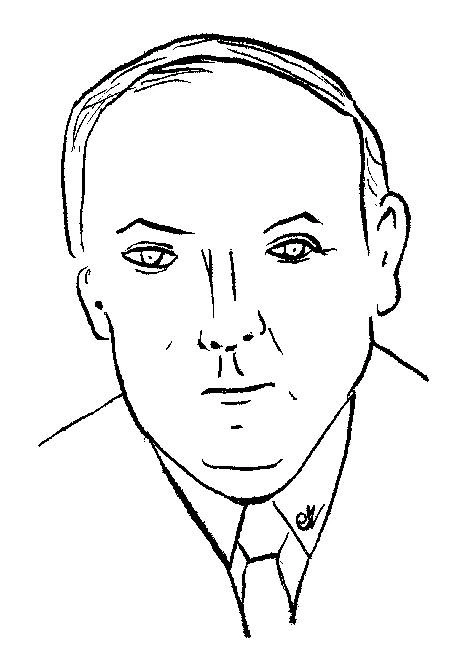
«
assez
disparate : sa mère, couturière, a gardé de son
Berry natal et de ses origines paysannes le goût du
concret; son père, qui ne le reconnaîtra que seize ans
plus tard, est diplômé de l'École centrale et dirige, sans
beaucoup d'intérêt ni de réalisme, une fabrique de céra
mique.
L'enfant, qui assume mal cette situation, se réfu
gie dans des rêves, alimentés par la lecture de récits de
voyages, et se passionne pour l'histoire naturelle (il
élève un rat blanc, des vers à soie et visite assidûment
le Jardin des Plantes).
Sa scolarité se poursuit sans diffi
cultés notables au lycée Condorcet où il suit l'enseigne
ment de M�llarmé, puis à Janson-de-Sailly où il chahute
le critique Emile Faguet.
Fargue, qui hésite encore entre
l'écriture et la peinture, choisit finalement d'entrer en
khâgne à Henri-IV en 1892, où il aura comme condisci
ples Jarry et Thibaudet.
Mais, incapable de se plier à une
discipline intellectuelle stricte, il délaisse ses études pour
s'absorber dans des lectures encyclopédiques, écrire,
peindre ou jouer du piano ...
De ce dilettantisme devaient émerger un sens aigu
de l'observation critique et un humour particulièrement
corrosif.
Dans le même temps, il commence à se mêler
au monde littéraire parisien, en pleine effervescence à
cette époque : il assiste aux « mardis » de Mallarmé,
publie des articles critiques dans l'Art littéraire, se lie
à des écrivains (Claudel, Valéry, H.
de Régnier,
M.
Schwob).
Vers 1895, il écrit Tancrède (paru en 1911),
sorte de �oman lyrique à mi-chemin entre le récit et le
poème.
Etonnamment réceptif aux courants de son
temps, Fargue mène alors une vie de noctambule, et joue
un rôle d'animateur actif dans les milieux artistiques.
Avec ses amis des «Apaches d"Auteuil », il participe
notamment au lancement des Ballets russes de Diaghilev
et défend les peintres impressionnistes (Van Gogh, Bon
nard, Cézanne).
Sa production est intense, mais il refuse
Je plus souvent de publier ses écrits, rature, déchire, dans
un souci maladif de perfection inaccessible.
Son esprit
caustique, sa drôlerie lui valent des invitations à dîner
dans le monde parisien; il arrive dans son légendaire
taxi, régulièrement avec deux heures de retard, se créant
bien vite une solide réputation de bohème.
La mort d(: son père, qu'il vit comme un drame,
confère à ses textes un caractère de gravité dont témoi
gnent Poèmes (1905) et Pour la musique ( 1912).
Il fait
cependant partie des « Patassons », groupe d'écrivains
fantaisistes qui comprend aussi Valery Larbaud.
Après
la Grande Guerre à laquelle, réformé, il n'a pas pris part,
il s'intéresse un temps aux méthodes des surréalistes,
mais, trop classique et trop individualiste, ne peut s'inté
grer au groupe.
Au demeurant, sa célébrité lui fait occu
per un rôle plus officiel dans le monde littéraire; il
accepte de diriger avec Larbaud et Valéry la revue Com
merce (1924), est décoré de la Légion d'honneur, fait
l'objet d'un numéro d'hommage de Feuilles Libres en
1927, reçoit le prix de la Renaissance, fait partie de
1 'Académie Mallarmé, tout en poursui va nt à un rythme
plus rapide la publication de ses écrits : Banalité, Vul
turne, Epaisseurs ( 1928), Sous la lampe, les Ludions
(1930), D'après Paris (1932), /e Piéton de Paris (1939),
Haute Solitude (l941 ).
La maladie -il est frappé
d'hémiplégie en 1943 à la terrasse d'un café- n'inter
rompt pas cette suite de brillants succès : entouré par sa
femme, le peintre Chériane, qu'il avait épousée en 1935,
et de ses amis qu'il reçoit chaque dimanche dans sa
chambre, il connaît jusqu'à sa mort en 1947 une période
d'activité intense, poursuivant notamment la rédaction
de ses souvenirs (Refuge, 1942; la Lanterne magique,
1944; Méandres, 1946; Portraits de famille, 1947).
Mais Fargue n'occupe pas seulement une place de
« personnage littéraire», de découvreur et de coordonna
teur des différents courants de son temps; il a également
élaboré une œuvre qui, par ses aspects multiples et ses thématiques,
reflète fidèlement ses préoccupations per
sonnelles.
La prolifération du réel
A beaucoup d'égards,la poésie de Fargue se constitue
comme une réaction devant la diversité angoissante de
la réalité.
Refusant une quelconque intégration -
comme en atteste sa biographie -, cet éternel errant
s'érige le plus souvent en spectateur qui, grâce à sa
sensualité profonde et à 1 'acuité de son regard, sait
appréhender les choses du quotidien : « Des enfants
jouent et crient, doucement, dans un square étroit et noir,
au crépuscule.
Des ruelles serrées, sans oreilles, des murs
criblés se consument.
Des cheminées s'ennuient contre
le ciel de haute lisse.
Dans leurs chaînons de fumée
grasse, on lit des foules qui dégorgent» (Poèmes).
La
promenade sera le lieu privilégié de l'étude du Réel pour
cet observateur si disponible : «J'aime chercher dans
vos faubourgs ces yeux de l'Inconnu qui me sont fami
liers» (ibid.).
L'objet et la personne acquièrent alors
une présence particulière; fortement individualisés par la
perception du poète, ils tendent à la singularité absolue,
comme en témoignent chez lui Je petit nombre de mots
pluriels et l'abondance des adjectifs descriptifs.
Les
phrases se juxtaposent sans lien logique, perdant même
leur verbe, et, selon un procédé cher à Rimbaud, font
coexister la description et l'impression qui s'en dégage :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BONNETAIN Paul : sa vie et son oeuvre
- BERNSTEIN Henry Léon Gustave Charles : sa vie et son oeuvre
- D'APRÈS PARIS. (résumé & analyse) de Léon-Paul Fargue
- PIÉTON DE PARIS (Le) de Léon-Paul Fargue (résumé)
- BLOY Léon Henri Marie : sa vie et son oeuvre

































