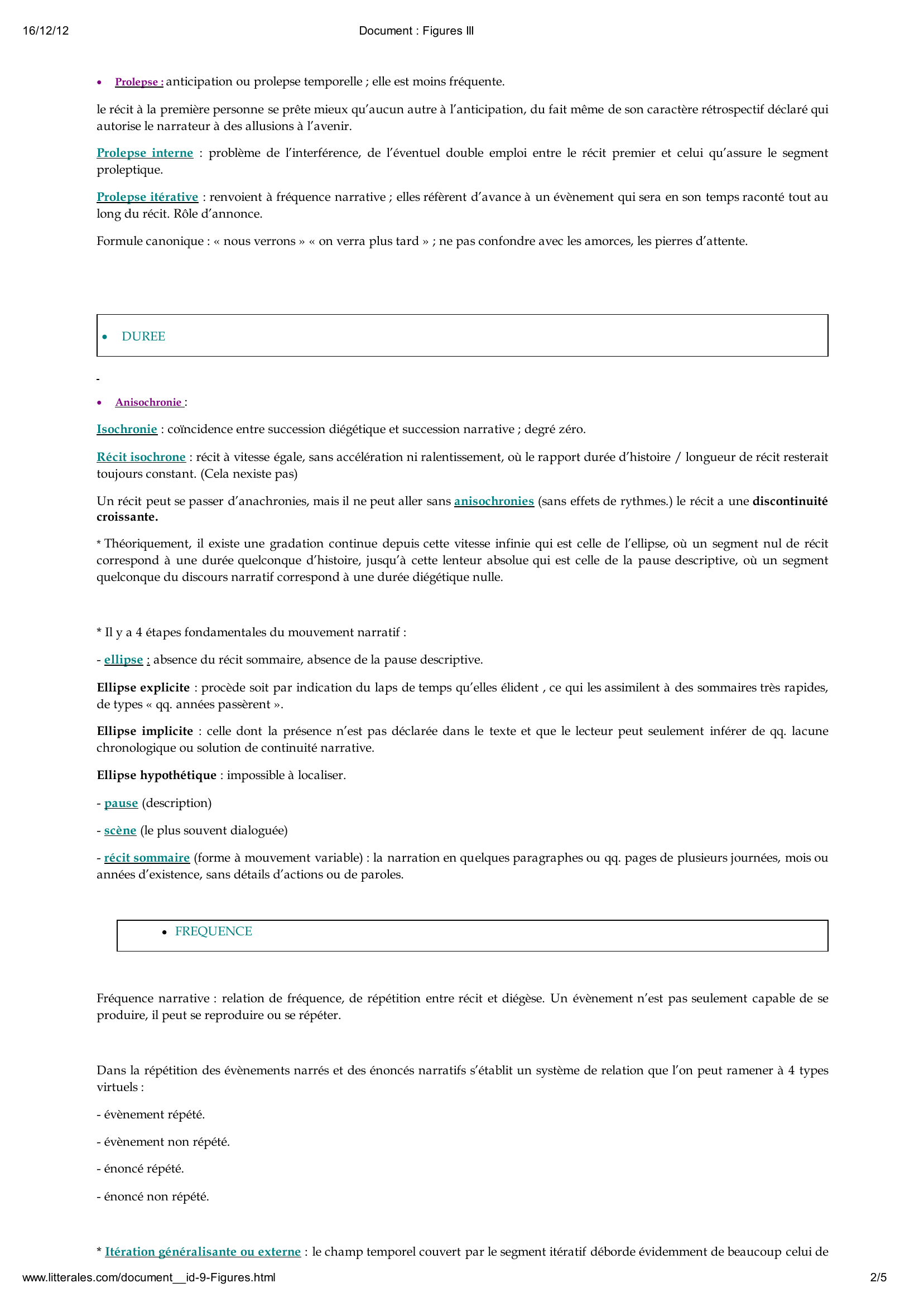figures 3
Publié le 16/12/2012

Extrait du document
«
16/12/12 Docum ent : Figures III
2/5 www.litterales.com /docum ent__id-9-Figures.htm l
· Prolepse : anticipation ou prolepse tem porelle ; elle est m oins fréquente.
le récit à la prem ière personne se prête m ieux qu’aucun autre à l’anticipation, du fait m êm e de son caractère rétrospectif déclaré qui
autorise le narrateur à des allusions à l’avenir.
Prolepse interne : problèm e de l’interférence, de l’éventuel double em ploi entre le récit prem ier et celui qu’assure le segm ent
proleptique.
Prolepse itérative : renvoient à fréquence narrative ; elles réfèrent d’avance à un évènem ent qui sera en son tem ps raconté tout au
long du récit.
Rôle d’annonce.
Form ule canonique : « nous verrons » « on verra plus tard » ; ne pas confondre avec les am orces, les pierres d’attente.
· D U REE
· Anisochronie :
Isochronie : coïncidence entre succession diégétique et succession narrative ; degré zéro.
R écit isochrone : récit à vitesse égale, sans accélération ni ralentissem ent, où le rapport durée d’histoire / longueur de récit resterait
toujours constant.
(C ela nexiste pas)
U n récit peut se passer d’anachronies, m ais il ne peut aller sans anisochronies (sans effets de rythm es.) le récit a une discontinuité
croissante.
* Théoriquem ent, il existe une gradation continue depuis cette vitesse infinie qui est celle de l’ellipse, où un segm ent nul de récit
correspond à une durée quelconque d’histoire, jusqu’à cette lenteur absolue qui est celle de la pause descriptive, où un segm ent
quelconque du discours narratif correspond à une durée diégétique nulle.
* Il y a 4 étapes fondam entales du m ouvem ent narratif :
- ellipse : absence du récit som m aire, absence de la pause descriptive.
Ellipse explicite : procède soit par indication du laps de tem ps qu’elles élident , ce qui les assim ilent à des som m aires très rapides,
de types « qq.
années passèrent ».
Ellipse im plicite : celle dont la présence n’est pas déclarée dans le texte et que le lecteur peut seulem ent inférer de qq.
lacune
chronologique ou solution de continuité narrative.
Ellipse hypothétique : im possible à localiser.
- pause (description)
- scène (le plus souvent dialoguée)
- récit som m aire (form e à m ouvem ent variable) : la narration en quelques paragraphes ou qq.
pages de plusieurs journées, m ois ou
années d’existence, sans détails d’actions ou de paroles.
FREQ U EN C E
Fréquence narrative : relation de fréquence, de répétition entre récit et diégèse.
U n évènem ent n’est pas seulem ent capable de se
produire, il peut se reproduire ou se répéter.
D ans la répétition des évènem ents narrés et des énoncés narratifs s’établit un systèm e de relation que l’on peut ram ener à 4 types
virtuels :
- évènem ent répété.
- évènem ent non répété.
- énoncé répété.
- énoncé non répété.
* Itération généralisante ou externe : le cham p tem porel couvert par le segm ent itératif déborde évidem m ent de beaucoup celui de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- figures de style
- Les Figures de Styles
- Géométrie Les figures planes Prends ton porte-documents pages 10, 11, 12 et remplis la case à côté de chaque figure.
- FIGURES DE LA PASSION DU SEIGNEUR Gabriel Miro (résumé)
- géométrie : symétrie Colorie SEULEMENT les figures qui sont symétriques.