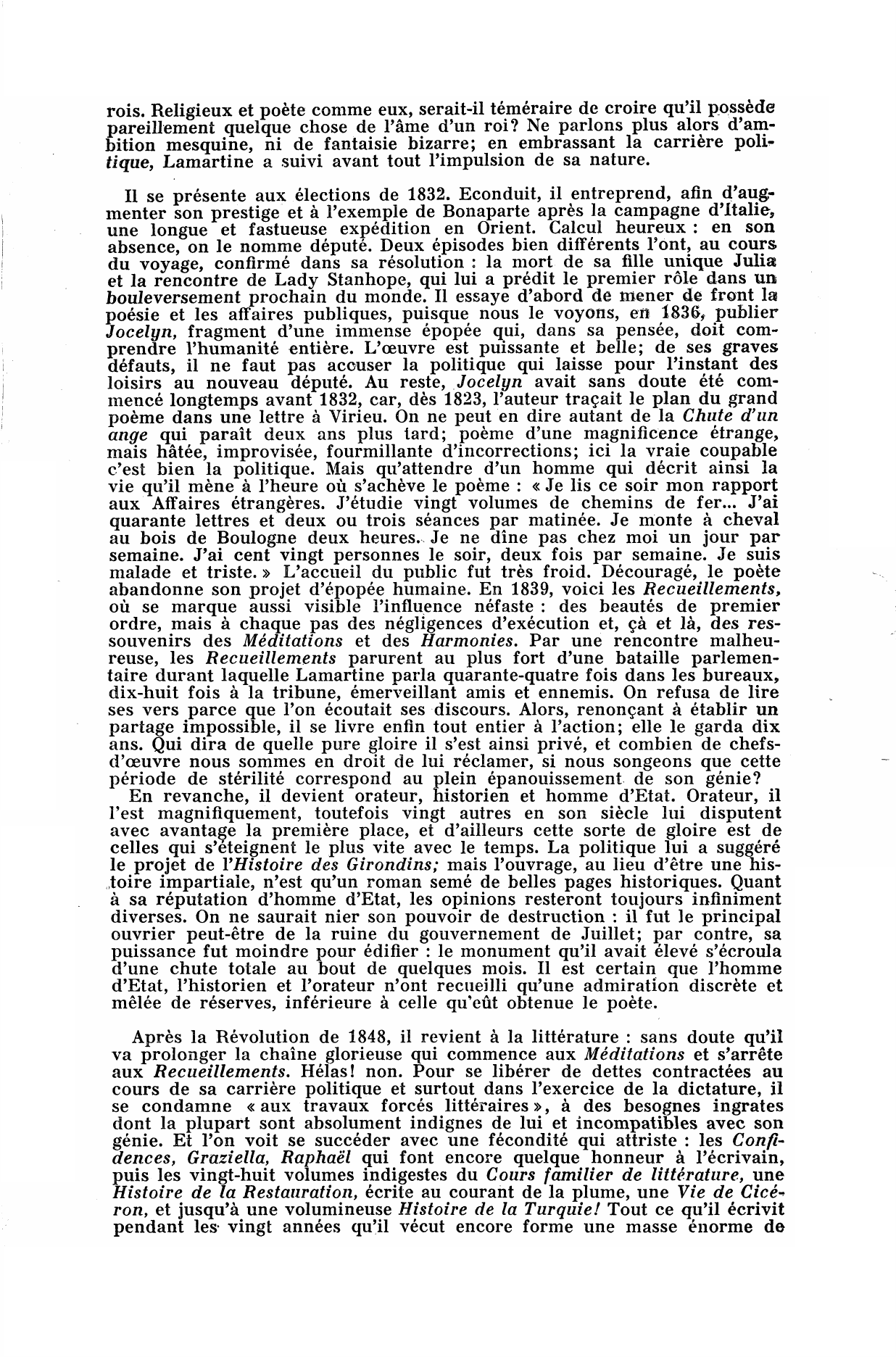Jugement de Lamartine sur lui-même
Publié le 11/02/2012

Extrait du document
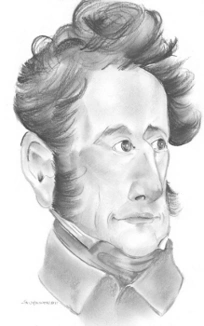
Expliquez et appréciez ce jugement porté par Lamartine sur lui-même :
« J'ai trop écrit, trop parlé, trop agi, pour avoir pu concentrer dans une
seule oeuvre capitale et durable le peu de talent dont la nature m'avait plus
ou moins doué. Comme le grand oiseau du désert, qui n'est pas l'aigle, j'ai
semé çà et là dans le sable les germes de ma postérité, et je n'ai pas assez
.couvé, pour les voir éclore, les oeufs dispersés du génie. J'ai eu de l'âme,
c'est vrai : voilà tout. J'ai jeté quelques cris justes du coeur. Mais si l'âme
suffit pour sentir, elle ne suffit pas pour exprimer. Le temps m'a manqué
pour une oeuvre parfaite, parce que j'ai dilapidé le temps, ce capital du
génie.«
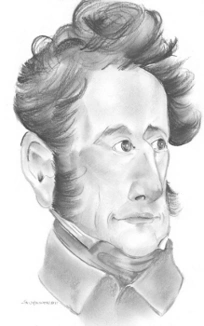
«
rois.
Religieux et poète comme eux, serait-il téméraire de croire qu'il p_qssède pareillement quelque chose de l'âme d'un roi? Ne parlons plus alors d'am bition mesquine, ni de fantaisie bizarre; en embrassant la carrière poli ..
tique, Lamartine a suivi avant tout l'impulsion de sa nature.
Il se présente aux élections de 1832.
Econduit, il entreprend, afin q'aug menter son prestige et à l'exemple de Bonaparte après la campagne d'Italie, une longue et fastueuse expédition en Orient.
Calcul heureux : en son absence, on le nomme députe.
Deux épisodes bien différents l'ont, au cours du voyage, confirmé dans sa résolution : la mort de sa fille unique Julia et la rencontre de Lady Stanhope, qui lui a prédit le premier rôle dans un bouleversement prochain du monde.
Il essaye d'abord de mener de front la poésie et les affaires publiques, puisque nous le voyons, en 1836, publier Jocelyn, fragment d'une immense épopée q_ui, dans sa pensée, doit com prendre l'humanité entière.
L'œuvre est pmssante et belle; de ses graves défauts, il ne faut pas acouser la politique qui laisse pour l'instant des loisirs au nouveau député.
Au reste, Jocelyn avait sans doute été com meucé longtemps avant 1832, car, dès 1823, l'auteur traçait le plan du grand poème dans une lettre à Virieu.
On ne peut en dire autant de la Chute d'un ange qui paraît deux ans plus tard; poème d'une magnificence étrange, mais hâtée, improvisée, fourmillante d'incorrections; ici la vraie coupable c'est bien la politique.
Mais qu'attendre d'un homme qui décrit ainsi la vie qu'il mène à l'heure où s'achève le poème : «Je lis ce soir mon rapport aux Affaires étrangères.
J'étudie vingt volumes de chemins de fer ...
J'ai quarante lettres et deux ou trois séances par matinée.
Je monte à cheval au bois de Boulogne deux heures.
Je ne dîne pas chez moi un jour par semaine.
J'ai cent vingt personnes le soir, deux fois par semaine.
Je suis malade et triste.
» L'accueil du public fut très froid.
Découragé, le poète abandonne son projet d'épopée humaine.
En 1839, voici les Recueillements, où se marque aussi visible l'influ.ence néfaste : des beautés de premier ordre, mais à chaque pas des négligences d'exécution et, çà et là, des res souvenirs des Méditations et des Harmonies.
Par une rencontre malheu reuse, les Recueillements parurent au plus fort d'une bataille parlemen taire durant laquelle Lamartine parla quarante-quatre fois dans les bureaux, dix-huit fois à la tribune, émerveillant amis et ennemis.
On refusa de lire ses vers parce que l'on écoutait ses discours.
Alors, renonçant à établir un partage impossible, il se livre enfin tout entier à l'action; elle le garda dix ans.
Qui dira de quelle pure gloire il s'est ainsi privé, et combien de chefs d'œuvre nous sommes en droit de lui réclamer, si nous songeons que cette période de stérilité correspond au plein épanouissement de son génie? En revanche, il devient orateur, historien et homme d'Etat.
Orateur, il l'est magnifiquement, toutefois vingt autres en son siècle lui disputent avec avanta~e la première place, et d'ailleurs cette sorte de gloire est de celles qui s'eteignent le plus vite avec le temps.
La politique lui a suggéré le projet de l'Histoire des Girondins; mais l'ouvrage, au lieu d'être une his Joire impartiale, n'est qu'un roman semé de belles pages historiques.
Quant à sa réputation d'homme d'Etat, les opinions resteront toujours infiniment diverses.
On ne saurait nier son pouvoir de destruction : il fut le principal ouvrier peut-être de la ruine du gouvernement de Juillet; par contre, sa puissance fut moindre pour édifier : le monument qu'il avait élevé s'écroula d'une chute totale au bout de quelques mois.
Il est certain que l'homme d'Etat, l'historien et l'orateur n'ont recueilli qu'une admiration discrète et mêlée de réserves, inférieure à celle qu'eût obtenue le poète.
Après
la Révolution de 1848, il revient à la littérature : sans doute qu'il va prolonger la chaîne glorieuse qui commence aux Méditations et s'arrête aux Recueillements.
Hélas 1 non.
Pour se libérer de dettes contractées au cours de sa carrière politique et surtout dans l'exercice de la dictature, il se condamne « aux travaux forcés littéraires », à des besognes ingrates dont la plupart sont absolument indignes de lui et incompatibles avec son génie.
Et l'on voit se succéder avec une fécondité qui attriste : les Confi dences, Graziella, Raphaël qui font encore quelque honneur à l'écrivain, puis les vingt-huit volumes indigestes du Cours familier de littérature, une Histoire de la Restauration, écrite au courant de la plume, une Vie de Cicé ron, et jusqu'à une volumineuse Histoire de la Turquie! Tout ce qu'il écrivit pendant les· vingt années qu~il vécut encore forme une masse énorme de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lamartine a dit de Voltaire qu'il était la Médaille du pays. Il veut signifier par là que, de tous nos écrivains, c'est Voltaire qui incarne le plus complètement et le plus parfaitement l'esprit français, et que nous retrouvons en lui les traits principaux dt notre caractère. Expliquez et appréciez ce jugement.
- « Les Fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant », écrit, en 1849, Lamartine dans la préface à la réédition de ses Premières méditations. Vous commenterez ce jugement en vous appuyant sur les fables que vous avez étudiées. ?
- Discuter ce jugement de Sainte-Beuve sur Lamartine : « Ce qui est particulier à Lamartine consiste dans un certain tour naturel de sentiments communs à tous. Il ne débute jamais par rien d'exceptionnel, soit en idées, soit en sentiments ; mais, dans ce qui lui est commun avec tous, il s'élève, il idéalise. Il arrive ainsi qu'on le suit aisément, si haut qu'il aille, et que le moindre cœur tendre monte sans fatigue avec lui. »
- Un jugement de Lamartine sur Victor Hugo
- Discutez ce jugement de Lamartine : « La poésie pleure bien, chante bien, mais elle décrit mal.»