LA CARRIÈRE DRAMATIQUE DE CORNEILLE
Publié le 13/05/2011
Extrait du document
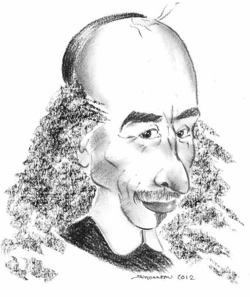
— Elle a commencé avec des comédies de moeurs (Malte, la Veuve, la Galerie du Palais, Place Royale), intéressantes par la peinture des moeurs contemporaines, agréables par l'élégance du dialogue. Plus tard, Corneille reviendra à ce genre comique avec le Menteur, imité d'une comédie espagnole, la Vérité suspecte d'Alarcon. Il s'agit d'un jeune homme qui ment par jeu, par plaisir, par vanité aussi; il ment encore pour échapper à un mariage voulu par son père; enfin, après les plus troublants imbroglios, il épouse la jeune fille qu'il aime. [Corneille, tout en imitant Alarcon, est resté original; il a fait prévaloir l'analyse morale sur la complication savante de l'intrigue; il a notamment donné un caractère tout à fait cornélien à la grande scène de la semonce paternelle, la retardant, la préparant, la faisant éclater à la fois plus morale et plus dramatique. La pièce a beau n'être qu'une comédie amusante, elle n'en présente pas moins deux caractères : le jeune homme impatient du frein, l'enfant terrible, séduisant d'ailleurs, fantaisiste et virtuose du mensonge; le père, sorte de Don Diègue par la passion paternelle et le sentiment de l'honneur.
Liens utiles
- Corneille Pierre, 1606-1684, né à Rouen (Seine-Maritime), auteur dramatique français.
- CORNEILLE, Pierre (6 juin 1606-1er octobre 1684) Poète dramatique Corneille naît à Rouen, rue de la Pie.
- CORNEILLE, Pierre (6 juin 1606-1er octobre 1684) Poète dramatique Corneille naît à Rouen, rue de la Pie.
- CORNEILLE, Pierre (6 juin 1606-1er octobre 1684) Poète dramatique Corneille naît à Rouen, rue de la Pie.
- Corneille a dit dans son Premier discours sur le poème dramatique : « Les grands sujets qui remuent fortement les passions et en opposent l'impétuosité aux lois du devoir ou aux tendresses du sang doivent toujours aller au-delà du vraisemblable et ne trouveraient aucune créance parmi les auditeurs s'ils n'étaient soutenus par l'autorité de l'histoire. » Dans quelle mesure cette invraisemblance relative des sujets a-t-elle pu entraîner chez Corneille l'invraisemblance des caractères ?































