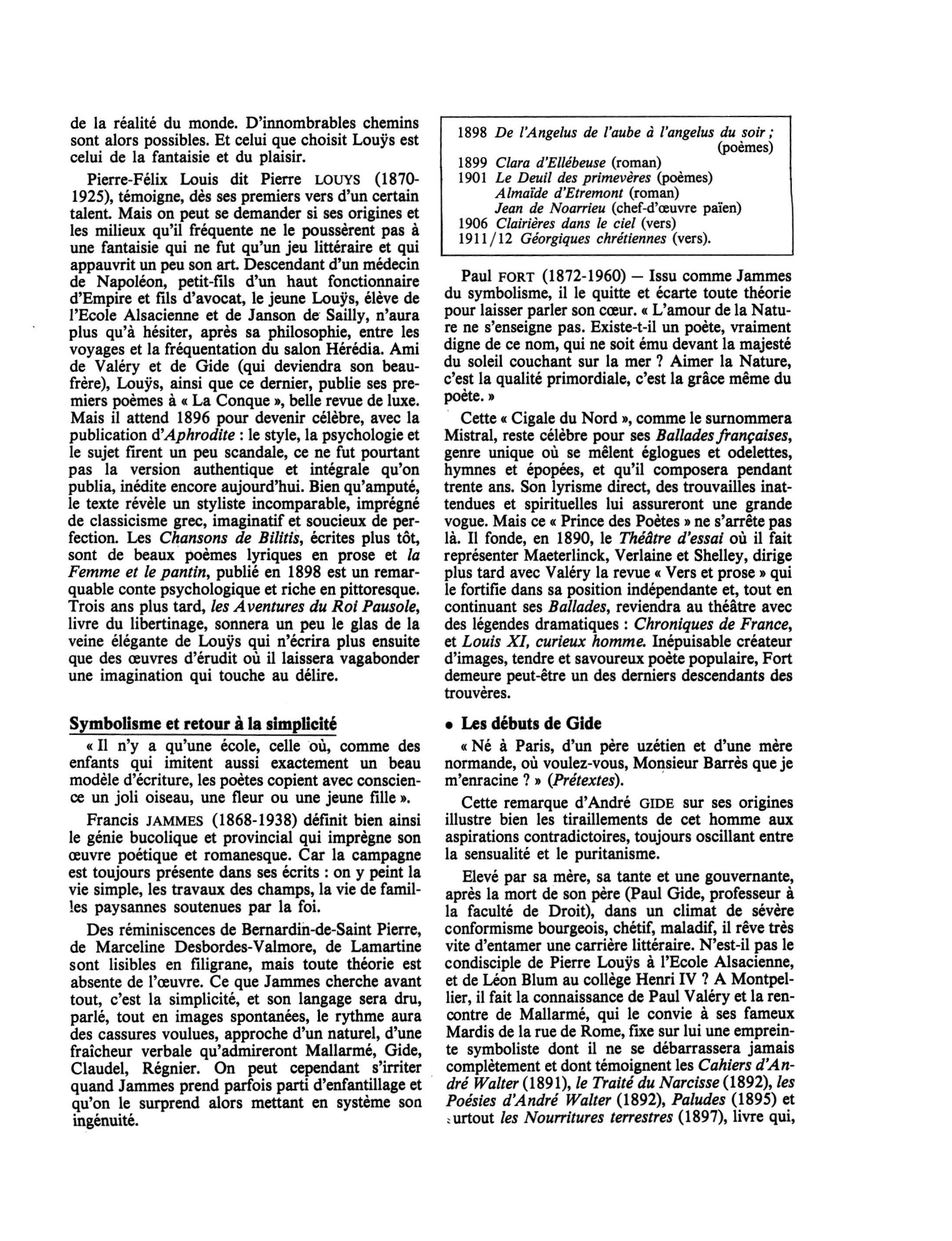La littérature en début du XXe siècle (entre 1900 et 1930) : HERITAGES ET MODERNITES
Publié le 21/11/2011
Extrait du document
Dans tous les domaines, en politique mais aussi en philosophie, en sciences, en littérature et dans tous les arts, ce début de siècle est placé sous le signe de !'ambivalence, dramatiquement accentuée par l'accélération du progrès. Blériot traverse la Manche le 25 juillet 1909, mais la province vit toujours à l'heure de la voiture à cheval. Le grand penseur de l'époque est encore aux yeux des bourgeois le très positif Hippolyte Taine (mort en "1893) et il reste de bon ton d'aimer la peinture de Bouguereau, la musique de Massenet et les sages romans de Georges Ohnet. Et pourtant, au même moment, des choses capitales sont en train de se passer : Nietzsche meurt en 1900, payant par la folie sa vision d'un monde sans Dieu ; à Vienne, la même année, dans le silence de son cabinet, Freud achève la rédaction de la Science des Rêves où se trouve déjà énoncé le principe de la doctrine psychanalytique ; en 1907, Picasso - chaudement soutenu par Apollinaire - bouleverse nos conceptions de l'art en peignant les Demoiselles d'A vignon ; six ans plus tard, au théâtre des Champs-Elysées, Stravinski fait scandale en faisant exécuter le Sacre du Printemps.
«
de la réalité du monde.
D'innombrables chemins
sont alors possibles.
Et celui que choisit Louys est
celui de la fantaisie et du plaisir.
Pierre -Félix Louis dit
Pierre LOUYS (1870- 1925), témoigne, dès ses premiers vers d'un certain
talent.
Mais on peut se demander si ses origines et
les milieux qu'il fréquente ne le poussèrent pas à
une fantaisie qui ne fut qu'un jeu littéraire et qui
appauvrit un peu son art.
Descendant d'un médecin de Napoléon, petit-fils d'un haut fonctionnaire
d'Empire et fils d'avocat, le jeune Louys, élève de l'Ecole Alsacienne et de Janson de Sailly, n'aura
plus qu'à hésiter, après sa philosophie, entre les voyages et la fréquentation du salon Hérédia.
Ami de Valéry et de Gide (qui deviendra son beau
frère), Louys, ainsi que ce dernier, publie ses pre
miers poèmes à « La Conque », belle revue de luxe.
Mais il attend 1896 pour devenir célèbre, avec la
publication d'Aphrodite : le style, la psychologie et le sujet firent un peu scandale, ce ne fut pourtant
pas la version authentique et intégrale qu'on
publia, inédite encore aujourd'hui.
Bien qu'amputé,
le texte révèle un styliste incomparable, imprégné
de classicisme grec, imaginatif et soucieux de per
fection.
Les Chansons de Bilitis, écrites plus tôt,
sont de beaux poèmes lyriques en prose et la Femme et le pantin, publié en 1898 est un remar
quable conte psychologique et riche en pittoresque.
Trois ans plus tard,
les A ventures du Roi Pausole, livre du libertinage, sonnera un peu le glas de la
veine élégante de Louys qui n'écrira plus ensuite
que des œuvres d'érudit où il laissera vagabonder
une imagination qui touche au délire.
Symbolisme et retour à la simplicité
« Il n'y a qu'une école, celle où, comme des
enfants qui imitent aussi exactement un beau
modèle d'écriture,
les poètes copient avec conscien ce un joli oiseau, une fleur ou une jeune fille ».
Francis JAMMES (1868-1938) définit bien ainsi le génie bucolique et provincial qui imprègne son
œuvre poétique et romanesque.
Car la campagne
est toujours présente dans
ses écrits : on y peint la vie simple, les travaux des champs, la vie de famil les paysannes soutenues par la foi.
Des réminiscences de Bernardiil-de -Saint Pierre, de Marceline Des bordes- V almore, de Lamartine
sont lisibles en filigrane, mais toute théorie est
absente
de l'œuvre.
Ce que Jammes cherche avant
tout, c'est la simplicité, et son langage sera dru, parlé, tout en images spontanées, le rythme aura
des cassures voulues, approche d'un naturel, d'une
fraîcheur verbale qu'admireront Mallarmé, Gide,
Claudel, Régnier.
On peut cependant s'irriter
quand Jammes prend parfois parti d'enfantillage et
qu'on
le surprend alors mettant en système son
ingénuité.
1898 De l'Angelus de l'aube à l'angelus du soir; (poèmes)
1899 Clara d'Ellébeuse (roman) 1901 Le Deuil des primevères (poèmes) Almaïde d'Etremont (roman) Jean de Noa"ieu (chef-d'œuvre païen) 1906 Clairières dans le ciel (vers) 1911 /12 Géorgiques chrétiennes (vers).
Paul FORT (1872-1960)- Issu comme Jammes du symbolisme, il le quitte et écarte toute théorie
pour laisser parler son cœur.« L'amour de la Natu re ne s'enseigne pas.
Existe-t-il un poète, vraiment
digne de ce nom, qui ne soit ému devant la majesté
du soleil couchant sur la mer? Aimer la Nature,
c'est la qualité primordiale, c'est la grâce même du
poète
.•
Cette « Cigale du Nord », comme le surnommera
Mistral, reste célèbre pour ses Ballades françaises, genre unique où se mêlent églogues et odelettes,
hymnes et épopées, et qu'il composera pendant
trente ans.
Son lyrisme direct, des trouvailles inat
tendues et spirituelles lui assureront une grande
vogue.
Mais ce « Prince des Poètes » ne s'arrête pas
là.
Il fonde, en 1890, le Théâtre d'essai où il fait
représenter Maeterlinck, Verlaine et Shelley, dirige
plus tard
avec Valéry la revue « Vers et prose » qui le fortifie dans sa position indépendante et, tout en
continuant ses Ballades, reviendra au théâtre avec des légendes dramatiques : Chroniques de France, et Louis Xl, curieux homme.
Inépuisable créateur
d'images, tendre et savoureux poète populaire, Fort
demeure peut-être un
des derniers descendants des
trouvères.
• Les débuts de Gide
« Né à Paris, d'un père uzétien et d'une mère
normande, où voulez-vous, Mo~sieur Barrès que je
m'enracine ? ,.
(Prétextes) .
Cette remarque d'André GIDE sur ses origines
illustre bien les tiraillements de cet homme aux
aspirations contradictoires, toujours oscillant entre
la sensualité et
le puritanisme.
Elevé par sa mère, sa tante et une gouvernante,
après la mort de son père (Paul Gide, professeur à
la faculté de Droit), dans un climat de sévère
conformisme bourgeois, chétif, maladif, il rêve très
vite d'entamer une carrière littéraire.
N'est-il pas le condisciple de Pierre Louys à l'Ecole Alsacienne,
et de Léon Blum au collège Henri IV ? A Montpel
lier, il fait la connaissance de Paul Valéry et la ren
contre de Mallarmé, qui le convie à ses fameux
Mardis de la rue de Rome, fixe sur lui une emprein te symboliste dont il ne se débarrassera jamais
complètement et dont témoignent les Cahiers d'An
dré Walter (1891), le Traité du Narcisse (1892), les
Poésies d'André Walter (1892), Paludes (1895) et , urtout les Nourritures terrestres ( 1897), livre qui,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- Harnack, Adolf von Harnack, Adolf von (1851-1930), théologien et historien allemand dont les ouvrages critiques sur l'histoire ancienne de l'Église ont eu une influence marquante sur la théologie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
- La littérature britannique du XXe siècle par Alan Chatham de Bolivar En
- La littérature du Moyen-Orient au XXe siècle par Alan Chatham de Bolivar Le roman est un genre littéraire relativement récent dans la littérature arabe plus marquée par le conte ou la poésie, qui induisent une rupture par rapport aux formes classiques.
- Littérature d'Afrique Noire par Lamine Diakhaté Dakar La première moitié du XXe siècle aura été celle des mutations intégrales.