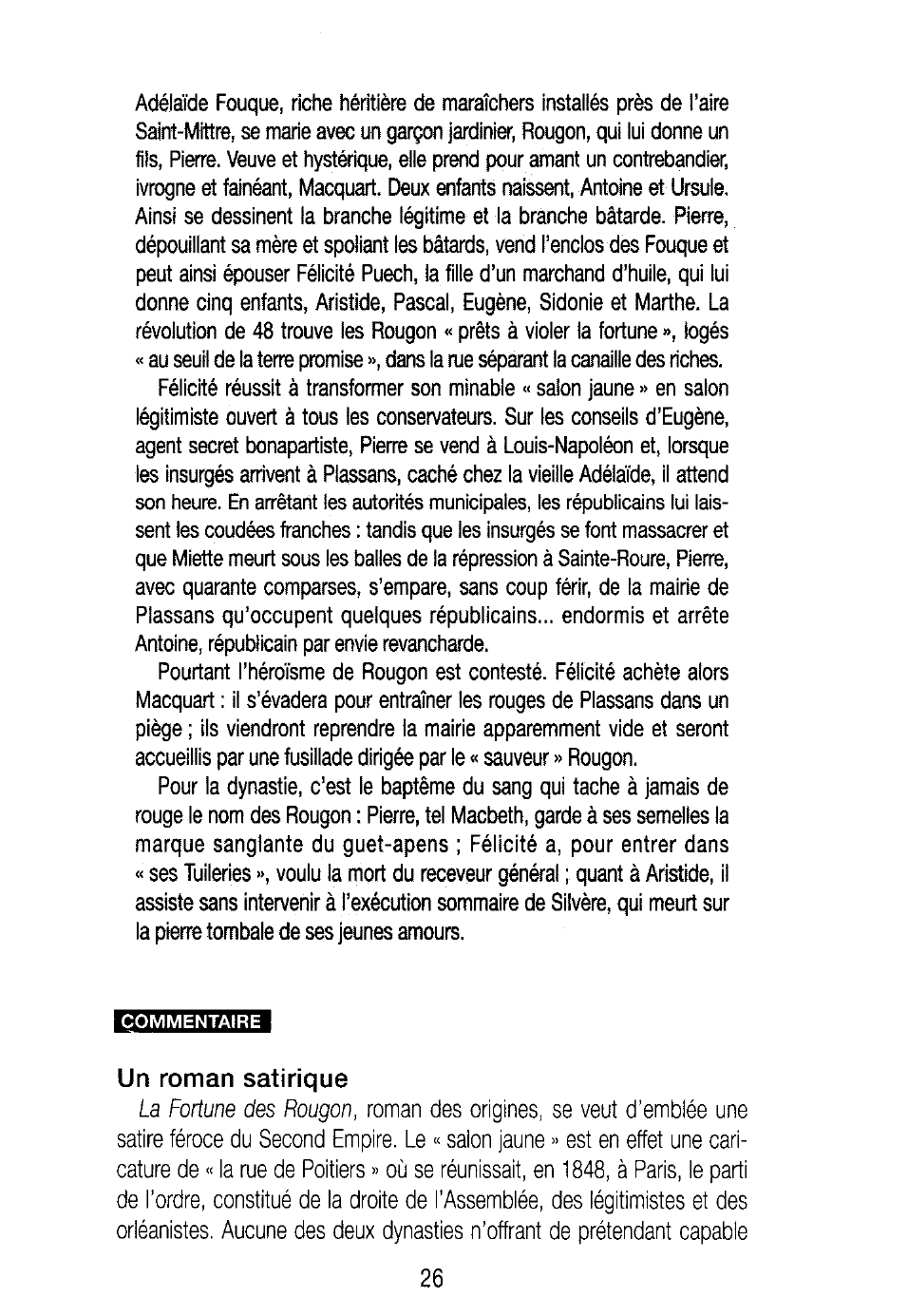LA SAGA DES ROUGON-MACQUART
Publié le 12/01/2015

Extrait du document
«
Adélaïde Fouque, riche héritière de maraîchers installés près de l'aire
Saint-Mittre, se marie avec un garçon jardinier, Rougon, qui lui donne un
fils, Pierre.
Veuve et hystérique, elle prend pour amant un contrebandier,
ivrogne et fainéant, Macquart.
Deux enfants naissent, Antoine et Ursule.
Ainsi se dessinent la branche légitime et la branche bâtarde.
Pierre,
dépouillant sa mère et spoliant les bâtards, vend l'enclos des Fouque et
peut ainsi épouser Félicité Puech, la fille d'un marchand d'huile, qui lui
donne cinq enfants, Aristide, Pascal, Eugène, Sidonie et Marthe.
La
révolution de 48 trouve les Rougon " prêts à violer la fortune», logés
«au seuil de la terre promise"• dans la rue séparant la canaille des riches.
Félicité réussit à transformer son minable " salon jaune ,, en salon
légitimiste ouvert à tous les conservateurs.
Sur les conseils d'Eugène,
agent secret bonapartiste, Pierre se vend à Louis-Napoléon et, lorsque
les insurgés arrivent à Plassans, caché chez la vieille Adélaïde, il attend
son heure.
En arrêtant les autorités municipales, les républicains lui lais
sent les coudées franches : tandis que les insurgés se font massacrer et
que Miette meurt sous les balles de la répression à Sainte-Roure, Pierre,
avec quarante comparses, s'empare, sans coup férir, de la mairie de
Plassans qu'occupent quelques républicains ...
endormis et arrête
Antoine, républicain par envie revancharde.
Pourtant l'héroïsme de Rougon est contesté.
Félicité achète alors
Macquart : il s'évadera pour entraîner les rouges de Plassans dans un
piège ; ils viendront reprendre la mairie apparemment vide et seront
accueillis par une fusillade dirigée par le « sauveur » Rougon.
Pour la dynastie, c'est le baptême du sang qui tache à jamais de
rouge le nom des Rougon : Pierre, tel Macbeth, garde à ses semelles la
marque sanglante du guet-apens ; Félicité a, pour entrer dans
"ses Tuileries"• voulu la mort du receveur général; quant à Aristide, il
assiste sans intervenir à l'exécution sommaire de Silvère, qui meurt sur
la pierre tombale de ses jeunes amours.
COMMENTAIRE
Un roman satirique
La Fortune des Rougon, roman des origines, se veut d'emblée une
satire féroce du Second Empire.
Le " salon jaune ,, est en effet une cari
cature de " la rue de Poitiers ,, où se réunissait, en 1848, à Paris, le parti
de l'ordre, constitué de la droite de l'Assemblée, des légitimistes et des
orléanistes.
Aucune des deux dynasties n'offrant de prétendant capable
26.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rougon-Macquart
- ROUGON-MaCQUART (les)
- Le personnage de COUPEAU Gervaise d’Emile Zola les Rougon-Macquart
- SOUVARINE. Personnage de la série romanesque d’Émile Zola les Rougon-Macquart
- SACCARD (Aristide Rougon dit) d'Emile Zola les Rougon-Macquart