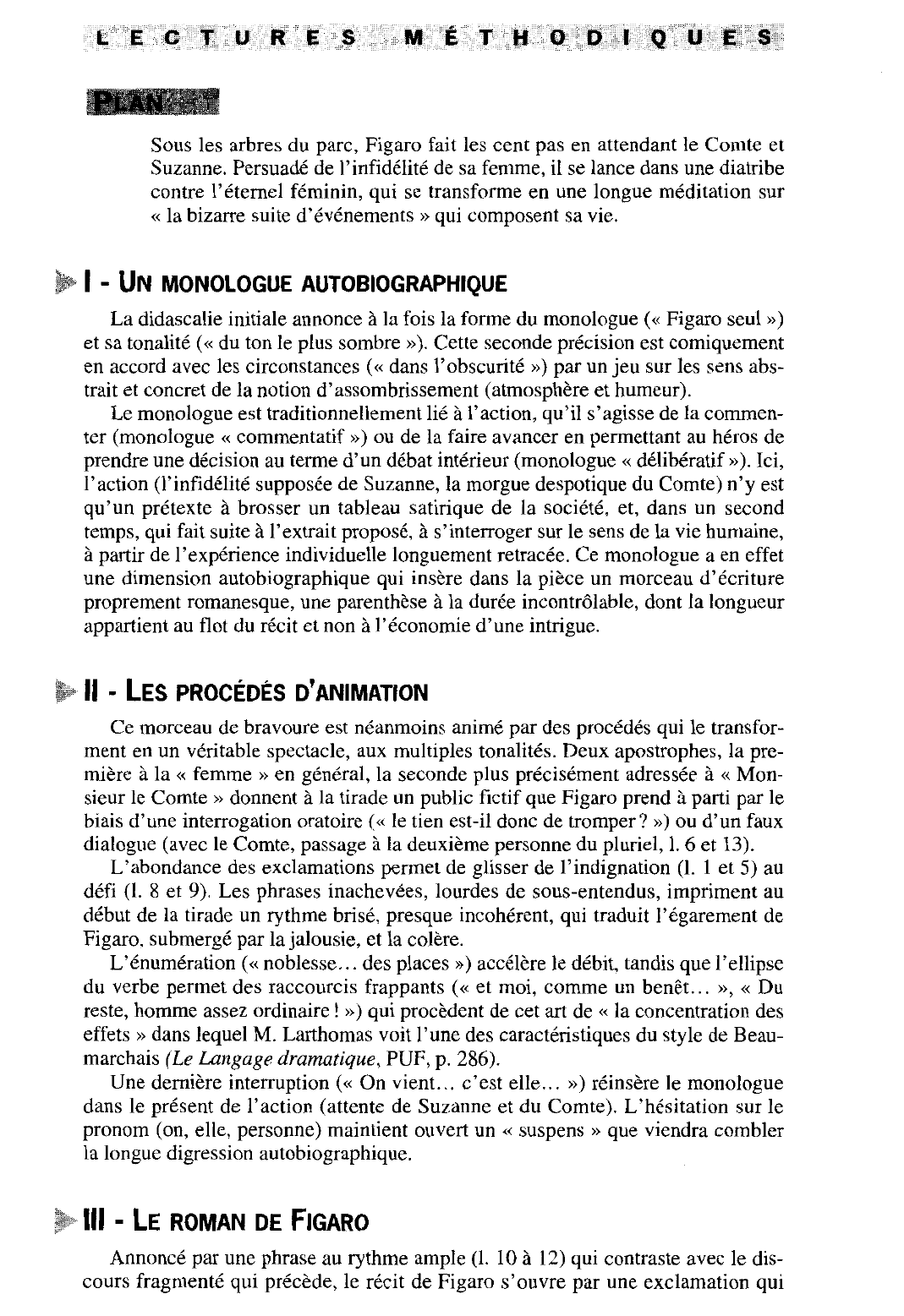Le Mariage de Figaro (Acte V, scène 3)
Publié le 15/03/2015

Extrait du document
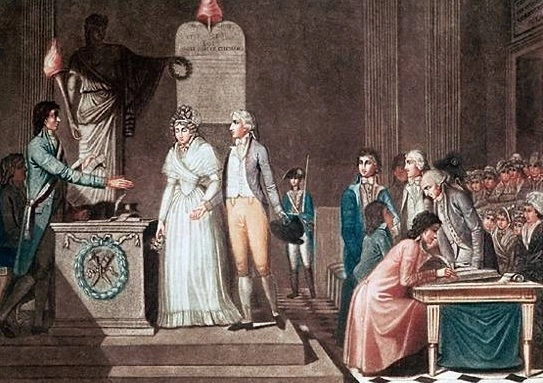
FIGARO, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre :
· 1 Ô femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul animal créé
· ne peut manquer à son instinct ; le tien est-il donc de tromper ?... Après •
m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse ; à •
· l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie... Il
· 5 riait en lisant, le perfide ! et moi comme un benêt... ! non, Monsieur le
· Comte, vous ne l'aurez pas... vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un •
grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !... noblesse, fortune, un •
· rang, des places; tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens !
· vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste homme
· 10 assez ordinaire ! tandis que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, il •
m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, •
· qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes ; et vous
· voulez jouter... On vient... c'est elle... ce n'est personne. — La nuit est
· noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari quoique je ne le sois
•
· 15 qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma des‑
· tinée ! fils de je ne sais pas qui ; volé par des bandits, élevé dans leurs moeurs,
· je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis re‑
· poussé ! J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit
•
d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette de vétéri‑
•
· 20 naire ! — Las d'attrister les bêtes malades, et pour faire un métier contraire,
· je me jette à corps perdu dans le théâtre; me fussé-je mis une pierre au cou!
· Je broche une comédie dans les moeurs du sérail ; auteur espagnol, je crois •
pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule : à l'instant un envoyé... de je ne •
· sais où se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime Porte, la Perse, une
· 25 partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de
· Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc : et voilà ma comédie flambée pour
•
plaire aux princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous
•
· meurtrissent l'omoplate en nous disant : Chiens de chrétiens ! — Ne pouvant
· avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. — Mes joues creusaient ; mon
· 30 terme était échu ; je voyais de loin arriver l'affreux recors, la plume fichée
•
dans sa perruque ; en frémissant je m'évertue. Il s'élève une question sur la
•
· nature des richesses ; et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses
· pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur
· son produit net; sitôt je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont
· 35 d'un château fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. (Il se •
· lève.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers
· sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! je
· lui dirais... que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux ou
· l'on en gêne le cours ; que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge •
· 40 flatteur ; et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.
· (Il se rassied.)
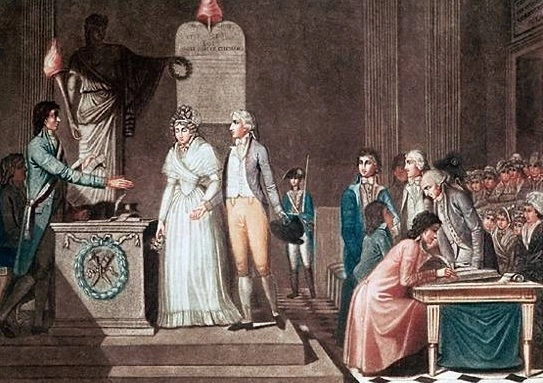
«
L E C T U R E $ MÉTHODIQUES
Sous les arbres du parc, Figaro fait les cent pas en attendant le Comte et
Suzanne.
Persuadé
de l'infidélité de sa femme,
il se lance dans une diatribe
contre l'éternel féminin, qui se transforme en une longue méditation sur
«la bizarre suite d'événements» qui composent sa vie.
1 -UN MONOLOGUE AUTOBIOGRAPHIQUE
La didascalie initiale annonce à la fois la forme du monologue ( « Figaro seul »)
et sa tonalité ( « du ton le plus sombre » ).
Cette seconde précision est comiquement
en accord avec les circonstances (
« dans l'obscurité ») par un jeu sur les sens abs
trait et concret de la notion d'assombrissement (atmosphère et humeur).
Le monologue est traditionnellement lié
à l'action, qu'il s'agisse de la commen
ter (monologue
« commentatif ») ou de la faire avancer en permettant au héros de
prendre une décision au terme d'un débat intérieur (monologue «délibératif»).
Ici,
l'action (l'infidélité supposée de
Suzanne, la morgue despotique du Comte) n'y est
qu'un prétexte à brosser un tableau satirique de la société, et, dans un second
temps, qui fait suite
à l'extrait proposé, à s'interroger sur le sens de la vie humaine, à partir de l'expérience individuelle longuement retracée.
Ce monologue a en effet
une dimension autobiographique qui insère dans la pièce un morceau d'écriture
proprement romanesque, une parenthèse
à la durée incontrôlable, dont la longueur
appartient au flot du récit et non
à l'économie d'une intrigue.
Il -LES PROCÉDÉS D'ANIMATION
Ce morceau de bravoure est néanmoins animé par des procédés qui Je transfor
ment en un véritable spectacle, aux multiples tonalités.
Deux apostrophes, la pre
mière
à la « femme » en général, la seconde plus précisément adressée à « Mon
sieur le Comte
» donnent à la tirade un public fictif que Figaro prend à parti par le
biais d'une interrogation oratoire(« Je tien est-il donc de tromper?») ou d'un faux
dialogue (avec le Comte, passage
à la deuxième personne du pluriel, 1.
6 et 13).
L'abondance des exclamations permet de glisser de l'indignation (1.
1 et 5) au
défi
(1.
8 et 9).
Les phrases inachevées, Jourdes de sous-entendus, impriment au
début de la tirade un rythme brisé, presque incohérent, qui traduit
légarement de
Figaro, submergé par la jalousie, et la colère.
L'énumération(« noblesse
...
des places») accélère le débit, tandis que l'ellipse
du verbe permet des raccourcis frappants (
« et moi, comme un benêt ...
», « Du
reste, homme assez ordinaire
! ») qui procèdent de cet art de « la concentration des
effets» dans lequel M.
Larthomas voit l'une des caractéristiques du style de Beau
marchais
(Le Langage dramatique, PUF, p.
286).
Une dernière interruption(« On vient ...
c'est elle ...
») réinsère le monologue
dans
Je présent de l'action (attente de Suzanne et du Comte).
L'hésitation sur le
pronom (on, elle, personne) maintient ouvert un «suspens » que viendra combler
la longue digression autobiographique.
Ill -LE ROMAN DE FIGARO
Annoncé par une phrase au rythme ample (1.
10 à 12) qui contraste avec Je dis
cours fragmenté qui précède,
Je récit de Figaro s'ouvre par une exclamation qui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le mariage de Figaro Beaumarchais Acte V scène 6
- LA 1 : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1784, acte I, scène
- Le Mariage du Figaro Beaumarchais Acte V, scène 3 Non, Monsieur le Comte, vous ne l'aurez pas.
- Mariage de Figaro Acte I Scène I
- Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, Acte I Scène 1