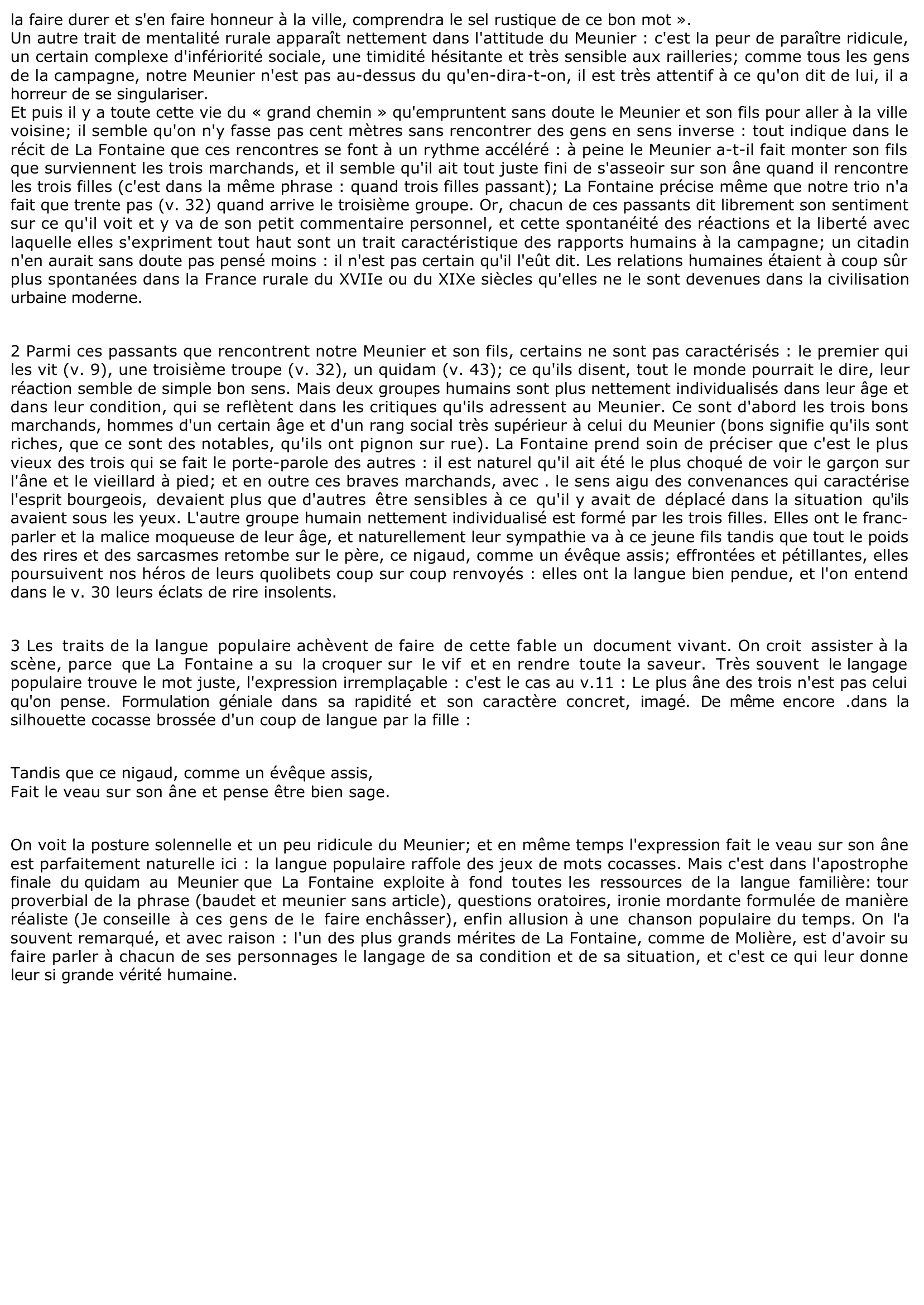LE MEUNIER, SON FILS ET L'ANE (FABLES DE LA FONTAINE) - COMMENTAIRE
Publié le 06/05/2011

Extrait du document
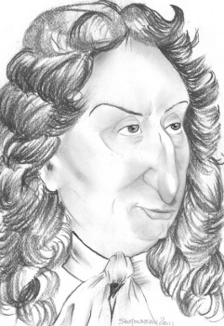
A L'élargissement du cadre de la fable
Cette fable est d'une longueur inhabituelle pour le premier recueil, et tout à fait insolite : on est loin de l'apologue ésopique et de sa sèche leçon, loin aussi de l'élégante concision de Phèdre qui passait au XVIIe siècle pour la règle du genre. C'est que la fable change ici de nature; elle devient un genre composite, aux frontières mal définies, qui englobe à la fois le conte et l'épître. En effet, si Le Meunier, son Fils et l'Ane reste une fable. dans sa structure fondamentale (récit d'abord, puis leçon qui s'en dégage) et si la moralité filiale relève essentiellement de l'esthétique de la fable comme genre didactique, pour le reste c'est à la fois un conte et une épître.
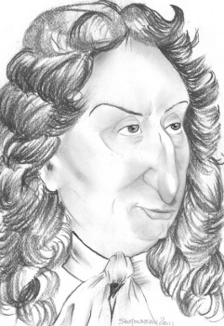
«
la faire durer et s'en faire honneur à la ville, comprendra le sel rustique de ce bon mot ».Un autre trait de mentalité rurale apparaît nettement dans l'attitude du Meunier : c'est la peur de paraître ridicule,un certain complexe d'infériorité sociale, une timidité hésitante et très sensible aux railleries; comme tous les gensde la campagne, notre Meunier n'est pas au-dessus du qu'en-dira-t-on, il est très attentif à ce qu'on dit de lui, il ahorreur de se singulariser.Et puis il y a toute cette vie du « grand chemin » qu'empruntent sans doute le Meunier et son fils pour aller à la villevoisine; il semble qu'on n'y fasse pas cent mètres sans rencontrer des gens en sens inverse : tout indique dans lerécit de La Fontaine que ces rencontres se font à un rythme accéléré : à peine le Meunier a-t-il fait monter son filsque surviennent les trois marchands, et il semble qu'il ait tout juste fini de s'asseoir sur son âne quand il rencontreles trois filles (c'est dans la même phrase : quand trois filles passant); La Fontaine précise même que notre trio n'afait que trente pas (v.
32) quand arrive le troisième groupe.
Or, chacun de ces passants dit librement son sentimentsur ce qu'il voit et y va de son petit commentaire personnel, et cette spontanéité des réactions et la liberté aveclaquelle elles s'expriment tout haut sont un trait caractéristique des rapports humains à la campagne; un citadinn'en aurait sans doute pas pensé moins : il n'est pas certain qu'il l'eût dit.
Les relations humaines étaient à coup sûrplus spontanées dans la France rurale du XVIIe ou du XIXe siècles qu'elles ne le sont devenues dans la civilisationurbaine moderne.
2 Parmi ces passants que rencontrent notre Meunier et son fils, certains ne sont pas caractérisés : le premier quiles vit (v.
9), une troisième troupe (v.
32), un quidam (v.
43); ce qu'ils disent, tout le monde pourrait le dire, leurréaction semble de simple bon sens.
Mais deux groupes humains sont plus nettement individualisés dans leur âge etdans leur condition, qui se reflètent dans les critiques qu'ils adressent au Meunier.
Ce sont d'abord les trois bonsmarchands, hommes d'un certain âge et d'un rang social très supérieur à celui du Meunier (bons signifie qu'ils sontriches, que ce sont des notables, qu'ils ont pignon sur rue).
La Fontaine prend soin de préciser que c'est le plusvieux des trois qui se fait le porte-parole des autres : il est naturel qu'il ait été le plus choqué de voir le garçon surl'âne et le vieillard à pied; et en outre ces braves marchands, avec .
le sens aigu des convenances qui caractérisel'esprit bourgeois, devaient plus que d'autres être sensibles à ce qu'il y avait de déplacé dans la situation qu'ilsavaient sous les yeux.
L'autre groupe humain nettement individualisé est formé par les trois filles.
Elles ont le franc-parler et la malice moqueuse de leur âge, et naturellement leur sympathie va à ce jeune fils tandis que tout le poidsdes rires et des sarcasmes retombe sur le père, ce nigaud, comme un évêque assis; effrontées et pétillantes, ellespoursuivent nos héros de leurs quolibets coup sur coup renvoyés : elles ont la langue bien pendue, et l'on entenddans le v.
30 leurs éclats de rire insolents.
3 Les traits de la langue populaire achèvent de faire de cette fable un document vivant.
On croit assister à lascène, parce que La Fontaine a su la croquer sur le vif et en rendre toute la saveur.
Très souvent le langagepopulaire trouve le mot juste, l'expression irremplaçable : c'est le cas au v.11 : Le plus âne des trois n'est pas celuiqu'on pense.
Formulation géniale dans sa rapidité et son caractère concret, imagé.
De même encore .dans lasilhouette cocasse brossée d'un coup de langue par la fille :
Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis,Fait le veau sur son âne et pense être bien sage.
On voit la posture solennelle et un peu ridicule du Meunier; et en même temps l'expression fait le veau sur son âneest parfaitement naturelle ici : la langue populaire raffole des jeux de mots cocasses.
Mais c'est dans l'apostrophefinale du quidam au Meunier que La Fontaine exploite à fond toutes les ressources de la langue familière: tourproverbial de la phrase (baudet et meunier sans article), questions oratoires, ironie mordante formulée de manièreréaliste (Je conseille à ces gens de le faire enchâsser), enfin allusion à une chanson populaire du temps.
On l'asouvent remarqué, et avec raison : l'un des plus grands mérites de La Fontaine, comme de Molière, est d'avoir sufaire parler à chacun de ses personnages le langage de sa condition et de sa situation, et c'est ce qui leur donneleur si grande vérité humaine..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire littéraire - Jean de la Fontaine : Le pouvoir des fables
- Jean de LA FONTAINE, Les Fables, « Le Jardinier et son Seigneur ». Commentaire composé
- Jean de La Fontaine, « Les Obsèques de la lionne », Fables, VIII, 14 - Commentaire composé
- "Les deux pigeons" - Fables de La Fontaine (Commentaire)
- Jean de La Fontaine, « Le Singe et le Léopard », Fables, livre IX (commentaire)