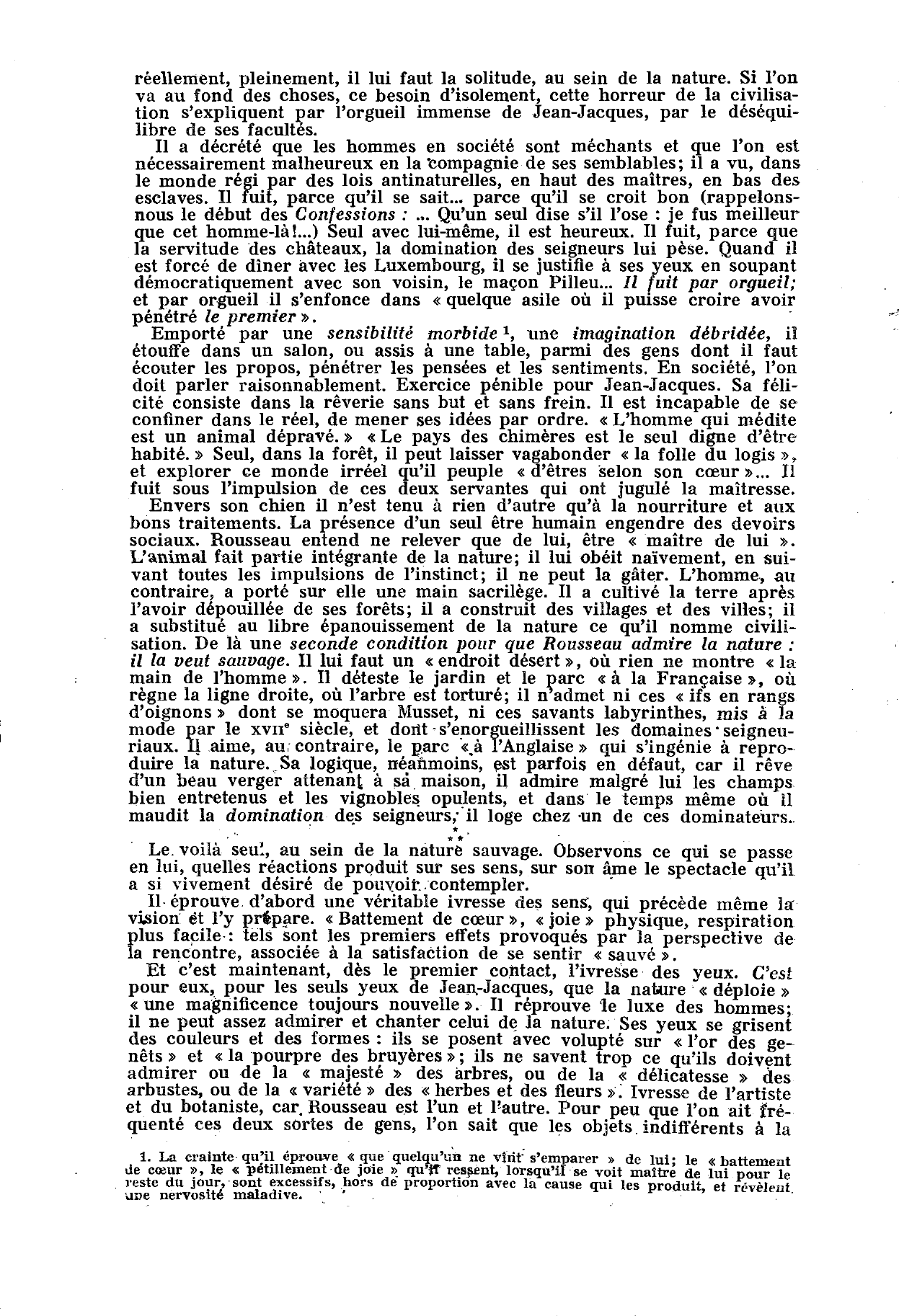Le Sentiment de la Nature chez J.-J. Rousseau.
Publié le 17/02/2012

Extrait du document

Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil avec le fidèle Achate (son chien), pressant le pas, dans la crainte que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi avant que j'eusse pu m'esquiver; mais, quand une fois j'avais pu doubler un certain coin, avec quel battement de coeur, avec quel pétillement de joie je commençais à respirer en me sentant sauvé, en me disant : « Me voilà maître de moi pour le reste de ce jour ! « J'allais alors d'un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la forêt (de Montmorency), quelque lieu désert où rien, en me montrant la main des hommes, n'annonçât la servitude et la domination, quelque asile où je pusse croire avoir pénétré le premier et où nul tiers importun ne vînt s'interposer entre la nature et moi.

«
reellement, pleinement, it lui faut la solitude, au sein de la nature.
Si l'on
va au fond des choses, ce besoin d'isolement, cette horreur de la civilisa-
tion s'expliquent par Porgueil immense de Jean-Jacques, par le desequi-
libre de ses facultes.
Il a decrete que les hommes en societe sont mechants et que l'on est
necessairement malheureux en in tompagnie de ses semblables; it a vu, dans
le monde regi par des lois antinaturelles, en haut des maitres, en has des
esclaves.
Il fuit, parce qu'il se salt- parce qu'il se croit bon (rappelons-
nous le debut des Confessions : Qu'un seul dise s'il l'ose : je fus meilleur
que cet homme-lal...) Seul avec lui-meme, it est heureux.
Il fuit, parce que
la servitude des chateaux, la domination des seigneurs lui pese.
Quand it
est force de diner avec les Luxembourg, it se justifie a ses yeux en soupant
demoeratiquement avec son voisin, le macon Pilleu...
II fuit par orgueil;
et par orgueil s'enfonce dans « quelque asile oft it puisse croire avoir
penetre le premier Emporte par une sensibilite morbide 1, une imagination debridee, ii
etouffe dans un salon, ou assis a une table, parmi des gens dont il faut
ecouter les propos, penetrer les pensees et les sentiments.
En societe, l'on
doit parler raisonnablement.
Exercice penible pour Jean-Jacques.
Sa feli-
cite consiste dans la reverie sans but et sans frein.
Il est incapable de se
confiner dans le reel, de mener ses idees par ordre.
« L'homme qui medite
est un animal deprave.
» « Le pays des chimeres est le seul digne d'etre
habit& » Seul, dans la foret, it peut laisser vagabonder e la folle du logis »,
et explorer ce monde irreel qu'il peuple « d'etres selon son cceur »...
II
fuit sous 'Impulsion de ces deux servantes qui ont jugule la maitresse.
Envers son chien it n'est tenu a rien d'autre qu'a la nourriture et aux
bons traitements.
La presence d'un seul etre humain engendre des devoirs
sociaux.
Rousseau entend ne relever que de lui, etre c maitre de lui
L'animal fait partie integrante de la nature; it lui obeit naivement, en sui-
vant toutes les impulsions de ''instinct; it ne peut la gater.
L'homme, au
contraire, a poste sur elle une main sacrilege.
II a cultive la terre apres
l'avoir depouillee de ses forets; it a construit des villages et des vines; ii
a substitue au libre epanouissement de la nature ce qu'il nomme civili-
sation.
De la une seconds condition pour que Rousseau admire la nature :
it la veut sauvage.
Ii lui faut un « endroit desert », oil rien ne montre « la
main de l'homme ».
II deteste le jardin et le pare « a la Francaise », oft
regne la ligne droite, oft I'arbre est torture; it n'admet ni ees « ifs en rangs
d'oignons » dont se moquera Musset, ni ces savants labyrinthes, mis a la
mode par le xviie siècle, et dont -s'enorgueillissent les domaines seigneu-
riaux.
Il aime, au contraire, le pare -«.a l'Anglaise » qui s'ingenie a repro-
duire in nature.
Sa logique, neanmoins, est parfois en (Want, car it rove
d'un beau verger attenant a sa maison, it admire malgre lui les champs
bien entretenus et les vignobles opulents, et dans le temps meme on 11
maudit in domination des seigneurs; it loge chez un de ces dominateurs.
Le voila self., au sein de la nature sauvage.
Observons ce qui se passe
en lui, quelles reactions produit sur ses sens, sur son ame le spectacle qu'il
a si vivement desire de pouv.oir contempler.
II eprouve d'abord une veritable ivresse des sens-, qui precede meme la
vision et l'y prttpare.
« Battement de cceur », « joie » physique, respiration
plus facile-: tels sont les premiers effets provoques par la perspective de
la rencontre, associee it la satisfaction de se sentir « sauve ».
Et c'est maintenant, des le premier contact, '' ivresse des yeux.
C'est
pour eux, pour les seals yeux de Jean-Jacques, que la nature « deploie » une magnificence toujours nouvelle ».
Il reprouve le luxe des hommes;ne pent assez admirer et chanter celui de la nature.
Ses yeux se grisent
des couleurs et des formes : ils se posent avec volupte sur « l'or des ge-
nets » et « la pourpre des bruyeres »; ils ne savent trop ce qu'ils doivent
admirer ou de la « majeste » des arbres, ou de la
« delicatesse » des
arbustes, ou de in « variete » des « helloes et des fieurs ».
Ivresse de ''artiste
et du botaniste, car.
Rousseau est l'un et Pautre.
Pour pen que l'on nit ire-
quente ces deux sorter de gens, l'on sait que les objets indifferents it la
1.
La crainte qu'il eprouve e que quelqu'un ne virit s'ernnarer » de lui; le « battement
de cur a, le t -petillement de joie » qu it ressent, lorsqu'it se volt maitre de lui pour le
reste du jour, sont excessifs, hors de proportion avec la cause qui les produit, et r6velent
une nervosite maladive.
'
réellement, pleinement, il lui faut la solitude, au sein de la nature. Si l'on va au fond des choses, ce besoin d'isolement, cette horreur de la civilisa tion s'expliquent par l'orgueil immense de Jean-Jacques, par le déséqui libre de ses facultés.
Il a décrété que les hommes en société sont méchants et que l'on est
nécessairement malheureux en la "compagnie de ses semblables; il a vu, dans
le monde régi par des lois antinaturelles, en haut des maîtres, en bas des esclaves. Il fuit, parce qu'il se sait...
parce qu'il se croit bon (rappelons-
nous le début des Confessions : ... Qu'un seul dise s'il l'ose : je fus meilleur
que cet homme-là!...) Seul avec lui-même, il est heureux. Il fuit, parce que la servitude des châteaux, la domination des seigneurs lui pèse. Quand il est forcé de dîner avec les Luxembourg, il se justifie à ses yeux en soupant démocratiquement avec son voisin, le maçon Pilleu... Il fuit par orgueil;
et par orgueil il s'enfonce dans « quelque asile où il puisse croire avoir pénétré le premier».
Emporté par une sensibilité morbide1, une imagination débridée, il
étouffe dans un salon, ou assis à une table, parmi des gens dont il faut écouter les propos, pénétrer les pensées et les sentiments. En société, l'on doit parler raisonnablement.
Exercice pénible pour Jean-Jacques. Sa féli
cité consiste dans la rêverie sans but et sans frein. Il est incapable de se confiner dans le réel, de mener ses idées par ordre. « L'homme qui médite est un animal dépravé.
» « Le pays des chimères est le seul digne d'être
habité.
» Seul, dans la forêt, il peut laisser vagabonder « la folle du logis », et explorer ce monde irréel qu'il peuple «d'êtres selon son cœur»...
Il fuit sous l'impulsion de ces deux servantes qui ont jugulé la maîtresse.
Envers son chien il n'est tenu à rien d'autre qu'à la nourriture et aux bons traitements. La présence d'un seul être humain engendre des devoirs
sociaux.
Rousseau entend ne relever que de lui, être « maître de lui ».
L'animal fait partie intégrante de la nature; il lui obéit naïvement, en sui vant toutes les impulsions de l'instinct; il ne peut la gâter. L'homme, au contraire, a porté sur elle une main sacrilège.
Il a cultivé la terre après l'avoir dépouillée de ses forêts; il a construit des villages et des villes; il a substitué au libre épanouissement de la nature ce qu'il nomme civili sation. De là une seconde condition pour que Rousseau admire la nature : il la veut sauvage. Il lui faut un «endroit désert», où rien ne montre «la main de l'homme».
H déteste le jardin et le parc «à la Française», où
règne la ligne droite, où l'arbre est torturé ; il n'admet ni ces « ifs en rangs d'oignons » dont se moquera Musset, ni ces savants labyrinthes, mis à la mode par le xvne siècle, et doiît s'enorgueillissent les domaines * seigneu riaux. Il aime, au contraire, le parc «%à l'Anglaise » qui s'ingénie à repro duire la nature. Sa logique, néanmoins, est parfois en défaut, car il rêve d'un beau verger attenant à sa maison, il admire malgré lui les champs
bien entretenus et les vignobles opulents, et dans le temps même où il
maudit la domination des seigneurs; il loge chez un de ces dominateurs.
*
* * '
Le. voilà seul, au sein de la nature sauvage.
Observons ce qui se passe
en lui, quelles réactions produit sur ses sens, sur son âme le spectacle qu'il a si vivement désiré de pouvoir., contempler.
Il éprouve, d'abord une véritable ivresse des sens, qui précède même la vision et l'y prépare.
«Battement de cœur», «joie» physique, respiration
plus facile : tels sont les premiers effets provoqués par la perspective de la rencontre, associée à la satisfaction de se sentir « sauvé ».
Et c'est maintenant, dès le premier contact, l'ivresse des yeux. C'est pour eux, pour les seuls yeux de Jean.-Jacques, que la nature « déploie »
«une magnificence toujours nouvelle».
Il réprouve le luxe des hommes; il ne peut assez admirer et chanter celui de la nature. Ses yeux se grisent
des couleurs et des formes : ils se posent avec volupté sur « l'or des ge
nêts » et « la pourpre des bruyères » ; ils ne savent trop ce qu'ils doivent admirer ou de la « majesté » des arbres, ou de la « délicatesse » des arbustes, ou de la « variété » des « herbes et des fleurs » i Ivresse de l'artiste
et du botaniste, car Rousseau est l'un et l'autre.
Pour peu que l'on ait fré
quenté ces deux sortes de gens, l'on sait que les objets indifférents à la
1.
La
crainte qu'il éprouve « que quelqu'un ne vint s'emparer » de lui; le «battement vie cœur », le « pétillement de joie » qu*if ressent, lorsqu'il se voit maître de lui pour le reste du jour, sont excessifs, hors de proportion avec la cause qui les produit et révèlent une nervosité maladive. '.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ROUSSEAU ET LE SENTIMENT DE LA NATURE ?
- Le sentiment de la nature et le paysage dans les Rêveries de Rousseau.
- ROUSSEAU: On croit m'embarrasser beaucoup en me demandant à quel point il faut borner le luxe. Mon sentiment est qu'il n'en faut point du tout. Tout est source de mal au-delà du nécessaire physique. La nature ne nous donne que trop de besoins ; et c'est au moins une très haute imprudence de les multiplier sans nécessité, et de mettre, ainsi, son âme dans une plus grande dépendance. Ce n'est pas sans raison que Socrate, regardant l'étalage d'une boutique se félicitait de n'avoir à faire
- D'après cette description de George Sand (au début de Valentine), vous direz quels sont certains des caractères essentiels de ses romans champêtres. Si vous ne connaissez pas ces romans. vous pourrez comparer le sentiment de la nature qui s'y exprime avec ce que vous connaissez du sentiment de la nature chez Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo ( en choisissant un ou plusieurs d'entre eux)
- Que pensez-vous de cette opinion d'un critique américain (Rice) : « Dans l'expression du sentiment de la nature, Rousseau n'est pas artiste, Chateaubriand le sera » ?