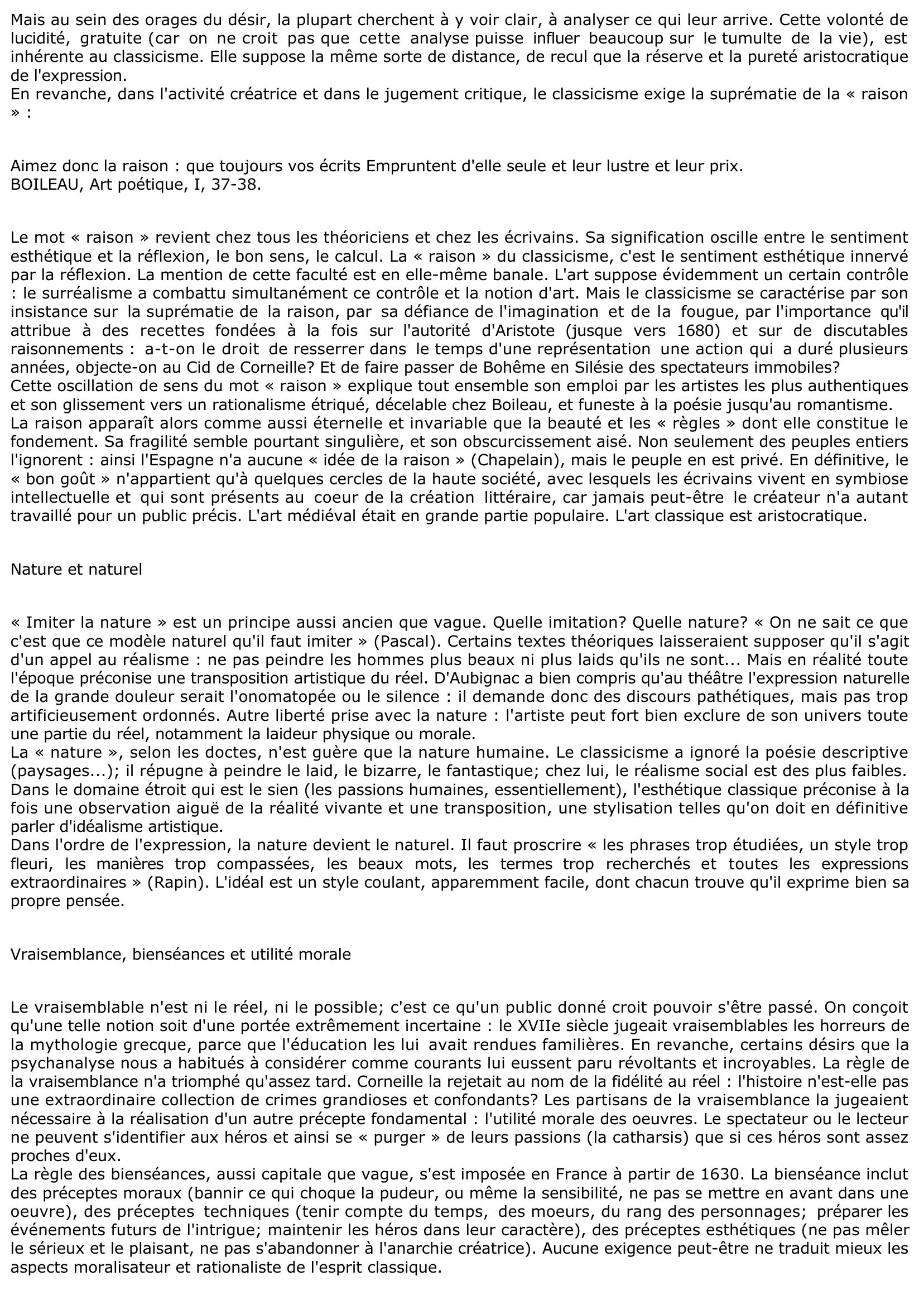LE SIÈCLE DE LOUIS XIV EN LITTERATURE
Publié le 27/05/2011
Extrait du document

Le 9 mars 1661, Louis XIV assume personnellement la direction d'une nation puissante, aux 19 millions de sujets. Il abolit le régime du ministériat et décide seul, conseillé par un état-major essentiellement bourgeois. Il confère à la monarchie « un caractère quasi solaire et pharaonique «, emprunte à l'Espagne les rites d'un cérémonial minutieux, s'efforce de limiter les particularismes en étendant sur le pays un réseau administratif qui durera jusqu'en 1789. Au point de vue social, si l'immense monde rural reste pauvre et menacé par les famines (notamment celle du terrible hiver de 1709) et par les guerres, le fait marquant est l'ascension de la bourgeoisie, qui se rue vers les terres, les « offices « et l'anoblissement. Beaucoup de nobles ne réussissent à échapper à la pauvreté que grâce à de riches mariages bourgeois ou aux faveurs royales. La cour, qui s'installe définitivement à Versailles en 1682, compte 7 000 à 8 000 personnes : gaie au début du règne, l'atmosphère s'y assombrit peu à peu, à mesure que le roi vieillit et devient dévot.

«
Mais au sein des orages du désir, la plupart cherchent à y voir clair, à analyser ce qui leur arrive.
Cette volonté delucidité, gratuite (car on ne croit pas que cette analyse puisse influer beaucoup sur le tumulte de la vie), estinhérente au classicisme.
Elle suppose la même sorte de distance, de recul que la réserve et la pureté aristocratiquede l'expression.En revanche, dans l'activité créatrice et dans le jugement critique, le classicisme exige la suprématie de la « raison» :
Aimez donc la raison : que toujours vos écrits Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.BOILEAU, Art poétique, I, 37-38.
Le mot « raison » revient chez tous les théoriciens et chez les écrivains.
Sa signification oscille entre le sentimentesthétique et la réflexion, le bon sens, le calcul.
La « raison » du classicisme, c'est le sentiment esthétique innervépar la réflexion.
La mention de cette faculté est en elle-même banale.
L'art suppose évidemment un certain contrôle: le surréalisme a combattu simultanément ce contrôle et la notion d'art.
Mais le classicisme se caractérise par soninsistance sur la suprématie de la raison, par sa défiance de l'imagination et de la fougue, par l'importance qu'ilattribue à des recettes fondées à la fois sur l'autorité d'Aristote (jusque vers 1680) et sur de discutablesraisonnements : a-t-on le droit de resserrer dans le temps d'une représentation une action qui a duré plusieursannées, objecte-on au Cid de Corneille? Et de faire passer de Bohême en Silésie des spectateurs immobiles?Cette oscillation de sens du mot « raison » explique tout ensemble son emploi par les artistes les plus authentiqueset son glissement vers un rationalisme étriqué, décelable chez Boileau, et funeste à la poésie jusqu'au romantisme.La raison apparaît alors comme aussi éternelle et invariable que la beauté et les « règles » dont elle constitue lefondement.
Sa fragilité semble pourtant singulière, et son obscurcissement aisé.
Non seulement des peuples entiersl'ignorent : ainsi l'Espagne n'a aucune « idée de la raison » (Chapelain), mais le peuple en est privé.
En définitive, le« bon goût » n'appartient qu'à quelques cercles de la haute société, avec lesquels les écrivains vivent en symbioseintellectuelle et qui sont présents au coeur de la création littéraire, car jamais peut-être le créateur n'a autanttravaillé pour un public précis.
L'art médiéval était en grande partie populaire.
L'art classique est aristocratique.
Nature et naturel
« Imiter la nature » est un principe aussi ancien que vague.
Quelle imitation? Quelle nature? « On ne sait ce quec'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter » (Pascal).
Certains textes théoriques laisseraient supposer qu'il s'agitd'un appel au réalisme : ne pas peindre les hommes plus beaux ni plus laids qu'ils ne sont...
Mais en réalité toutel'époque préconise une transposition artistique du réel.
D'Aubignac a bien compris qu'au théâtre l'expression naturellede la grande douleur serait l'onomatopée ou le silence : il demande donc des discours pathétiques, mais pas tropartificieusement ordonnés.
Autre liberté prise avec la nature : l'artiste peut fort bien exclure de son univers touteune partie du réel, notamment la laideur physique ou morale.La « nature », selon les doctes, n'est guère que la nature humaine.
Le classicisme a ignoré la poésie descriptive(paysages...); il répugne à peindre le laid, le bizarre, le fantastique; chez lui, le réalisme social est des plus faibles.Dans le domaine étroit qui est le sien (les passions humaines, essentiellement), l'esthétique classique préconise à lafois une observation aiguë de la réalité vivante et une transposition, une stylisation telles qu'on doit en définitiveparler d'idéalisme artistique.Dans l'ordre de l'expression, la nature devient le naturel.
Il faut proscrire « les phrases trop étudiées, un style tropfleuri, les manières trop compassées, les beaux mots, les termes trop recherchés et toutes les expressionsextraordinaires » (Rapin).
L'idéal est un style coulant, apparemment facile, dont chacun trouve qu'il exprime bien sapropre pensée.
Vraisemblance, bienséances et utilité morale
Le vraisemblable n'est ni le réel, ni le possible; c'est ce qu'un public donné croit pouvoir s'être passé.
On conçoitqu'une telle notion soit d'une portée extrêmement incertaine : le XVIIe siècle jugeait vraisemblables les horreurs dela mythologie grecque, parce que l'éducation les lui avait rendues familières.
En revanche, certains désirs que lapsychanalyse nous a habitués à considérer comme courants lui eussent paru révoltants et incroyables.
La règle dela vraisemblance n'a triomphé qu'assez tard.
Corneille la rejetait au nom de la fidélité au réel : l'histoire n'est-elle pasune extraordinaire collection de crimes grandioses et confondants? Les partisans de la vraisemblance la jugeaientnécessaire à la réalisation d'un autre précepte fondamental : l'utilité morale des oeuvres.
Le spectateur ou le lecteurne peuvent s'identifier aux héros et ainsi se « purger » de leurs passions (la catharsis) que si ces héros sont assezproches d'eux.La règle des bienséances, aussi capitale que vague, s'est imposée en France à partir de 1630.
La bienséance inclutdes préceptes moraux (bannir ce qui choque la pudeur, ou même la sensibilité, ne pas se mettre en avant dans uneoeuvre), des préceptes techniques (tenir compte du temps, des moeurs, du rang des personnages; préparer lesévénements futurs de l'intrigue; maintenir les héros dans leur caractère), des préceptes esthétiques (ne pas mêlerle sérieux et le plaisant, ne pas s'abandonner à l'anarchie créatrice).
Aucune exigence peut-être ne traduit mieux lesaspects moralisateur et rationaliste de l'esprit classique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture : SIÈCLE DE LOUIS XIV (Le) de Voltaire
- Morale et ordre au siècle de Louis XIV
- Histoire de Charles XII. Le Siècle de Louis XIV. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations (résumé)
- Siècle de LOUIS XIV (le) de Voltaire (résumé et analyse de l'oeuvre)
- SIÈCLE DE LOUIS XIV (Le). de Voltaire (Résumé et analyse)