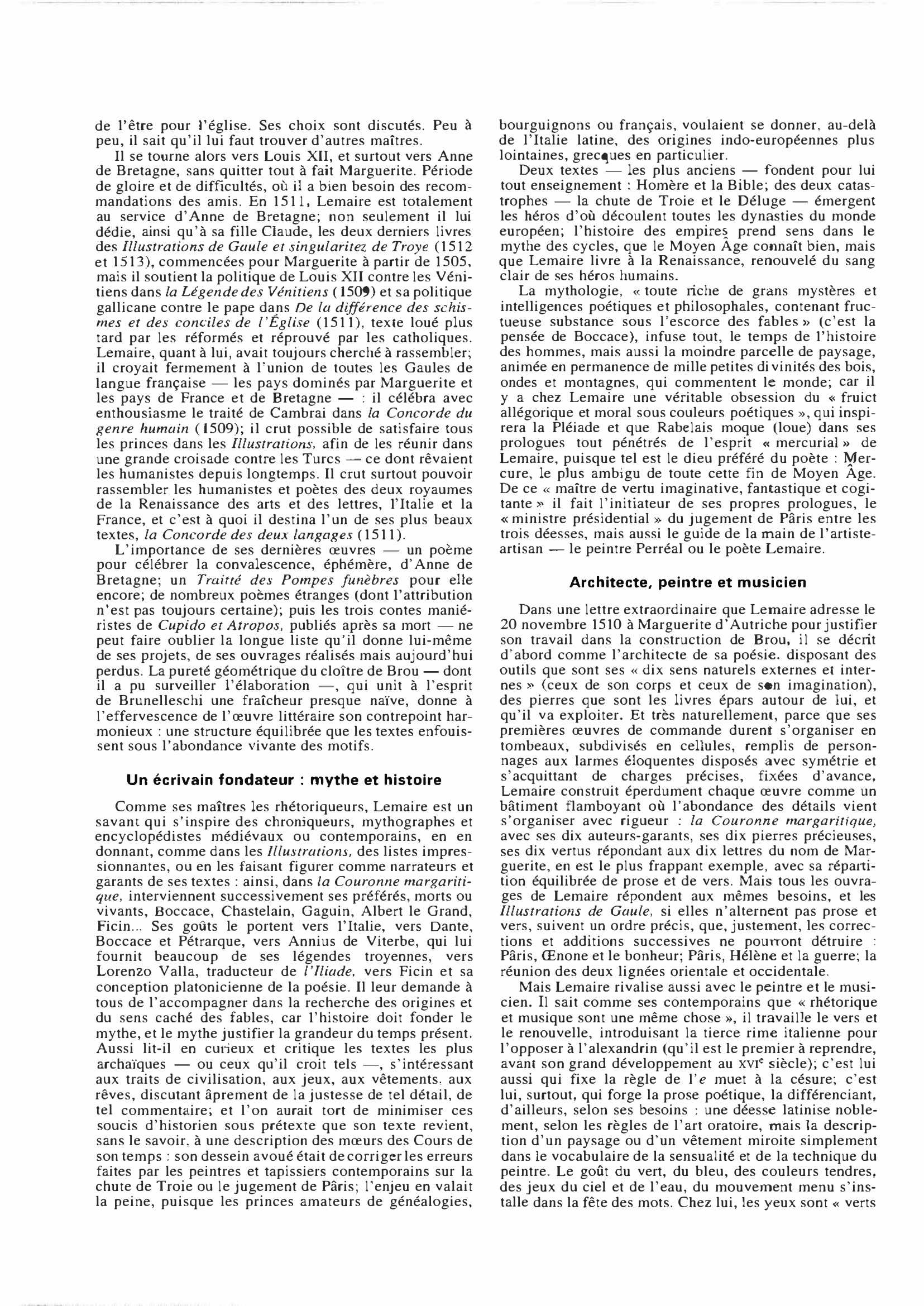LEMAIRE DE BELGES Jean : sa vie et son oeuvre
Publié le 15/01/2019

Extrait du document
LEMAIRE DE BELGES Jean (1473?-apr. 1515). En une dizaine d’années (1503-1515), à un moment où les goûts du Moyen Âge finissant se déforment et explosent dans les premières créations de la Renaissance, le poète Jean Lemaire construit un édifice littéraire qui apparaît prodigieux par sa masse et par les perspectives qu’il offrait aux écrivains à venir. Les Grands Rhétoriqueurs l’ont considéré comme leur fils, et il leur rendit cette affection; il fut également le seul poète de cette période que Marot puis Ronsard — et leurs contemporains respectifs — lurent avec bonheur, tant ils lui surent gré d’avoir été, selon le mot de Du Bellay, « ce diligent rechercheur de l’Antiquité »; ils aimaient aussi en lui les grâces françaises par lesquelles il continuait le Roman de la Rose en renouvelant la prosodie et en créant cette prose poétique dont le xvie siècle fut amateur avec tant de lucidité.
L'art des tombeaux
Né à Bavai, qu’il croyait pouvoir appeler du nom latin de Belgis et qu’il considérait comme le centre de l’ancienne Gaule belgique, Jean Lemaire signe « de Belges » par fidélité à ces origines : elles le plaçaient dans une province bourguignonne, le Hainaut, mais de langue française, et la vie de Lemaire ne résoudra pas cette ambiguïté, même si son œuvre en tire sa richesse. Après la mort de ses parents, il est élevé par son oncle, le grand rhétoriqueur Jean Molinet, qui réside à Valenciennes, ville abondante en poètes; près de lui, Lemaire apprend les manières d’une écriture au service du savoir et du pouvoir. Tonsuré, étudiant à Lille, puis, sans doute, à Paris, il est alors choisi comme précepteur des deux fils du seigneur de Saint-Julien, près de Mâcon : l’un d’eux, Claude, lui restera assez fidèle pour préfacer en 1544 l’énorme Couronne margaritique, composée vers 1505 et oubliée depuis derrière d’« enrouillées serrures ».
A partir de 1498, il entre successivement au service de princes voués à une mort prochaine, et pour lesquels il va cultiver le genre des « tombeaux », éloges funèbres complexes et savants, mais finalement somptueux et gais comme les fêtes dont raffolent les Cours du temps. A la mémoire de Pierre de Bourbon, d’abord — personnage considérable, puisqu’il est l’époux d’Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et ancienne régente du royaume —, qui l’emploie comme « clerc de finances » et meurt en 1503, il écrit son premier chef-d’œuvre, le Temple d'Honneur et de Vertu. A peine devient-il secrétaire d’un cousin d’Anne de Beaujeu, Louis de Luxembourg, que celui-ci meurt à son tour — et il le célèbre par la Plainte du Désiré (1504). Il est alors choisi par la fille de l’empereur Maximilien, Marguerite d’Autriche, digne maîtresse d’un tel serviteur : élevée à la cour de France parce que promise à Charles VIII (qui doit lui préférer Anne de Bretagne), retirée près de son père en Flandre, puis mariée à l’infant d’Espagne, fils de Ferdinand d’Aragon (1495), mais veuve deux ans après, cette malheureuse princesse croit trouver le repos près du beau Philibert de Savoie — frère de Louise de Savoie —, qu’elle épouse en 1501. C’est à ce moment que Lemaire entre à leur service, les suit à Turin, puis à Pont-d’Ain; mais le jeune duc meurt à la suite d’une chasse : Lemaire entreprend un nouvel éloge funèbre, qu’il voue tout entier à sa maî
tresse, louant ses vertus dans les dix pierres précieuses de sa Couronne margaritique (1504-1505). Pour la divertir — et se distraire lui-même de tâches considérables —, il compose la gracieuse Première Épistre de l'amant vert (1505), dans laquelle le perroquet de la duchesse (l’« amant vert ») se donne la mort de chagrin, la voyant éloignée alors en Allemagne. Nouveau deuil pour Marguerite en 1506 (et nouveau poème funèbre pour Lemaire) : la mort de son frère Philippe, père du futur Charles Quint, dont Marguerite devient tutrice; s’ensuivent les Regrets de la dame infortunée sur le trépas de son très cher frère... Marguerite est alors retirée dans sa Cour de Malines, où Lemaire la rejoint en 1507; il devient chanoine à Valenciennes, comme son oncle Molinet, qu’il voit mourir, et auquel il reprend la charge d’« indiciaire » et d’historiographe de Marguerite. Il lui incombe alors de célébrer et décrire la Pompe funeralle des obsèques de [...] Philippe de Castille (1507) et, peu après, de glorifier dans les Chansons de Namur la résistance de paysans flamands à des troupes françaises.
Citoyen de la langue française et voyageur
En même temps qu’il servait ses maîtres, Lemaire ne cessait de tisser des relations avec les amis de son oncle — Guillaume Crétin le recommande dès 1498 — et avec les milieux humanistes et artistiques en pleine mutation, et sensibles aux influences italiennes. Il a, dès les premières années, été attiré par Lyon et se fixe momentanément tout près de celle-ci dans la joyeuse ville universitaire de Dole (1509) : toute une partie, vivante ou drôle, de sa correspondance le montre lié d’amitié avec le médecin platonisant Symphorien Champier, avec le peintre Jean Perréal, dit Jean de Paris, employé lui aussi par la duchesse Marguerite. Bien d’autres garderont son souvenir, y compris, sans doute, les imprimeurs lyonnais auxquels il donne ses premières œuvres, revendiquant ainsi, et peut-être pour la première fois dans les lettres françaises, l’indépendance de l’artiste et son droit à publier même avec précipitation.
Mais, depuis 1504, Marguerite songeait pour Philibert de Savoie à un autre tombeau, bien réel celui-là : celui des cloîtres, église et monuments de Brou — vaste programme, par lequel elle s’immortalise plus encore que par les vers de ses poètes. Jean Lemaire, qui invente pour elle la devise « Fortune Infortune Fort Une », répétée partout sur la pierre, est aussi chargé de superviser les travaux, à la manière italienne et humaniste. Pour cette raison sans doute, il est envoyé en Italie en 1506 : Venise, Rome, Florence peut-être. Il y fait provision d’images, de livres, d’idées, d’expériences dans les techniques les plus variées. Il séjourne de nouveau en Italie en 1508. On le voit à Tours, où il passe commande au sculpteur Michel Colombes; en Bourgogne, où il surveille l’extraction de l’albâtre pour les gisants de Brou; à Brou, où il ne cesse de se quereller avec les moines qui occupent les lieux, etc. Son impatience curieuse le mène dans l’atelier des peintres, des maîtres verriers; il patauge dans la bouc pour trouver les veines de l’albâtre le plus pur, relance les ouvriers, les contrôle, les paye. Maître d’œuvre pour les cloîtres, il n’eut pas l’honneur
«
de
1' être pour l'église.
Ses choix sont discutés.
Peu à
peu, il sait qu'il lui faut trouver d'autres maîtres.
Il se tourne alors vers Louis XII, et surtout vers Anne
de Bretagne, sans quitter tout à fait Marguerite.
Période
de gloire et de difficultés, où il a bien besoin des recom
mandations des amis.
En 1511, Lemaire est totalement
au service d'Anne de Bretagne; non seulement il lui
dédie, ainsi qu'à sa fille Claude, les deux derniers livres
des Illustrations de Gaule et singul aritez de Troye (1512
et 1513), commencées pour Marguerite à partir de 1505,
mais il soutient la politique de Louis XII contre les Véni
tiens dans la Légende des Vén itien s (1509) et sa politique
gallicane contre le pape da,ns De la différence des schis
mes et des conciles de l'Eglise (1511), texte loué plus
tard par les réformés et réprouvé par les catholiques.
Lemaire, quant à lui, avait toujours cherché à rassembler;
il croyait fermement à l'union de toutes les Gaules de
langue française -les pays dominés par Marguerite et
les pays de France et de Bretagne - : il célébra avec
enthousiasme le traité de Cambrai dans la Concorde du
genre humain (1509); il crut possible de satisfaire tous
les princes dans les Illustrations, afin de les réunir dans
une grande croisade contre les Turcs -ce dont rêvaient
les humanistes depuis longtemps.
Il crut surtout pouvoir
rassembler les humanistes et poètes des deux royaumes
de la Renaissance des arts et des lettres, 1 'Italie et la
France, et c'est à quoi il destina l'un de ses plus beaux
textes, la Concorde des deux langages ( 1511 ).
L'importance de ses dernières œuvres -un poème
pour célébrer la convalescence, éphémère, d'Anne de
Bretagne; un Tra itté des Pompes funèbres pour elle
encore; de nombreux poèmes étranges (dont 1' attribution
n'est pas toujours certaine); puis les trois contes manié
ristes de Cupido et Atropos, publiés après sa mort -ne
peut faire oublier la longue liste qu'il donne lui-même
de ses projets, de ses ouvrages réalisés mais aujourd'hui
perdus.
La pureté géométrique du cloître de Brou -dont
il a pu surveiller l'élaboration -, qui unit à l'esprit
de Brunelleschi une fraîcheur presque naïve, donne à
l'effervescence de l'œuvre littéraire son contrepoint har
monieux : une structure équilibrée que les textes enfouis
sent sous l'abondance vivante des motifs.
Un écrivain fondateur : mythe et histoire
Comme ses maîtres les rhétoriqueurs, Lemaire est un
savant qui s'inspire des chroniqueurs, mythographes et
encyclopédistes médiévaux ou contemporains, en en
donnant, comme dans les Illustrations, des listes impres
sionnantes, ou en les faisant figurer comme narrateurs et
garants de ses textes : ainsi, dans la Couronne margariti
qu.e, interviennent successivement ses préférés, morts ou
vivants, Boccace, Chastelain, Gaguin, Albert le Grand,
Ficin...
Ses goûts le portent vers 1' Italie, vers Dante,
Boccace et Pétrarque, vers Annius de Viterbe, qui lui
fournit beaucoup de ses légendes troyennes, vers
Lorenzo Valla, traducteur de 1'/liade, vers Ficin et sa
conception platonicienne de la poésie.
Il leur demande à
tous de l'accompagner dans la recherche des origines et
du sens caché des fables, car 1 'histoire doit fonder le
mythe, et Je mythe justifier la grandeur du temps présent.
Aussi lit-il en curieux et critique les textes les plus
archaïques -ou ceux qu'il croit tels -, s'intéressant
aux traits de civilisation, aux jeux, aux vêtements, aux
rêves, discutant âprement de la justesse de tel détail, de
tel commentaire; et l'on aurait tort de minimiser ces
soucis d'historien sous prétexte que son texte revient,
sans le savoir, à une description des mœurs des Cours de
son temps : son dessein avoué était de corriger les erreurs
faites par les peintres et tapissiers contemporains sur la
chute de Troie ou le jugement de Pâris; l'enjeu en valait
la peine, puisque les princes amateurs de généalogies, bourguignons
ou français, voulaient se donner, au-delà
de l'Italie latine, des origines indo-européennes plus
lointaines, grecques en particulier.
Deux textes -les plus anciens -fondent pour lui
tout enseignement : Homère et la Bible; des deux catas
trophes -la chute de Troie et le Déluge -émergent
les héros d'où découlent toutes les dynasties du monde
européen; l'histoire des empire� prend sens dans le
mythe des cycles, que le Moyen Age connaît bien, mais
que Lemaire livre à la Renaissance, renouvelé du sang
clair de ses héros humains.
La mythologie, « toute riche de grans mystères et
intelligences poétiques et philosophales, contenant fruc
tueuse substance sous J' escorce des fables » (c'est la
pensée de Boccace), infuse tout, le temps de 1' histoire
des hommes, mais aussi la moindre parcelle de paysage,
animée en permanence de mille petites di vi ni tés des bois,
ondes et montagnes, qui commentent le monde; car il
y a chez Lemaire une véritable obsession du « fruict
allégorique et moral sous couleurs poétiques », qui inspi
rera la Pléiade et que Rabelais moque (loue) dans ses
prologues tout pénétrés de l'esprit « mercurial >> de
Lemaire, puisque tel est le dieu préféré du poète : l'yfer
cure, le plus ambigu de toute cette fin de Moyen Age.
De ce« maître de vertu imaginative, fantastique et cogi
tante>> il fait l'initiateur de ses propres prologues, Je
«m inistre présidential » du jugement de Pâris entre les
trois déesses, mais aussi le guide de la main de J'artiste
artisan -Je peintre Perréal ou le poète Lemaire.
Architecte, peintre et musicien
Dans une lettre extraordinaire que Lemaire adresse le
20 novembre 1510 à Marguerite d'Autriche pour justifier
son travail dans la construction de Brou, il se décrit
d'abord comme l'architecte de sa poésie, disposant des
outils que sont ses «d ix sens naturels externes et inter
nes >> (ceux de son corps et ceux de son imagination),
des pierres que sont les livres épars autour de lui, et
qu'il va exploiter.
Et très naturellement, parce que ses
premières œuvres de commande durent s'organiser en
tombeaux, subdivisés en cellules, remplis de person
nages aux larmes éloquentes disposés avec symétrie et
s'acquittant de charges précises, fixées d'avance,
Lemaire construit éperdument chaque œuvre comme un
bâtiment flamboyant où l'abondance des détails vient
s'organiser avec rigueur : la Couronne margaritique,
avec ses dix auteurs-garants, ses dix pierres précieuses,
ses dix vertus répondant aux dix lettres du nom de Mar
guerite, en est Je plus frappant exemple, avec sa réparti
tion équilibrée de prose et de vers.
Mais tous les ouvra
ges de Lemaire répondent aux mêmes besoins, et les
Illustrations de Gaule, si elles n'alternent pas prose et
vers, suivent un ordre précis, que, justement, les correc
tions et additions successives ne pourront détruire :
Pâris, Œnone et le bonheur; Pâris, Hélène et la guerre; la
réunion des deux lignées orientale et occidentale.
Mais Lemaire rivalise aussi avec le peintre et le musi
cien.
Il sait comme ses contemporains que « rhétorique
et musique sont une même chose», il travaille le vers et
le renouvelle, introduisant la tierce rime italienne pour
l'opposer à l'alexandrin (qu'il est Je premier à reprendre,
avant son grand développement au xv1• siècle); c'est lui
aussi qui fixe la règle de J' e muet à la césure; c'est
lui, surtout, qui forge la prose poétique, la différenciant,
d'ailleurs, selon ses besoins : une déesse latinise noble
ment, selon les règles de l'art oratoire, mais la descrip
tion d'un paysage ou d'un vêtement miroite simplement
dans le vocabulaire de la sensualité et de la technique du
peintre.
Le goût du vert, du bleu, des couleurs tendres,
des jeux du ciel et de l'eau, du mouvement menu s'ins
talle dans la fête des mots.
Chez lui, les yeux sont« verts.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIE DE SAINT LOUIS de Jean, sire de Joinville (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- VIE ET LA MORT DU ROI JEAN (La) (résumé & analyse de l’oeuvre)
- Jean Laplanche (vie et oeuvre)
- DEUX ÉPÎTRES DE L’AMANT VERT Jean lemaire de Belges
- ILLUSTRATIONS DE GAULE ET SINGULARITÉS DE TROIE (Les) Jean Lemaire de Belges (résumé & analyse)