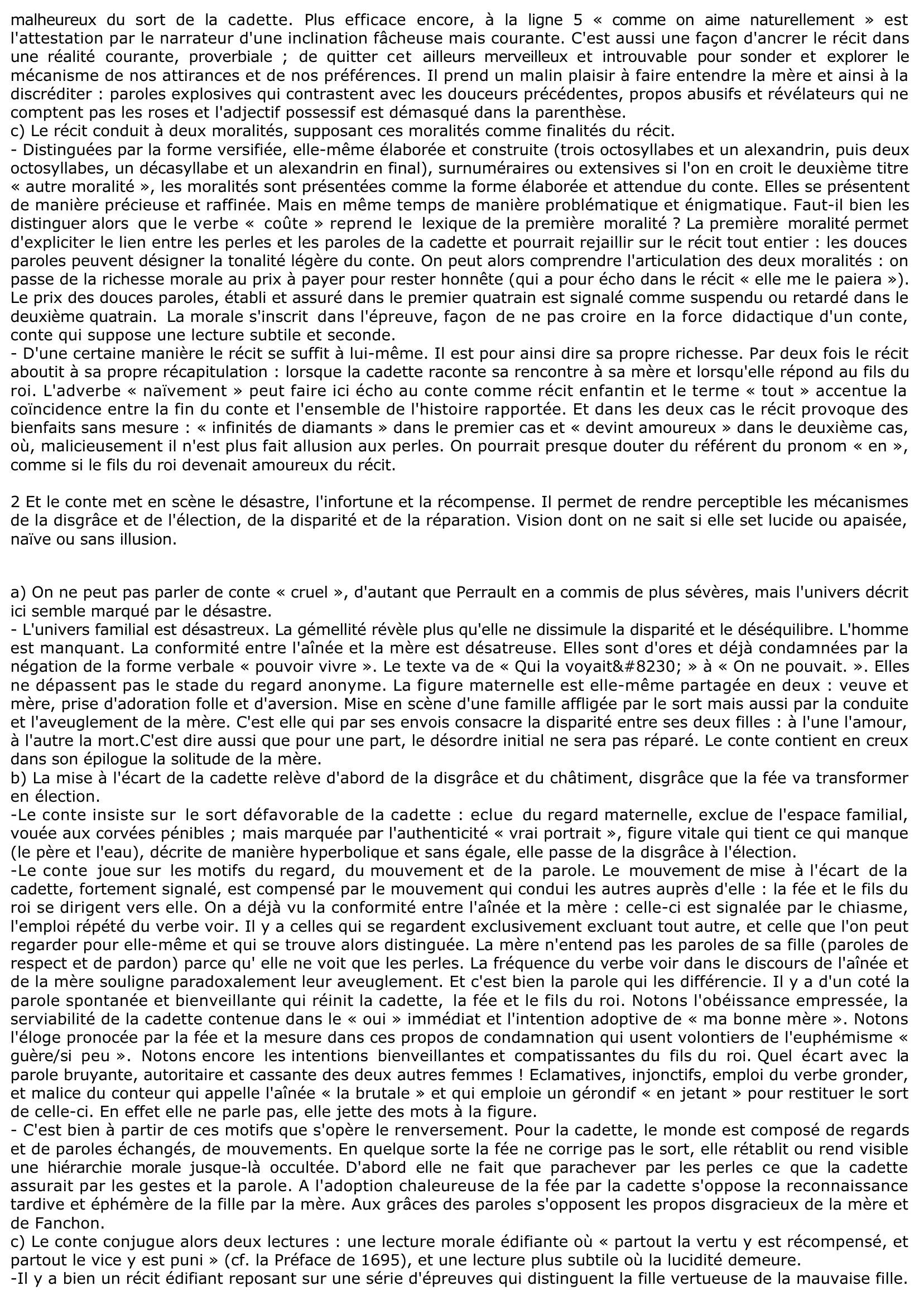LES FEES Charles Perrault
Publié le 17/01/2022

Extrait du document


«
malheureux du sort de la cadette.
Plus efficace encore, à la ligne 5 « comme on aime naturellement » estl'attestation par le narrateur d'une inclination fâcheuse mais courante.
C'est aussi une façon d'ancrer le récit dansune réalité courante, proverbiale ; de quitter cet ailleurs merveilleux et introuvable pour sonder et explorer lemécanisme de nos attirances et de nos préférences.
Il prend un malin plaisir à faire entendre la mère et ainsi à ladiscréditer : paroles explosives qui contrastent avec les douceurs précédentes, propos abusifs et révélateurs qui necomptent pas les roses et l'adjectif possessif est démasqué dans la parenthèse.c) Le récit conduit à deux moralités, supposant ces moralités comme finalités du récit.- Distinguées par la forme versifiée, elle-même élaborée et construite (trois octosyllabes et un alexandrin, puis deuxoctosyllabes, un décasyllabe et un alexandrin en final), surnuméraires ou extensives si l'on en croit le deuxième titre« autre moralité », les moralités sont présentées comme la forme élaborée et attendue du conte.
Elles se présententde manière précieuse et raffinée.
Mais en même temps de manière problématique et énigmatique.
Faut-il bien lesdistinguer alors que le verbe « coûte » reprend le lexique de la première moralité ? La première moralité permetd'expliciter le lien entre les perles et les paroles de la cadette et pourrait rejaillir sur le récit tout entier : les doucesparoles peuvent désigner la tonalité légère du conte.
On peut alors comprendre l'articulation des deux moralités : onpasse de la richesse morale au prix à payer pour rester honnête (qui a pour écho dans le récit « elle me le paiera »).Le prix des douces paroles, établi et assuré dans le premier quatrain est signalé comme suspendu ou retardé dans ledeuxième quatrain.
La morale s'inscrit dans l'épreuve, façon de ne pas croire en la force didactique d'un conte,conte qui suppose une lecture subtile et seconde.- D'une certaine manière le récit se suffit à lui-même.
Il est pour ainsi dire sa propre richesse.
Par deux fois le récitaboutit à sa propre récapitulation : lorsque la cadette raconte sa rencontre à sa mère et lorsqu'elle répond au fils duroi.
L'adverbe « naïvement » peut faire ici écho au conte comme récit enfantin et le terme « tout » accentue lacoïncidence entre la fin du conte et l'ensemble de l'histoire rapportée.
Et dans les deux cas le récit provoque desbienfaits sans mesure : « infinités de diamants » dans le premier cas et « devint amoureux » dans le deuxième cas,où, malicieusement il n'est plus fait allusion aux perles.
On pourrait presque douter du référent du pronom « en »,comme si le fils du roi devenait amoureux du récit.
2 Et le conte met en scène le désastre, l'infortune et la récompense.
Il permet de rendre perceptible les mécanismesde la disgrâce et de l'élection, de la disparité et de la réparation.
Vision dont on ne sait si elle set lucide ou apaisée,naïve ou sans illusion.
a) On ne peut pas parler de conte « cruel », d'autant que Perrault en a commis de plus sévères, mais l'univers décritici semble marqué par le désastre.- L'univers familial est désastreux.
La gémellité révèle plus qu'elle ne dissimule la disparité et le déséquilibre.
L'hommeest manquant.
La conformité entre l'aînée et la mère est désatreuse.
Elles sont d'ores et déjà condamnées par lanégation de la forme verbale « pouvoir vivre ».
Le texte va de « Qui la voyait… » à « On ne pouvait.
».
Ellesne dépassent pas le stade du regard anonyme.
La figure maternelle est elle-même partagée en deux : veuve etmère, prise d'adoration folle et d'aversion.
Mise en scène d'une famille affligée par le sort mais aussi par la conduiteet l'aveuglement de la mère.
C'est elle qui par ses envois consacre la disparité entre ses deux filles : à l'une l'amour,à l'autre la mort.C'est dire aussi que pour une part, le désordre initial ne sera pas réparé.
Le conte contient en creuxdans son épilogue la solitude de la mère.b) La mise à l'écart de la cadette relève d'abord de la disgrâce et du châtiment, disgrâce que la fée va transformeren élection.-Le conte insiste sur le sort défavorable de la cadette : eclue du regard maternelle, exclue de l'espace familial,vouée aux corvées pénibles ; mais marquée par l'authenticité « vrai portrait », figure vitale qui tient ce qui manque(le père et l'eau), décrite de manière hyperbolique et sans égale, elle passe de la disgrâce à l'élection.-Le conte joue sur les motifs du regard, du mouvement et de la parole.
Le mouvement de mise à l'écart de lacadette, fortement signalé, est compensé par le mouvement qui condui les autres auprès d'elle : la fée et le fils duroi se dirigent vers elle.
On a déjà vu la conformité entre l'aînée et la mère : celle-ci est signalée par le chiasme,l'emploi répété du verbe voir.
Il y a celles qui se regardent exclusivement excluant tout autre, et celle que l'on peutregarder pour elle-même et qui se trouve alors distinguée.
La mère n'entend pas les paroles de sa fille (paroles derespect et de pardon) parce qu' elle ne voit que les perles.
La fréquence du verbe voir dans le discours de l'aînée etde la mère souligne paradoxalement leur aveuglement.
Et c'est bien la parole qui les différencie.
Il y a d'un coté laparole spontanée et bienveillante qui réinit la cadette, la fée et le fils du roi.
Notons l'obéissance empressée, laserviabilité de la cadette contenue dans le « oui » immédiat et l'intention adoptive de « ma bonne mère ».
Notonsl'éloge pronocée par la fée et la mesure dans ces propos de condamnation qui usent volontiers de l'euphémisme «guère/si peu ».
Notons encore les intentions bienveillantes et compatissantes du fils du roi.
Quel écart avec laparole bruyante, autoritaire et cassante des deux autres femmes ! Eclamatives, injonctifs, emploi du verbe gronder,et malice du conteur qui appelle l'aînée « la brutale » et qui emploie un gérondif « en jetant » pour restituer le sortde celle-ci.
En effet elle ne parle pas, elle jette des mots à la figure.- C'est bien à partir de ces motifs que s'opère le renversement.
Pour la cadette, le monde est composé de regardset de paroles échangés, de mouvements.
En quelque sorte la fée ne corrige pas le sort, elle rétablit ou rend visibleune hiérarchie morale jusque-là occultée.
D'abord elle ne fait que parachever par les perles ce que la cadetteassurait par les gestes et la parole.
A l'adoption chaleureuse de la fée par la cadette s'oppose la reconnaissancetardive et éphémère de la fille par la mère.
Aux grâces des paroles s'opposent les propos disgracieux de la mère etde Fanchon.c) Le conte conjugue alors deux lectures : une lecture morale édifiante où « partout la vertu y est récompensé, etpartout le vice y est puni » (cf.
la Préface de 1695), et une lecture plus subtile où la lucidité demeure.-Il y a bien un récit édifiant reposant sur une série d'épreuves qui distinguent la fille vertueuse de la mauvaise fille..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PETIT Poucet (le), de Charles Perrault
- CONTES Charles Perrault (résumé & analyse)
- CONTES, de Charles Perrault
- BELLE AU BOIS DORMANT (La). de Charles Perrault (résumé & analyse)
- Le personnage de PEAU D’ANE de Charles Perrault