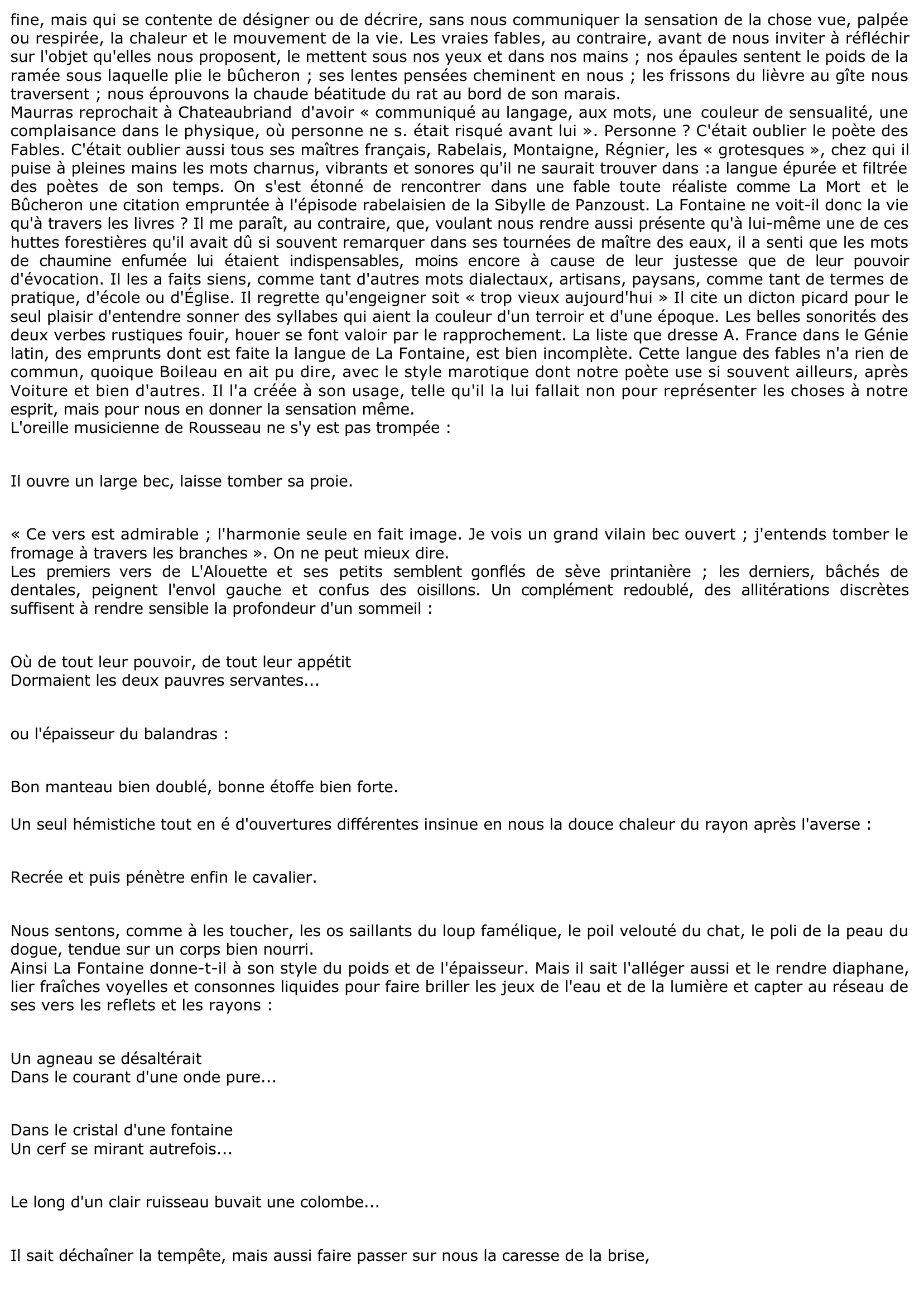LES PREMIÈRES FABLES DE LA FONTAINE
Publié le 23/06/2011

Extrait du document
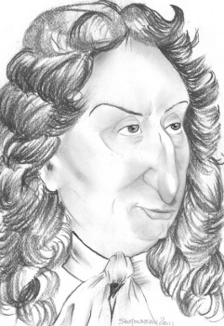
Quand La Fontaine a-t-il commencé d'écrire des fables ? Il est difficile de croire avec Brossette que Le Meunier, son fils et l' Ane fut adressé à Maucroix lorsque celui-ci décida d'abandonner le barreau pour l'Eglise, c'est-à-dire aux environs de 1647. Mais on peut admettre qu'au temps où notre poète glissait des apologues en vers libres dans le Songe de Vaux et Le Voyage en Limousin, ses fables étaient déjà sur le chantier. En effet, les manuscrits Conrart nous en donnent dix dont la rédaction semble remonter au delà de 1663. Neuf d'entre elles prendront place, plus ou moins modifiées, dans les livres I et III de 1668 ; celle qui est restée inédite n'est en rien inférieure aux autres, mais, composée à une époque où les amis de Fouquet espéraient encore, et précisément pour traduire leurs espoirs, elle n'a pu être publiée après sa condamnation. Antérieure « à coup sûr «, comme le note Roche, au départ du poète pour le Limousin, cette fable date les neuf autres.
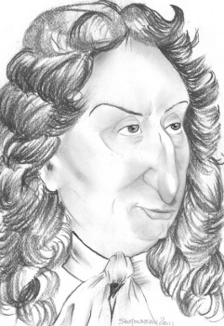
«
fine, mais qui se contente de désigner ou de décrire, sans nous communiquer la sensation de la chose vue, palpéeou respirée, la chaleur et le mouvement de la vie.
Les vraies fables, au contraire, avant de nous inviter à réfléchirsur l'objet qu'elles nous proposent, le mettent sous nos yeux et dans nos mains ; nos épaules sentent le poids de laramée sous laquelle plie le bûcheron ; ses lentes pensées cheminent en nous ; les frissons du lièvre au gîte noustraversent ; nous éprouvons la chaude béatitude du rat au bord de son marais.Maurras reprochait à Chateaubriand d'avoir « communiqué au langage, aux mots, une couleur de sensualité, unecomplaisance dans le physique, où personne ne s.
était risqué avant lui ».
Personne ? C'était oublier le poète desFables.
C'était oublier aussi tous ses maîtres français, Rabelais, Montaigne, Régnier, les « grotesques », chez qui ilpuise à pleines mains les mots charnus, vibrants et sonores qu'il ne saurait trouver dans :a langue épurée et filtréedes poètes de son temps.
On s'est étonné de rencontrer dans une fable toute réaliste comme La Mort et leBûcheron une citation empruntée à l'épisode rabelaisien de la Sibylle de Panzoust.
La Fontaine ne voit-il donc la viequ'à travers les livres ? Il me paraît, au contraire, que, voulant nous rendre aussi présente qu'à lui-même une de ceshuttes forestières qu'il avait dû si souvent remarquer dans ses tournées de maître des eaux, il a senti que les motsde chaumine enfumée lui étaient indispensables, moins encore à cause de leur justesse que de leur pouvoird'évocation.
Il les a faits siens, comme tant d'autres mots dialectaux, artisans, paysans, comme tant de termes depratique, d'école ou d'Église.
Il regrette qu'engeigner soit « trop vieux aujourd'hui » Il cite un dicton picard pour leseul plaisir d'entendre sonner des syllabes qui aient la couleur d'un terroir et d'une époque.
Les belles sonorités desdeux verbes rustiques fouir, houer se font valoir par le rapprochement.
La liste que dresse A.
France dans le Génielatin, des emprunts dont est faite la langue de La Fontaine, est bien incomplète.
Cette langue des fables n'a rien decommun, quoique Boileau en ait pu dire, avec le style marotique dont notre poète use si souvent ailleurs, aprèsVoiture et bien d'autres.
Il l'a créée à son usage, telle qu'il la lui fallait non pour représenter les choses à notreesprit, mais pour nous en donner la sensation même.L'oreille musicienne de Rousseau ne s'y est pas trompée :
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
« Ce vers est admirable ; l'harmonie seule en fait image.
Je vois un grand vilain bec ouvert ; j'entends tomber lefromage à travers les branches ».
On ne peut mieux dire.Les premiers vers de L'Alouette et ses petits semblent gonflés de sève printanière ; les derniers, bâchés dedentales, peignent l'envol gauche et confus des oisillons.
Un complément redoublé, des allitérations discrètessuffisent à rendre sensible la profondeur d'un sommeil :
Où de tout leur pouvoir, de tout leur appétitDormaient les deux pauvres servantes...
ou l'épaisseur du balandras :
Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte.
Un seul hémistiche tout en é d'ouvertures différentes insinue en nous la douce chaleur du rayon après l'averse :
Recrée et puis pénètre enfin le cavalier.
Nous sentons, comme à les toucher, les os saillants du loup famélique, le poil velouté du chat, le poli de la peau dudogue, tendue sur un corps bien nourri.Ainsi La Fontaine donne-t-il à son style du poids et de l'épaisseur.
Mais il sait l'alléger aussi et le rendre diaphane,lier fraîches voyelles et consonnes liquides pour faire briller les jeux de l'eau et de la lumière et capter au réseau deses vers les reflets et les rayons :
Un agneau se désaltéraitDans le courant d'une onde pure...
Dans le cristal d'une fontaineUn cerf se mirant autrefois...
Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe...
Il sait déchaîner la tempête, mais aussi faire passer sur nous la caresse de la brise,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Les Fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant », écrit, en 1849, Lamartine dans la préface à la réédition de ses Premières méditations. Vous commenterez ce jugement en vous appuyant sur les fables que vous avez étudiées. ?
- Le pragmatisme dans les fables de La Fontaine
- LA FONTAINE: FABLES (résumé et analyse)
- Dissertation Fables de La Fontaine (livre VII)
- dissertation fables de La Fontaine: Mensonge et vérité