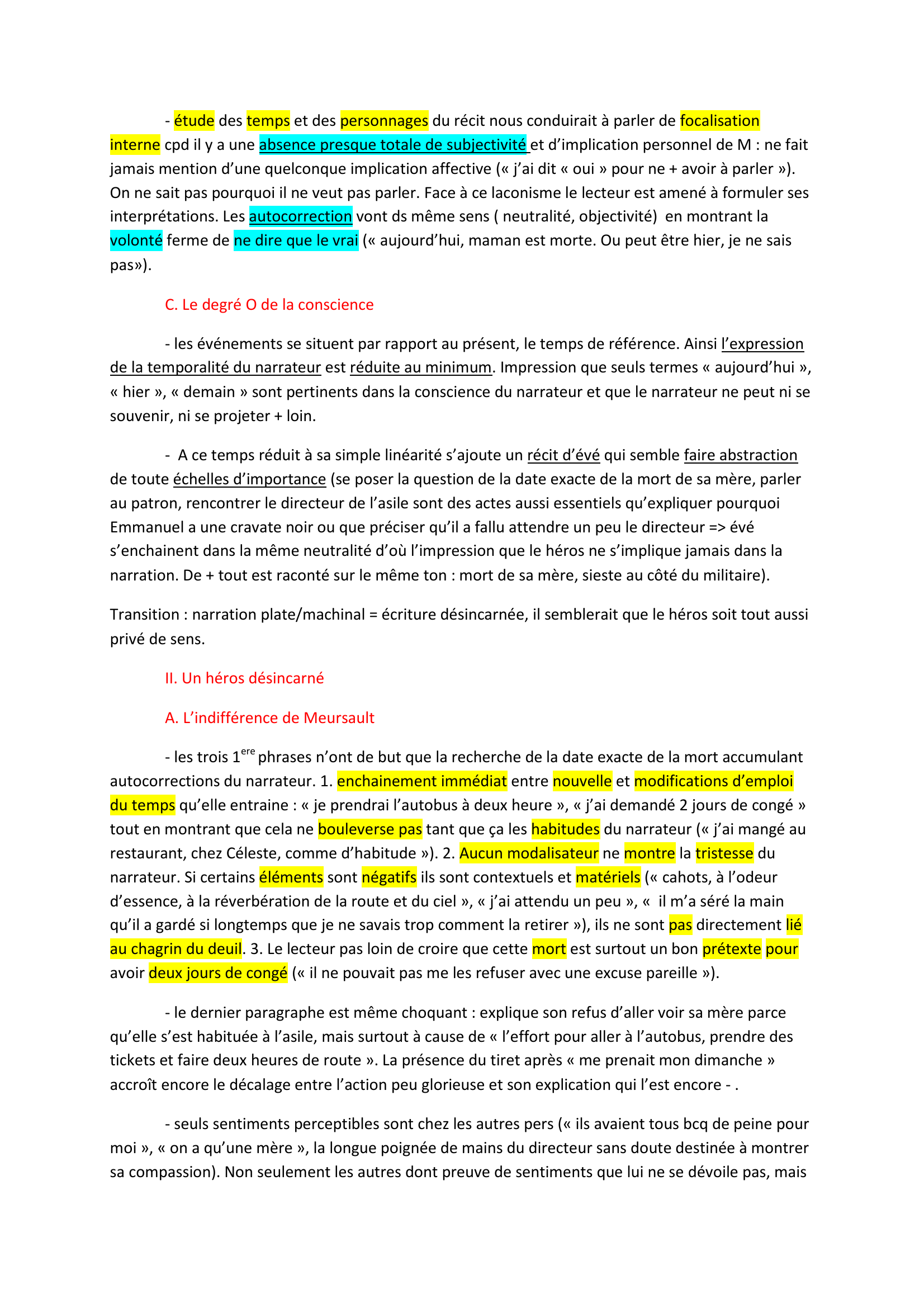L'incipit de l'Etranger de Camus (commentaire)
Publié le 09/05/2012

Extrait du document
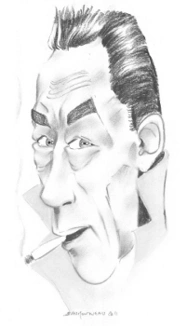
Situation du texte dans l’œuvre : L’extrait proposé est l’incipit de L’Etranger d’Albert Camus. Le roman débute avec un événement sinistre : la mort du personnage principal ( « aujourd’hui, maman est morte « phrase donne le ton de l’œuvre).
En quoi cette plongée dans l’intériorité du narrateur est-elle aussi une plongée dans une nouvelle conception romanesque ?
Nous chercherons à comprendre les raisons du malaise qui saisit le lecteur à la 1ere lecture, et surtout à en déduire les implications dans la construction du pers ambigu qu’est Meursault.
I. Une écriture désincarnée
A. La découverte d’une intériorité
- omniprésence du « je «, marqueurs temporels (« aujourd’hui «, « hier «) qui tendent vers journal intime.
- forme discours donne à voir intériorité d’une pers, d’une conscience : utilisation du passé composé (« est morte «, « ai reçu «, « ai demandé «), du pst (« je ne sais pas «, « ne veut rien dire «), futur (« je prendrais «, « j’arriverai «).
- ns apprenons le nom pers par le hasard des événements racontés (« Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans « dit le directeur de l’asile). Ajoute à l’illusion du journal intime.
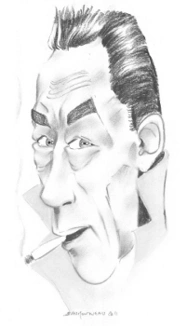
«
- étude des temps et des personnages du récit nous conduirait à parler de focalisation
interne cpd il y a une absence presque totale de subjectivité et d’implication personnel de M : ne fait
jamais mention d’une quelconque implication affective (« j’ai dit « oui » pour ne + avoir à parler »).
On ne sait pas pourquoi il ne veut pas parler.
Face à ce laconisme le lecteur est amené à formuler ses
interprétations.
Les autocorrection vont ds même sens ( neutralité, objectivité) en montrant la
volonté ferme de ne dire que le vrai (« aujourd’hui, maman est morte.
Ou peut être hier, je ne sais
pas»).
C.
Le degré O de la conscience
- les événements se situent par rapport au présent, le temps de référence.
Ainsi l’expression
de la temporalité du narrateur est réduite au minimum.
Impression que seuls termes « aujourd’hui »,
« hier », « demain » sont pertinents dans la conscience du narrateur et que le narrateur ne peut ni se
souvenir, ni se projeter + loin.
- A ce temps réduit à sa simple linéarité s’ajoute un récit d’évé qui semble faire abstraction
de toute échelles d’importance (se poser la question de la date exacte de la mort de sa mère, parler
au patron, rencontrer le directeur de l’asile sont des actes aussi essentiels qu’expliquer pourquoi
Emmanuel a une cravate noir ou que préciser qu’il a fallu attendre un peu le directeur => évé
s’enchainent dans la même neutralité d’où l’impression que le héros ne s’implique jamais dans la
narration.
De + tout est raconté sur le même ton : mort de sa mère, sieste au côté du militaire).
Transition : narration plate/machinal = écriture désincarnée, il semblerait que le héros soit tout aussi
privé de sens.
II.
Un héros désincarné
A.
L’indifférence de Meursault
- les trois 1 ere phrases n’ont de but que la recherche de la date exacte de la mort accumulant
autocorrections du narrateur.
1.
enchainement immédiat entre nouvelle et modifications d’emploi
du temps qu’elle entraine : « je prendrai l’autobus à deux heure », « j’ai demandé 2 jours de congé »
tout en montrant que cela ne bouleverse pas tant que ça les habitudes du narrateur (« j’ai mangé au
restaurant, chez Céleste, comme d’habitude »).
2.
Aucun modalisateur ne montre la tristesse du
narrateur.
Si certains éléments sont négatifs ils sont contextuels et matériels (« cahots, à l’odeur
d’essence, à la réverbération de la route et du ciel », « j’ai attendu un peu », « il m’a séré la main
qu’il a gardé si longtemps que je ne savais trop comment la retirer »), ils ne sont pas directement lié
au chagrin du deuil.
3.
Le lecteur pas loin de croire que cette mort est surtout un bon prétexte pour
avoir deux jours de congé (« il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille »).
- le dernier paragraphe est même choquant : explique son refus d’aller voir sa mère parce
qu’elle s’est habituée à l’asile, mais surtout à cause de « l’effort pour aller à l’autobus, prendre des
tickets et faire deux heures de route ».
La présence du tiret après « me prenait mon dimanche »
accroît encore le décalage entre l’action peu glorieuse et son explication qui l’est encore - .
- seuls sentiments perceptibles sont chez les autres pers (« ils avaient tous bcq de peine pour
moi », « on a qu’une mère », la longue poignée de mains du directeur sans doute destinée à montrer
sa compassion).
Non seulement les autres dont preuve de sentiments que lui ne se dévoile pas, mais.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'incipit de L'Etranger de Camus (commentaire)
- L'incipit de l'Etranger, Albert Camus
- Commentaire fin du chapitre 6 partie I camus l'etranger
- L'incipit de l'Etranger, Camus
- fiche lecture analytique commentaire excipit l'etranger camus