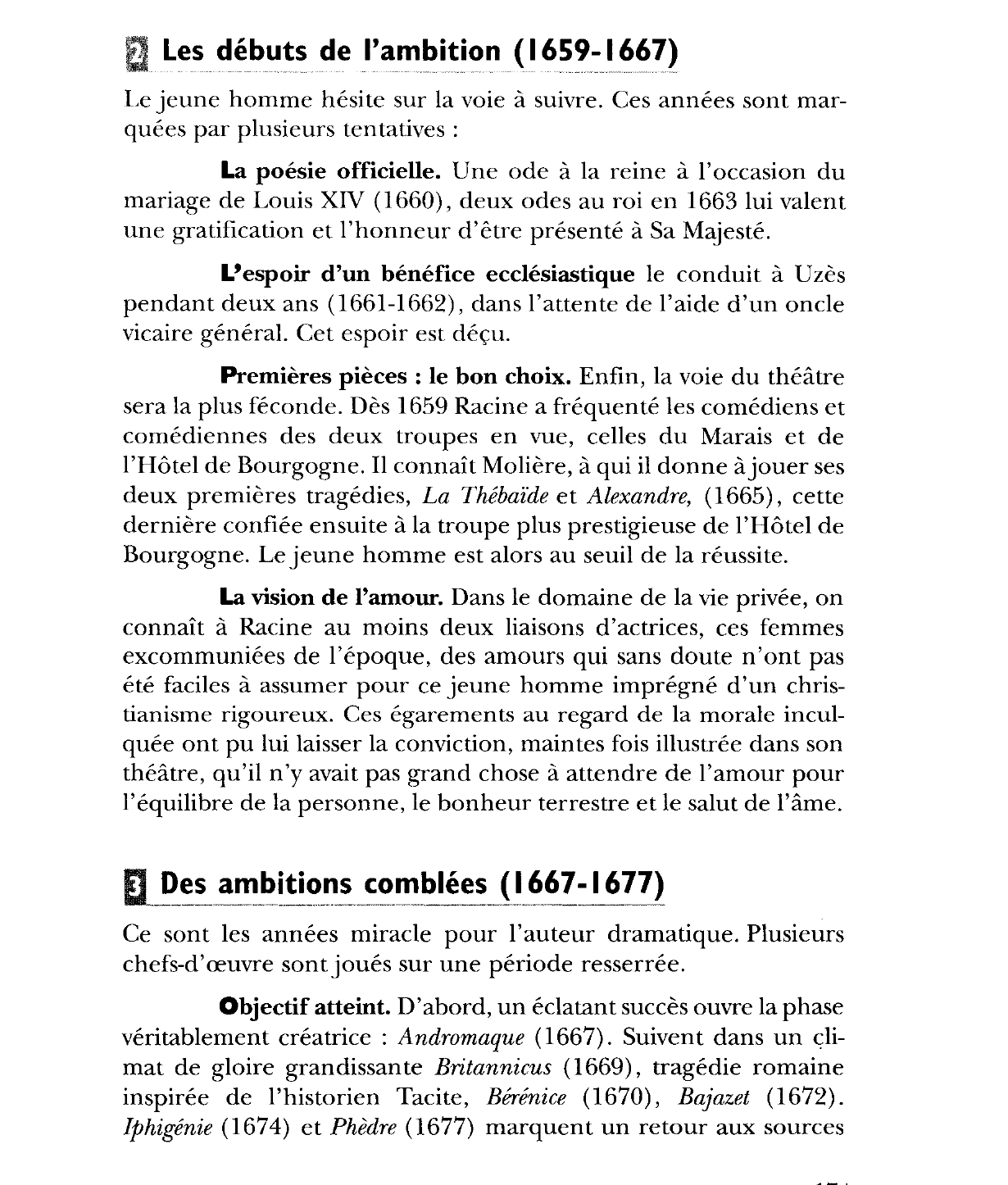L'oeuvre dans la vie de l'auteur
Publié le 30/07/2014

Extrait du document
L'oeuvre dans la vie
de l'auteur
Un grand biographe de Racine, Raymond Picard, pense qu'il faut se
garder de toute affirmation tranchée quand on essaie d'expliquer
l'oeuvre de Racine par la vie de l'auteur. On s'avancera donc avec
prudence dans l'interprétation d'une biographie guidée par une
immense ambition et la vive intelligence de plaire à ceux qui peuvent
le servir, les grands, la cour et surtout le souverain, Louis XIV.
Orphelin à quatre ans, Racine enfant fut confié aux soins de sa
grand-mère ; il est élève pendant quatre ans des Petites Écoles de
Port-Royal, où il revient terminer sa formation de 1655 à 1658. On
retiendra de cette période deux orientations :
Culture grecque. L'élève acquiert la connaissance précise
de la littérature latine, et davantage encore de la culture grecque:
il lit dans le texte et annote les grands tragiques, Sophocle et
Euripide. Helléniste accompli, il empruntera à ce dernier le sujet
de Phèdre et recopiera même les plus beaux dialogues de sa tragédie
intitulée Hippolyte.
«
Les débuts de l'ambition ( 1659-1667)
Le jeune homme hésite sur la voie à suivre.
Ces années sont mar
quées par plusieurs tentatives :
La
poésie officielle.
Une ode à la reine à l'occasion du
mariage de Louis XIV (1660), deux odes au roi en 1663 lui valent
une gratification et l'honneur d'être présenté à Sa Majesté.
L'espoir d'un bénéfice ecclésiastique le conduit à Uzès
pendant deux ans (1661-1662), dans l'attente de l'aide d'un oncle
vicaire général.
Cet espoir est déçu.
Premières pièces : le bon choix.
Enfin, la voie du théâtre
sera la plus féconde.
Dès 1659 Racine a fréquenté les comédiens et
comédiennes des deux troupes en vue, celles du Marais et de
l'Hôtel de Bourgogne.
Il connaît Molière, à qui il donne à jouer ses
deux premières tragédies, La Thébaïde et Alexandre, ( 1665), cette
dernière confiée ensuite à la troupe plus prestigieuse de l'Hôtel de
Bourgogne.
Le jeune homme est alors au seuil de la réussite.
La vision de l'amour.
Dans le domaine de la vie privée, on
connaît à Racine au moins deux liaisons d'actrices, ces femmes
excommuniées de l'époque, des amours qui sans doute n'ont pas
été faciles à assumer pour ce jeune homme imprégné d'un chris
tianisme
rigoureux.
Ces égarements au regard de la morale incul
quée ont pu lui laisser la conviction, maintes fois illustrée dans son
théâtre, qu'il n'y avait pas grand chose à attendre de l'amour pour
l'équilibre de la personne, le bonheur terrestre et le salut de l'âme.
Ce sont les années miracle pour l'auteur dramatique.
Plusieurs
chefs-d'œuvre sont joués sur une période resserrée.
Objectif atteint.
D'abord, un éclatant succès ouvre la phase
véritablement créatrice : Andromaque ( 1667).
Suivent dans un cli
mat de gloire grandissante Britannicus (1669), tragédie romaine
inspirée de l'historien Tacite, Bérénice (1670), Bajazet (1672).
Iphigénie (1674) et Phèdre (1677) marquent un retour aux sources.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Au terme de l'Avant-propos placé en tête de son livre Matière et Lumière, Louis de Broglie écrit : « On peut légitimement aimer la science pour ses applications, pour les soulagements et les commodités qu'elle a apportés à la vie humaine, sans oublier toutefois que la vie humaine restera toujours, de par sa nature même, précaire et misérable. Mais on peut, pensons-nous, trouver une autre raison d'aimer l'effort scientifique, en appréciant la valeur de ce qu'il représente. En effet, com
- Germinal, grand roman du XIXe siècle, met en scène la vie quotidienne des mineurs dans la mine d'Anzin. Dans un passage qui se trouve au cinquième chapitre de la première partie, l'auteur parle surtout des chevaux de la mine. En comparant ce passage à un passage du livre de Simonin, nous étudierons la manière dont Zola utilise la documentation livresque ? Quel sens entend-il donner à ce passage ? Pour quelles raisons intègre-t-il cet épisode dans son oeuvre ?
- On oppose souvent le roman autobiographique où l'écrivain, se campant lui-même sous les traits d'un de ses héros, fait revivre dans d'autres personnages ses proches et ses familiers et le roman où l'auteur, prenant sa revanche sur la vie, prête à l'un de ses héros des qualités et une forme d'existence dont il n'a pas bénéficié lui-même. Connaissez-vous une oeuvre romanesque où s'associent heureusement ces deux types de roman ?
- On oppose souvent le roman autobiographique où l'écrivain, se campant lui-même sous les traits d'un de ses héros, fait revivre dans d'autres personnages ses proches et ses familiers et le roman où l'auteur, prenant sa revanche sur la vie, prête à l'un de ses héros des qualités et une forme d'existence dont il n'a pas bénéficié lui-même. Connaissez-vous une oeuvre romanesque où s'associent heureusement ces deux types de roman ?
- Est-il nécessaire de connaître la vie d'un auteur pour apprécier son oeuvre ?