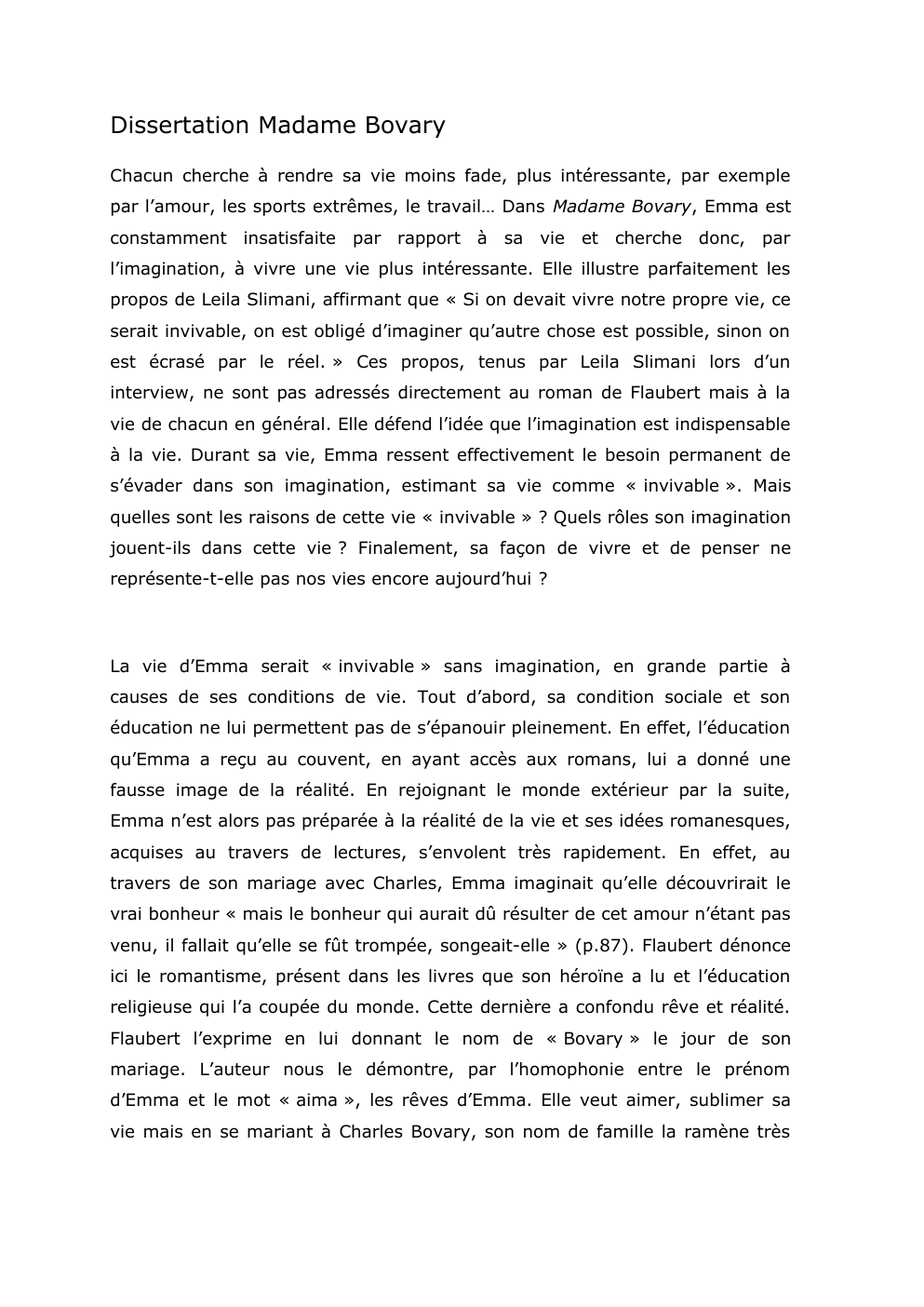Madame Bovary et sa vie invivable
Publié le 04/10/2022
Extrait du document
«
Dissertation Madame Bovary
Chacun cherche à rendre sa vie moins fade, plus intéressante, par exemple
par l’amour, les sports extrêmes, le travail… Dans Madame Bovary, Emma est
constamment insatisfaite par rapport à sa vie et cherche donc, par
l’imagination, à vivre une vie plus intéressante.
Elle illustre parfaitement les
propos de Leila Slimani, affirmant que « Si on devait vivre notre propre vie, ce
serait invivable, on est obligé d’imaginer qu’autre chose est possible, sinon on
est écrasé par le réel.
» Ces propos, tenus par Leila Slimani lors d’un
interview, ne sont pas adressés directement au roman de Flaubert mais à la
vie de chacun en général.
Elle défend l’idée que l’imagination est indispensable
à la vie.
Durant sa vie, Emma ressent effectivement le besoin permanent de
s’évader dans son imagination, estimant sa vie comme « invivable ».
Mais
quelles sont les raisons de cette vie « invivable » ? Quels rôles son imagination
jouent-ils dans cette vie ? Finalement, sa façon de vivre et de penser ne
représente-t-elle pas nos vies encore aujourd’hui ?
La vie d’Emma serait « invivable » sans imagination, en grande partie à
causes de ses conditions de vie.
Tout d’abord, sa condition sociale et son
éducation ne lui permettent pas de s’épanouir pleinement.
En effet, l’éducation
qu’Emma a reçu au couvent, en ayant accès aux romans, lui a donné une
fausse image de la réalité.
En rejoignant le monde extérieur par la suite,
Emma n’est alors pas préparée à la réalité de la vie et ses idées romanesques,
acquises au travers de lectures, s’envolent très rapidement.
En effet, au
travers de son mariage avec Charles, Emma imaginait qu’elle découvrirait le
vrai bonheur « mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n’étant pas
venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-elle » (p.87).
Flaubert dénonce
ici le romantisme, présent dans les livres que son héroïne a lu et l’éducation
religieuse qui l’a coupée du monde.
Cette dernière a confondu rêve et réalité.
Flaubert l’exprime en lui donnant le nom de « Bovary » le jour de son
mariage.
L’auteur nous le démontre, par l’homophonie entre le prénom
d’Emma et le mot « aima », les rêves d’Emma.
Elle veut aimer, sublimer sa
vie mais en se mariant à Charles Bovary, son nom de famille la ramène très
vite dans le bas, le grotesque puisque « Bovary » signifie bovin, donc ramène
à la terre.
De plus, sa condition de femme ne lui permet pas non plus de vivre la vie dont
elle aurait souhaité.
Elle ne peut pas faire tout ce qu’elle souhaite et n’a pas
pu se prononcer sur son mariage avec Charles.
Celui-ci a demandé au père
d’Emma l’autorisation de l’épouser.
A cette époque, au 19 e siècle, il était
normal de procéder ainsi.
Mais cette décision prise à sa place va lui ruiner sa
vie.
Elle le réalise ensuite et se dit : « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je
mariée ? » (p.101).
En plus de s’être mariée à un homme inintéressant, Emma
dépend de lui économiquement.
Elle ne peut pas travailler, en raison de son
époque et de sa condition féminie.
Elle est donc vouée à dépendre de Charles.
Mais Emma refuse cette réalité et, lorsqu’elle aura des dettes à payer, elle
cherchera par elle-même un moyen d’y parvenir, sans l’aide de son mari :
« Madame expédia des factures chez deux ou trois clients, et bientôt usa de ce
moyen qui lui réussissait » (p.402).
« Pour se faire de l’argent, elle se mit
[aussi] à vendre ses vieux gants, ses vieux chapeaux, la vieille ferraille ; et
elle marchandait avec rapacité » (p.402).
Emma est prête à tout faire pour
cacher à son mari qu’elle s’est endettée.
Elle est trop fière et refuse de se
soumettre à la fatalité de sa condition de femme.
Finalement, sa condition humaine, elle aussi, représente un obstacle.
Emma a
besoin de retirer, de tout ce qu’elle fait, un profit personnel.
Elle considère
« comme inutile tout ce qui ne [contribue] pas à la consommation immédiate
de son cœur.
» (p.90) Elle soumet donc tout au « règne du corps » et confond
alors le spirituel et le sensuel en « collant ses lèvres sur le corps de l’HommeDieu, [et en y déposant] de toute sa force expirante le plus grand baiser
d’amour qu’elle eût jamais donné » (p.444).
Emma pense que ce dernier geste
avant sa mort lui permettra de réaliser ses désirs de passion, d’amour qu’elle
n’a pas réussi à assouvir avec ses amants.
Ayant essayé toute sa vie de
rendre son quotidien plus vivant, en ayant des amants ou en apprenant le
piano, la couture, etc, elle prend finalement conscience de sa condition
humaine qu’elle ne pourra pas changer et « elle abandonna la musique.
Pourquoi jouer ? qui l’entendrait ? » « À quoi bon ? à quoi bon ? » (p.125) et
finalement décide de se suicider pour échapper à cette condition humaine
irrémédiable.
Sa vie est dictée par tous ses désirs et ses décisions.
A travers toutes ces conditions de vie qui empêchent Emma de vivre
pleinement, Flaubert dénonce les différentes valeurs de la société dans
laquelle il vit.
En parlant d’adultère et en dénonçant l’éducation religieuse
d’Emma, Flaubert sera accusé d’«outrage à la morale publique et religieuse et
aux bonnes mœurs ».
L’auteur choque l’opinion public, inhabitué à de tels
propos aussi réalistes et à des scènes adultères.
Finalement, le procès qui suit
sera gagné par Flaubert et lui assurera le succès de Madame Bovary.
L’imagination d’Emma joue plusieurs rôles différents dans sa vie.
Tout d’abord,
elle la maintient en vie.
Elle lui permet de s’échapper de son quotidien qu’elle
n’aime pas.
Le bal de la Vaubyessard est pour Emma un rêve éveillé.
Tout ce
dont elle rêve est présent.
Elle est en compagnie d’aristocrates, comme dans
les romans qu’elle a lus et s’imagine, elle aussi, appartenant à cette classe
sociale car c’est pour elle l’idéal à atteindre : « elle faisait des efforts pour se
tenir éveillée, afin de prolonger l’illusion de cette vie luxueuse » « Elle aurait
voulu savoir leurs existences, y pénétrer, s’y confondre.
» (p.114).
Cette vie
aristocrate est complètement différente de la sienne.
Il en est de même du
vicomte et de Charles de vies diamétralement opposées.
Le vicomte
représente l’idéal de l’homme que s’est créé Emma grâce aux romans.
C’est
un aristocrate, comme le mari dont rêve Emma : « un mari vêtu d’un habit de
velours noir à longues basques, et qui porte des bottes molles, un chapeau
pointu et des manchettes ! ».
Ces habits montrent clairement qu’il appartient
à l’aristocratie avec ses bottes molle et son habit de velours noir qui montrent
la richesse de cet homme.
Charles, quant à lui, est tout l’opposé : « Il
(Charles) portait toujours de fortes bottes, qui avaient au cou-de-pied deux
plis épais obliquant vers les chevilles, tandis que le reste de l’empeigne se
continuait en ligne droite, tendu comme par un pied de bois.
Il disait que
c’était bien assez bon pour la campagne.
» (p.99).
Il porte des bottes rigides
et surtout, n’appartient pas à l’aristocratie mais habite à la campagne.
Les
quelques heures de rêve qu’Emma a vécu au bal lui font alors prendre
entièrement conscience de sa vie trop calme, ennuyante, ne correspondant en
rien à ses aspirations.
En rentrant chez elle avec Charles, Emma attend
désespérément de retourner à ce bal pour revivre....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary: chapitre 4 : Emma Rouault, rêvant d'une vie mondaine après avoir été élevée dans un couvent, s'apprête à célébrer sa noce avec Charles Bovary, un médecin de campagne.
- La vie de province, une satire sans pitié - GUSTAVE FLAUBERT, MADAME BOVARY
- Flaubert, Madame Bovary. Sous forme d'un commentaire composé, vous montrerez comment l'auteur présente un document sur la vie de province et fait découvrir les sentiments qu'elle inspire.
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- Madame Bovary et la littérature sentimentale