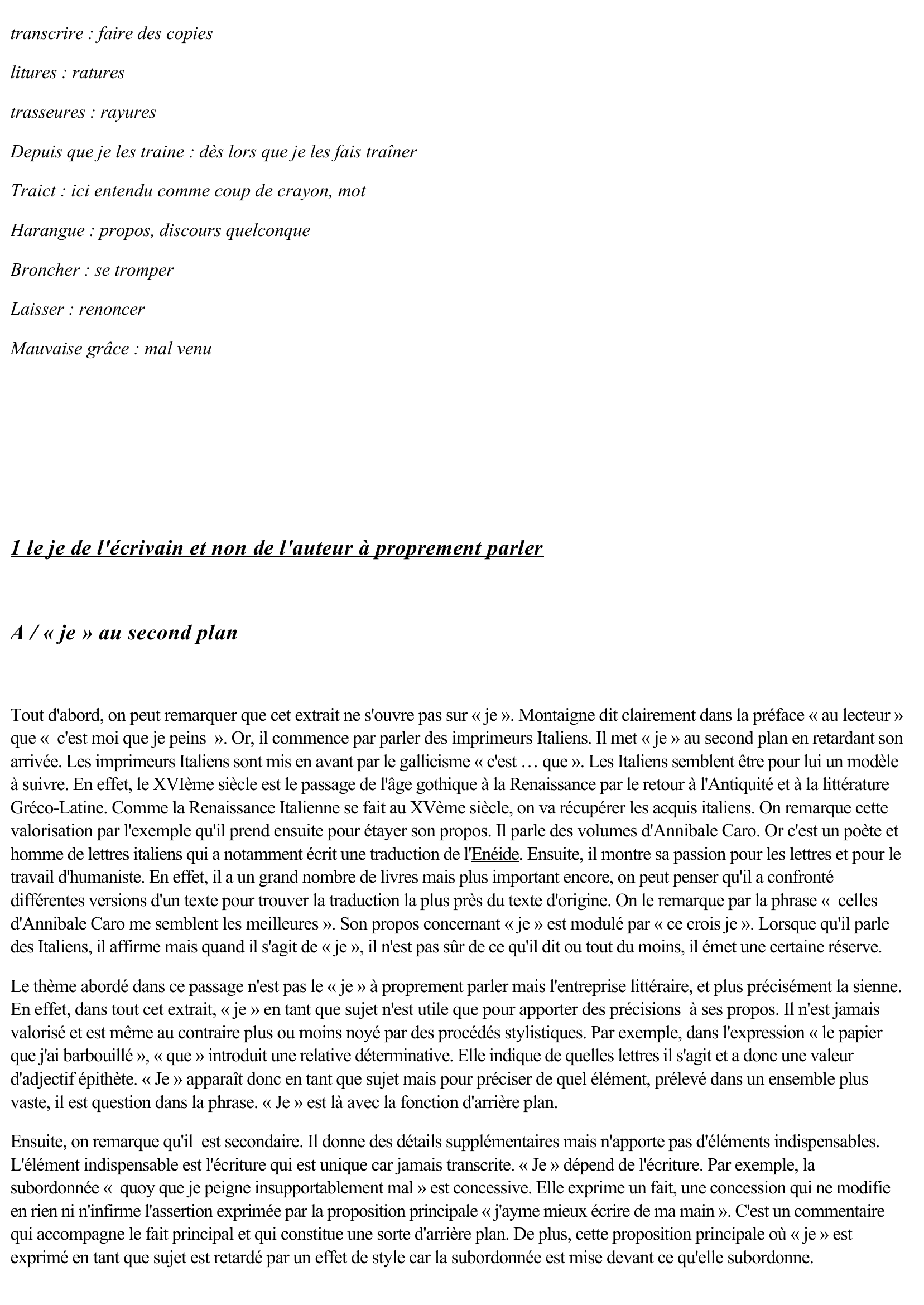Montaigne, Considération sur Cicéron
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Ce passage est tiré du livre 1 des Essais de Montaigne, plus précisément de l’essai XL intitulé considération sur Cicéron. C’est en effet à partir de cet orateur romain que débute sa pensée sur l’écriture. Montaigne évoquait plus haut les missives des philosophes et orateurs antiques d’une nature exagérément ambitieuse, la préférence à l’acte plus qu’aux belles paroles. Il raille ceux qui se font valoir par des qualités secondaires, voire indignes de leur rang, en prenant l’exemple de Philippe et Alexandre de Macédoine. Puis il revient sur la contradiction des philosophes, censés être familiers à la mort qui veulent écrire pour la postérité. Il dit qu’il n’est habile que dans le style privé et qu’il a en horreur les flatteurs. C’est ce dernier point qui introduit le texte que nous allons étudier, texte dont nous pouvons nous demander quel est l’intérêt d’abord par rapport à sa représentation du « je « et ensuite par rapport aux Essais, en effet on peut tirer deux idées principales du passage : d’une part l’expression d’un « je « mis au second plan, qui a différentes valeurs et d’autre part une conception particulière de l’entreprise littéraire.
«
transcrire : faire des copies
litures : ratures
trasseures : rayures
Depuis que je les traine : dès lors que je les fais traîner
Traict : ici entendu comme coup de crayon, mot
Harangue : propos, discours quelconque
Broncher : se tromper
Laisser : renoncer
Mauvaise grâce : mal venu
1 le je de l'écrivain et non de l'auteur à proprement parler
A / « je » au second plan
Tout d'abord, on peut remarquer que cet extrait ne s'ouvre pas sur « je ».
Montaigne dit clairement dans la préface « au lecteur »que « c'est moi que je peins ».
Or, il commence par parler des imprimeurs Italiens.
Il met « je » au second plan en retardant sonarrivée.
Les imprimeurs Italiens sont mis en avant par le gallicisme « c'est … que ».
Les Italiens semblent être pour lui un modèleà suivre.
En effet, le XVIème siècle est le passage de l'âge gothique à la Renaissance par le retour à l'Antiquité et à la littératureGréco-Latine.
Comme la Renaissance Italienne se fait au XVème siècle, on va récupérer les acquis italiens.
On remarque cettevalorisation par l'exemple qu'il prend ensuite pour étayer son propos.
Il parle des volumes d'Annibale Caro.
Or c'est un poète ethomme de lettres italiens qui a notamment écrit une traduction de l' Enéide .
Ensuite, il montre sa passion pour les lettres et pour le travail d'humaniste.
En effet, il a un grand nombre de livres mais plus important encore, on peut penser qu'il a confrontédifférentes versions d'un texte pour trouver la traduction la plus près du texte d'origine.
On le remarque par la phrase « cellesd'Annibale Caro me semblent les meilleures ».
Son propos concernant « je » est modulé par « ce crois je ».
Lorsque qu'il parledes Italiens, il affirme mais quand il s'agit de « je », il n'est pas sûr de ce qu'il dit ou tout du moins, il émet une certaine réserve.
Le thème abordé dans ce passage n'est pas le « je » à proprement parler mais l'entreprise littéraire, et plus précisément la sienne.En effet, dans tout cet extrait, « je » en tant que sujet n'est utile que pour apporter des précisions à ses propos.
Il n'est jamaisvalorisé et est même au contraire plus ou moins noyé par des procédés stylistiques.
Par exemple, dans l'expression « le papierque j'ai barbouillé », « que » introduit une relative déterminative.
Elle indique de quelles lettres il s'agit et a donc une valeurd'adjectif épithète.
« Je » apparaît donc en tant que sujet mais pour préciser de quel élément, prélevé dans un ensemble plusvaste, il est question dans la phrase.
« Je » est là avec la fonction d'arrière plan.
Ensuite, on remarque qu'il est secondaire.
Il donne des détails supplémentaires mais n'apporte pas d'éléments indispensables.L'élément indispensable est l'écriture qui est unique car jamais transcrite.
« Je » dépend de l'écriture.
Par exemple, lasubordonnée « quoy que je peigne insupportablement mal » est concessive.
Elle exprime un fait, une concession qui ne modifieen rien ni n'infirme l'assertion exprimée par la proposition principale « j'ayme mieux écrire de ma main ».
C'est un commentairequi accompagne le fait principal et qui constitue une sorte d'arrière plan.
De plus, cette proposition principale où « je » estexprimé en tant que sujet est retardé par un effet de style car la subordonnée est mise devant ce qu'elle subordonne..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les arts ont besoin de témoignages de considération; la soif de reconnaissance donne à tous de l'ardeur au travail alors qu'on abandonne vite une activité qui ne rencontre pas l'adhésion. [ 1re Tusculane, Devant la mort ] Cicéron. Commentez cette citation.
- c'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Essais, Au lecteur Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- Cicéron dit que philosopher ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. Essais, I, 20 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne
- Analyse rhétorique du discours de Cicéron pour Milon