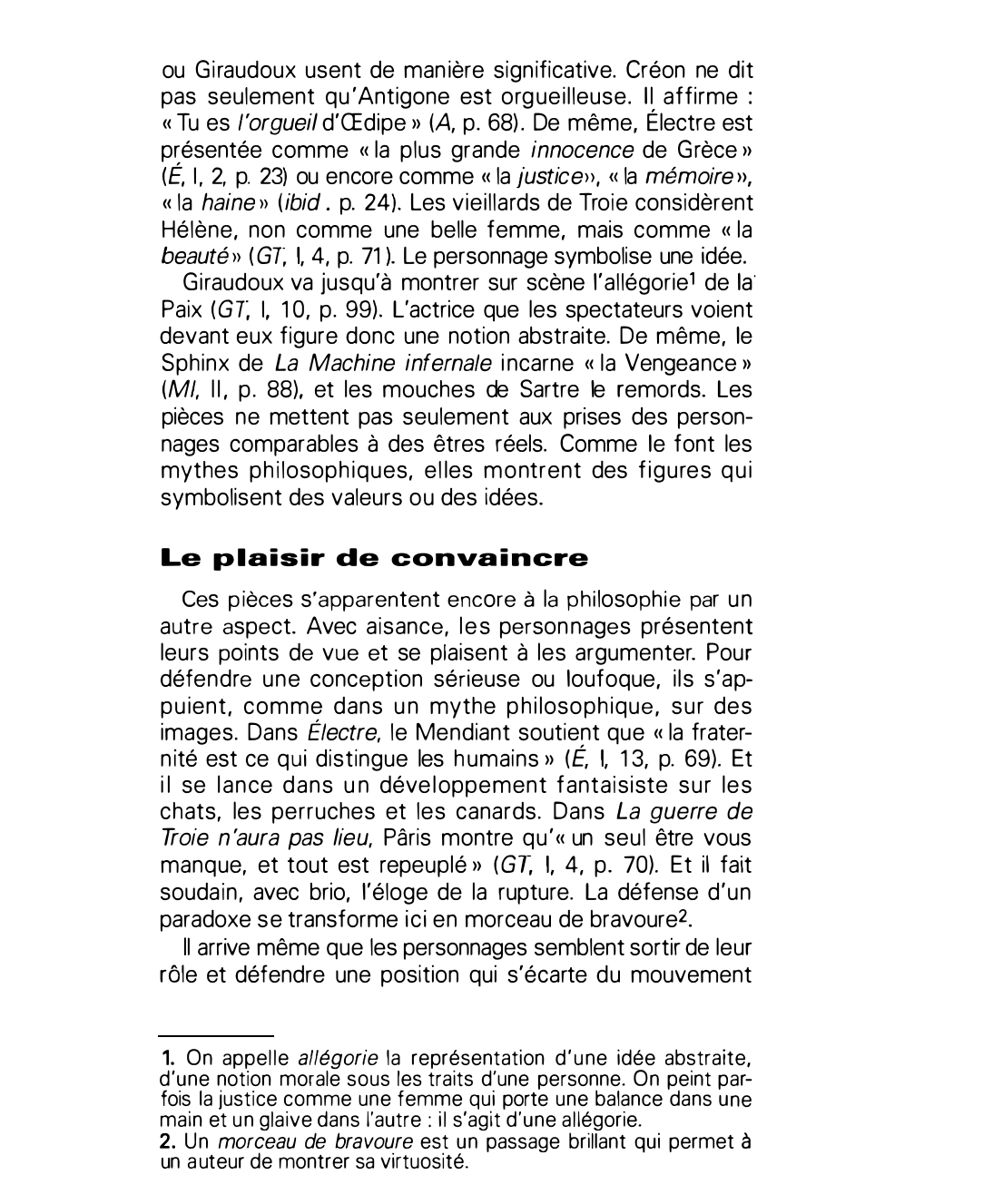Mythe et philosophie
Publié le 18/09/2018
Extrait du document

Mais tandis que le mythe philosophique est l'illustration d'un point de vue, les cinq pièces, elles, ne cherchent pas à nous faire partager une conception du monde. Les auteurs, en effet, brouillent les pistes et délivrent rarement un message clair. Ce sont des pièces «à idées», et non des pièces «à thèse» ou «à message». C'est-à-dire qu'elles brassent des réflexions de toutes sortes, mais sans insister, comme le mythe philosophique, sur une vérité essentielle, qui pourrait être résumée en une phrase.
Des contradictions
Les auteurs ne répugnent pas à la contradiction. Le Jardinier d'Électre dément continuellement ce qu'il vient d'affirmer :
Évidemment, la vie est ratée, mais c'est très, très bien, la vie. Évidemment rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais, mais parfois. avouez que ce)a va admirablement. que cela s'arrange admirablement. (E, Entracte, « Lamento du Jardinier», p. 72).
Dans La guerre de Troie n'aura pas Heu, l'expert Busiris passe d'une position à l'autre avec une facilité choquante. Il affirme d'abord que « les Grecs se sont rendus coupables de trois manquements aux règles internationales » (GT; Il, 5, p. 119). Hector intervient vivement : «Trouve une vérité qui nous sauve» (ibid., p. 121 ), ordonne-t-il. Busiris intimidé inverse alors sa position. Avec les arguments les plus subtils, il démontre que Troie n'a nullement été offensée par les Grecs. Apparemment, la vérité des experts est réversible. Cette aptitude à soutenir une opinion, puis à démontrer l'opinion inverse jette le doute sur les mécanismes de l'argumentation. Elle laisse le spectateur indécis et sceptique.

«
ou
Giraudoux usent de man ière significative.
Créon ne dit
pas seulement qu'Antigone est orgu eilleuse.
Il affirme :
«T u es l'orgueil d'Œdipe >> (A, p.
68) .
De même, Électre est
présentée comme «la plus grande innocence de Grèce >>
(É , 1, 2, p.
23) ou enc ore comme « la justi ce>>, « la mém oire>>,
«l a hai ne>> (ibid .
p.
24).
Les vieillar ds de Troie considèrent
Hélène, non comme une belle femme, mais comme «la
beauté >> ( GT, 1, 4, p.
71 ).
Le personnage symbolise une idée.
Gir audoux va jusqu' à montrer sur scène l'allégorie, de la·
Paix (GT, 1, 10 , p.
99).
L'actrice que les spectateurs voient
devant eux figure donc une notion abstraite.
De même, le
Sphinx de La Machine infernale incarne « la Vengea nce>>
(M i, Il, p.
88), et les mouches de Sartre le remords.
Les
pièces ne mettent pas seulement aux prises des person
nages comparables à des êtres réels.
Comme le font les
mythes philoso phique s, elles mon trent des figur es qui
symbolisent des valeurs ou des idées.
Le plaisir de conv aincre
Ces pièces s'apparentent encore à la phi losoph ie par un
autre aspect.
Avec aisance, les perso nnages présentent
leurs points de vue et se plaisent à les argume nter.
Pou r
déf endr e une conception sérieuse ou loufoque, ils s'ap
pu ient, comme dans un mythe philosoph ique, sur des
images.
Dans Électre, le Mendi ant soutient que «la frater
ni té est ce qui distingue les humains >> (É, 1, 13, p.
69).
Et
il se lanc e dans un déve loppement fantaisiste sur les
chats, les perruches et les canards.
Dans La guer re de
Tr oie n'aura pas lieu, Pâris montre qu'« un seul être vous
manq ue, et tout est rep euplé>> (G T, 1, 4, p.
70).
Et il fait
soud ain, avec brio, l'éloge de la rupture.
La défense d'un
paradoxe se transforme ici en morceau de bravoure2.
Il arri ve même que les personnages semblent sortir de leur
r61e et défendre une position qui s'écar te du mouvement
1.
On appel le allég orie la représentation d'une idée abstraite,
d'un e notion morale sous les traits d'une personne.
On peint par
fois la justice comme une femme qui porte une balance dans une
main et un glaive dans l'autre : il s'agit d'une all égorie.
2.
Un morceau de bravoure est un passage brillant qui permet à
un auteur de montrer sa virtuosité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Présocratiques : mythe et logos: Pourquoi la philosophie est-elle née ?
- Pourquoi la philosophie est-elle née sur les cendres du mythe et de la religion ?
- La philosophie se situe-t-elle entre le mythe et la science ?
- La philosophie est-elle un mythe ?
- Qu'est-ce que le mythe ? Quels peuvent être sa valeur et son rôle dans l'art, la morale et la philosophie ?