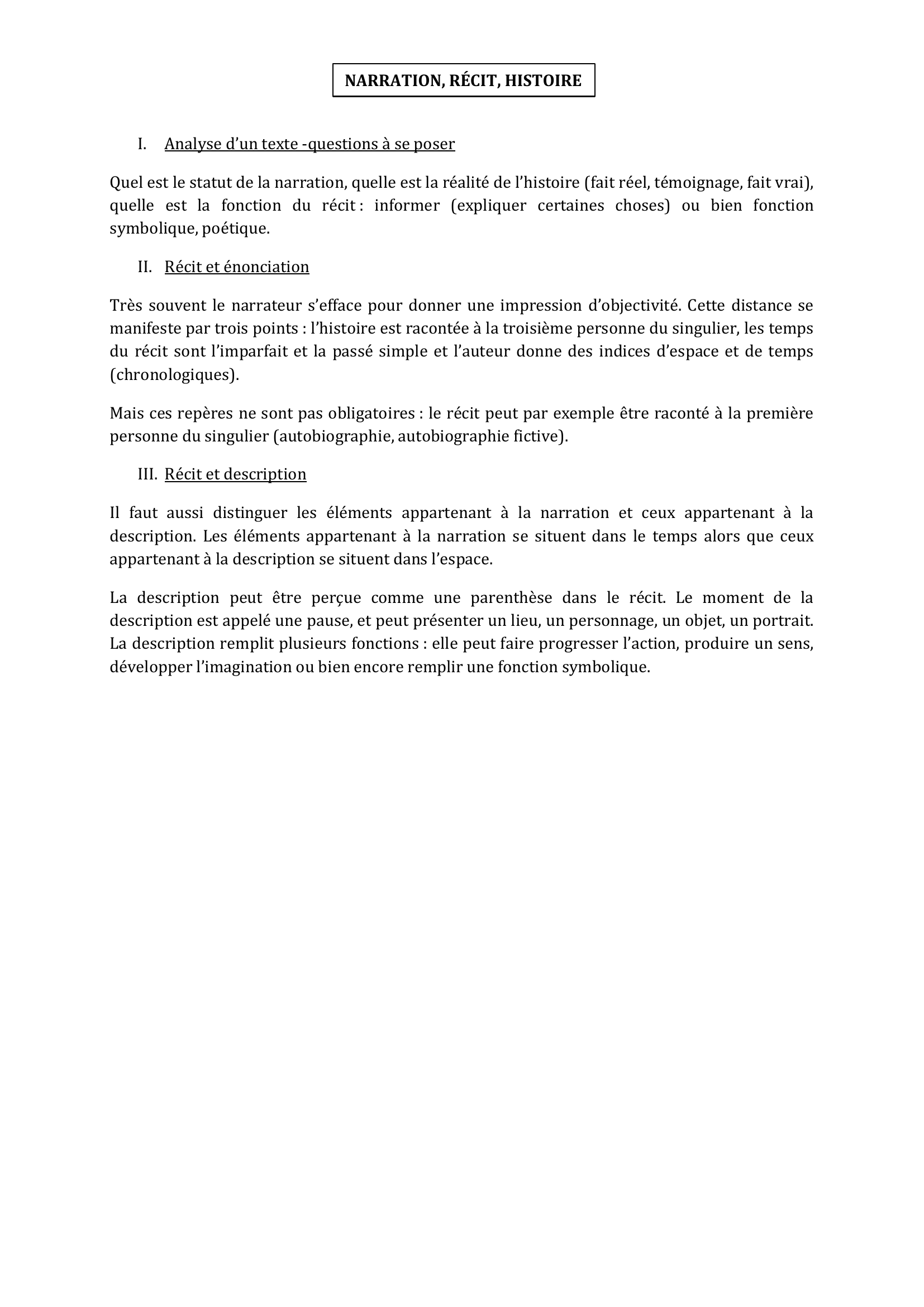NOUVELLE ET ROMAN
Publié le 15/09/2013

Extrait du document
«
I.
Analyse d’un texte - questions à se poser
Quel est le statut de la narration, quelle est la réalité de l’histoire (fait réel, témoignage, fait vrai),
quelle est la fonction du récit : informer (expliquer certaines choses) ou bien fonction
symbolique, poét ique.
II.
Récit et énonciation
Très souvent le narrateur s’efface pour donner une impression d’objectivité.
Cette distance se
manifeste par trois points : l’histoire est racontée à la troisième personne du singulier, les temps
du récit sont l’imparfait et la p assé simple et l’auteur donne des indices d ’espace et de temps
(chronologiques ).
Mais ces repères ne sont pas obligatoires : le récit peut par exemple être raconté à la première
personne du singulier (autobiographie, autobiographie fictive).
III.
Récit et descr iption
Il faut aussi distinguer les éléments appartenant à la narration et ceux appartenant à la
description.
Les éléments appartenant à la narration se situent dans le temps alors que ceux
appartenant à la description se situent dans l’espace.
La descrip tion peut être perçue comme une parenthèse dans le récit.
Le moment de la
description est appelé une pause, et peut présenter un lieu, un personnage, un objet, un portrait.
La description remplit plusieurs fonctions : elle peut faire progresser l’action, produire un sens,
développer l’imagination ou bien encore remplir une fonction symbolique.
NARRATION, RÉCIT, HISTOIRE.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉDOUARD (Mylord). Personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle Héloise
- ORBE Claire d’. Personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle Héloïse
- SAINT-PREUX. Personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle Hèloïse
- WOLMAR (Monsieur de). Personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle Héloïse
- JULIE D’ÉTANGE. Personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle Hêloïse