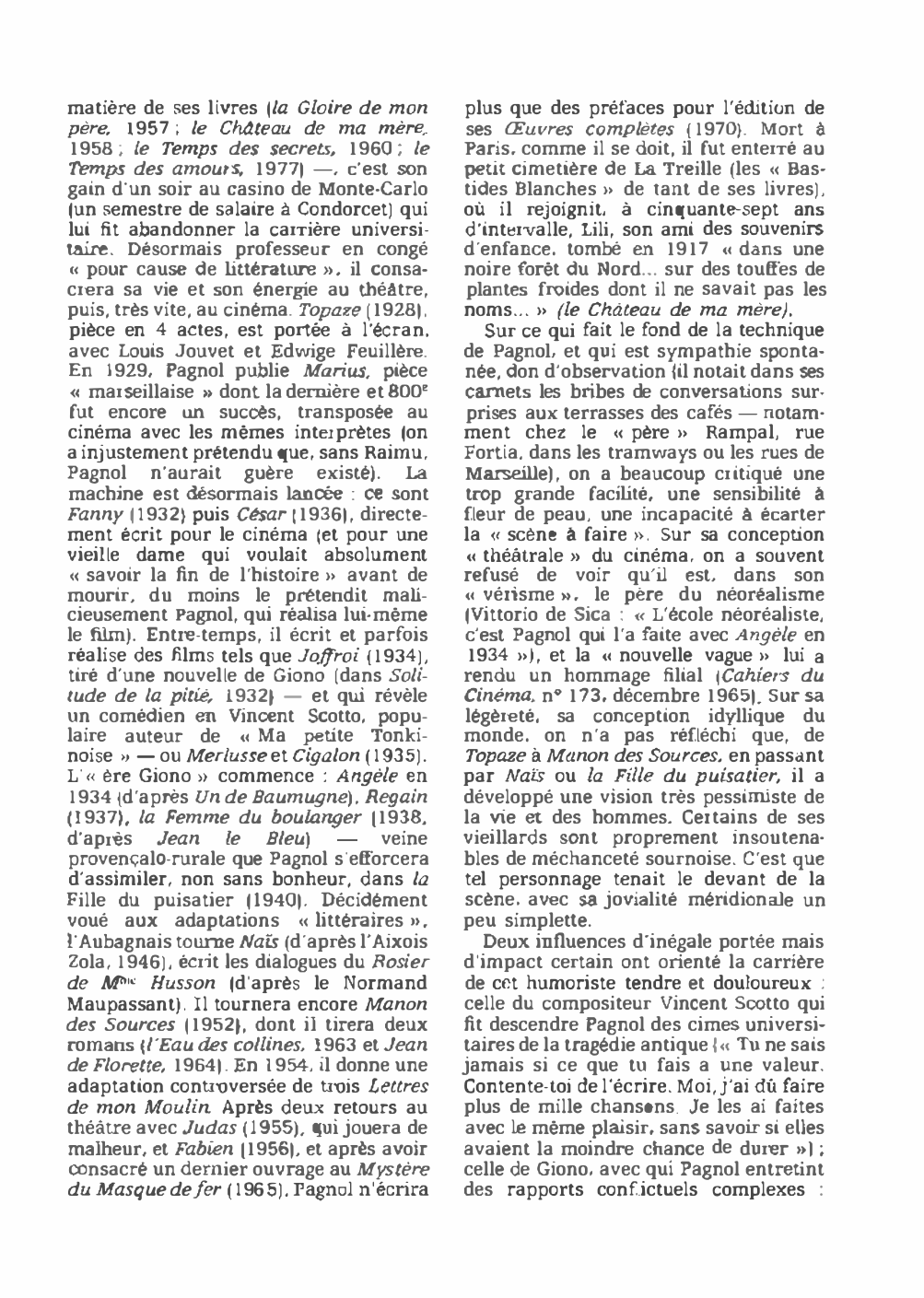PAGNOL (Marcel)
Publié le 11/03/2019

Extrait du document
PAGNOL (Marcel), écrivain et cinéaste français (Aubagne 1895 - Paris 1974). Fils d'un jeune instituteur et d'une jolie couturière — dont les silhouettes hanteront toute son œuvre pour devenir les personnages principaux de ses fameux Souvenirs d’enfance —, Marcel Pagnol, petit Provençal très tôt saisi par la littérature, fondera au sortir du lycée une revue littéraire, Fantasio, dans laquelle il publiera son premier roman, Pirouettes, et dont le principal mérite fut d'être le brouillon des illustres Cahiers du Sud. Professeur d'anglais au lycée Condorcet, il écrit (avec P. Nivoix) sa première pièce, les Marchands de gloire (1926), où se lit encore l'influence de Becque. En 1927, Phaëton, rebaptisé Jazz par R. Darzens, est joué au Théâtre des Arts. Mais, selon Pagnol lui-même, qui sut parfaitement organiser sa légende — toute sa vie, il raconta ses enfances à ses amis avant d’en faire la matière de ses livres (la Gloire de mon père, 1957 ; le Château de ma mère, 1958; le Temps des secrets, 1960; le Temps des amours, 1977) —, c'est son gain d'un soir au casino de Monte-Carlo (un semestre de salaire à Condorcet) qui lui fit abandonner la carrière universitaire. Désormais professeur en congé « pour cause de littérature », il consacrera sa vie et son énergie au théâtre, puis, très vite, au cinéma. Topaze (1928), pièce en 4 actes, est portée à l'écran, avec Louis Jouvet et Edwige Feuillère. En 1929, Pagnol publie Marius, pièce « marseillaise » dont la dernière et 800e fut encore un succès, transposée au cinéma avec les mêmes interprètes (on a injustement prétendu que, sans Raimu, Pagnol n’aurait guère existé). La machine est désormais lancée : ce sont Fanny (1932) puis César (1936), directement écrit pour le cinéma (et pour une vieille dame qui voulait absolument « savoir la fin de l'histoire » avant de mourir, du moins le prétendit malicieusement Pagnol, qui réalisa lui-même le film). Entre-temps, il écrit et parfois réalise des films tels que Joffroi (1934), tiré d'une nouvelle de Giono (dans Solitude de la pitié, 1932) — et qui révèle un comédien en Vincent Scotto, populaire auteur de « Ma petite Tonkinoise » — ou Merlusseel Cigalon (1935). L'« ère Giono » commence : Angèle en 1934 (d'après Un de Baumugne), Regain (1937), la Femme du boulanger (1938, d’après Jean le Bleu) — veine provençalo-rurale que Pagnol s’efforcera d'assimiler, non sans bonheur, dans la Fille du puisatier (1940). Décidément voué aux adaptations « littéraires », l'Aubagnais tourne Nais (d'après l'Aixois Zola, 1946), écrit les dialogues du Rosier de Husson (d’après le Normand Maupassant). Il tournera encore Manon des Sources (1952), dont il tirera deux romans (l'Eau des collines, 1963 et Jean de Florette, 1964). En 1954, il donne une adaptation controversée de trois Lettres de mon Moulin. Après deux retours au théâtre avec Judas (1955), qui jouera de malheur, et Fabien (1956), et après avoir consacré un dernier ouvrage au Mystère du Masque de fer ( 1965), Pagnol n'écrira
plus que des préfaces pour l'édition de ses Œuvres complètes (1970). Mort à Paris, comme il se doit, il fut enterré au petit cimetière de La Treille (les « Bastides Blanches » de tant de ses livres), où il rejoignit, à cinquante-sept ans d'intervalle, Lili, son ami des souvenirs d'enfance, tombé en 1917 « dans une noire forêt du Nord... sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms... » (le Château de ma mère).
Sur ce qui fait le fond de la technique de Pagnol, et qui est sympathie spontanée, don d’observation (il notait dans ses carnets les bribes de conversations surprises aux terrasses des cafés — notamment chez le « père » Rampai, rue Fortia, dans les tramways ou les rues de Marseille), on a beaucoup critiqué une trop grande facilité, une sensibilité à fleur de peau, une incapacité à écarter la « scène à faire ». Sur sa conception « théâtrale » du cinéma, on a souvent refusé de voir qu'il est, dans son « vérisme », le père du néoréalisme (Vittorio de Sica : « L'école néoréaliste, c'est Pagnol qui l'a faite avec Angèle en 1934 »), et la « nouvelle vague » lui a rendu un hommage filial (Cahiers du Cinéma, n° 173, décembre 1965). Sur sa légèreté, sa conception idyllique du monde, on n'a pas réfléchi que, de Topaze à Manon des Sources, en passant par Nais ou la Fille du puisatier, il a développé une vision très pessimiste de la vie et des hommes. Certains de ses vieillards sont proprement insoutenables de méchanceté sournoise. C'est que tel personnage tenait le devant de la scène, avec sa jovialité méridionale un peu simplette.
Deux influences d'inégale portée mais d'impact certain ont orienté la carrière de cet humoriste tendre et douloureux : celle du compositeur Vincent Scotto qui fit descendre Pagnol des cimes universitaires de la tragédie antique ( « Tu ne sais jamais si ce que tu fais a une valeur. Contente-toi de l'écrire. Moi, j'ai dù faire plus de mille chansons. Je les ai faites avec le même plaisir, sans savoir si elles avaient la moindre chance de durer ») ; celle de Giono, avec qui Pagnol entretint des rapports conflictuels complexes :
«
matière
de ses livres (la Gloire de mon
père, 1957; le Chd te au de ma mère,
1958 ; le Temps des secrets, 1960 ; le
Temps des amours, 1977) -, c'est son
gain d'un soir au casino de Monte-Carlo
(un semestre de salaire à Condorcet) qui
lui fit abandonner la carrière universi
taire.
Désormais professeur en congé.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SOUVENIRS D'ENFANCE. Marcel Pagnol (résumé)
- TOPAZE Marcel Pagnol (résumé & analyse)
- EAU DES COLLINES (L') de Marcel Pagnol (résumé & analyse)
- TOPAZE de Marcel Pagnol : Fiche de lecture
- MARIUS de Marcel Pagnol (résumé)