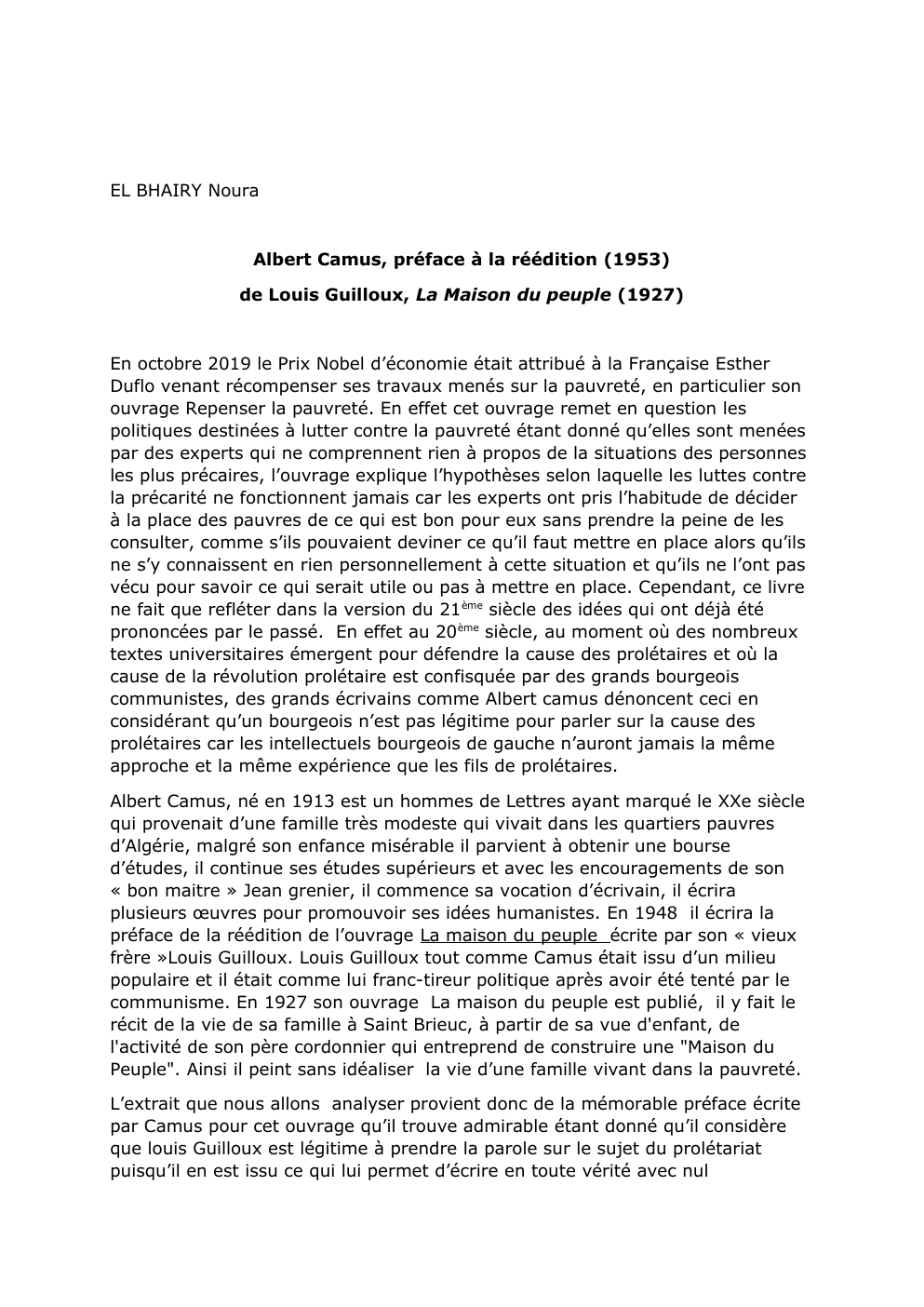préface de Camus la maison du peuple
Publié le 27/10/2022

Extrait du document
«
Albert Camus, préface à la réédition (1953)
de Louis Guilloux, La Maison du peuple (1927)
En octobre 2019 le Prix Nobel d’économie était attribué à la Française Esther
Duflo venant récompenser ses travaux menés sur la pauvreté, en particulier son
ouvrage Repenser la pauvreté.
En effet cet ouvrage remet en question les
politiques destinées à lutter contre la pauvreté étant donné qu’elles sont menées
par des experts qui ne comprennent rien à propos de la situations des personnes
les plus précaires, l’ouvrage explique l’hypothèses selon laquelle les luttes contre
la précarité ne fonctionnent jamais car les experts ont pris l’habitude de décider
à la place des pauvres de ce qui est bon pour eux sans prendre la peine de les
consulter, comme s’ils pouvaient deviner ce qu’il faut mettre en place alors qu’ils
ne s’y connaissent en rien personnellement à cette situation et qu’ils ne l’ont pas
vécu pour savoir ce qui serait utile ou pas à mettre en place.
Cependant, ce livre
ne fait que refléter dans la version du 21ème siècle des idées qui ont déjà été
prononcées par le passé.
En effet au 20ème siècle, au moment où des nombreux
textes universitaires émergent pour défendre la cause des prolétaires et où la
cause de la révolution prolétaire est confisquée par des grands bourgeois
communistes, des grands écrivains comme Albert camus dénoncent ceci en
considérant qu’un bourgeois n’est pas légitime pour parler sur la cause des
prolétaires car les intellectuels bourgeois de gauche n’auront jamais la même
approche et la même expérience que les fils de prolétaires.
Albert Camus, né en 1913 est un hommes de Lettres ayant marqué le XXe siècle
qui provenait d’une famille très modeste qui vivait dans les quartiers pauvres
d’Algérie, malgré son enfance misérable il parvient à obtenir une bourse
d’études, il continue ses études supérieurs et avec les encouragements de son
« bon maitre » Jean grenier, il commence sa vocation d’écrivain, il écrira
plusieurs œuvres pour promouvoir ses idées humanistes.
En 1948 il écrira la
préface de la réédition de l’ouvrage La maison du peuple écrite par son « vieux
frère »Louis Guilloux.
Louis Guilloux tout comme Camus était issu d’un milieu
populaire et il était comme lui franc-tireur politique après avoir été tenté par le
communisme.
En 1927 son ouvrage La maison du peuple est publié, il y fait le
récit de la vie de sa famille à Saint Brieuc, à partir de sa vue d'enfant, de
l'activité de son père cordonnier qui entreprend de construire une "Maison du
Peuple".
Ainsi il peint sans idéaliser la vie d’une famille vivant dans la pauvreté.
L’extrait que nous allons analyser provient donc de la mémorable préface écrite
par Camus pour cet ouvrage qu’il trouve admirable étant donné qu’il considère
que louis Guilloux est légitime à prendre la parole sur le sujet du prolétariat
puisqu’il en est issu ce qui lui permet d’écrire en toute vérité avec nul
manichéisme.
Il utilise donc sa préface pour défendre son idée selon laquelle les
bourgeois de gauche ne seraient pas aptes à émettre un avis sur une cause dont
ils ne s’y connaissent pas.
Ceci nous mènera à nous demander de quelle manière Camus prétend-t-il que la
lutte des intellectuels communistes ouvrant pour la cause prolétaire à travers
leurs ouvrages serait inapte et insignifiante face aux travaux menées par des fils
de prolétaire.
Pour répondre à ceci nous verrons dans un premier temps comment à travers ce
texte Camus remet en cause la légitimité de la parole de l’intellectuel bourgeois
menant un engagement politique qui ne lui est pas propre puis nous nous
intéresserons au fait que selon Camus des origines modestes donnent la
légitimité de la parole quand c’est pour émettre des propos sur la situation du
prolétariat.
I/ La remise en cause de la légitimité de la parole de l’intellectuel
communiste menant un engagement politique qui ne lui est pas propre
A) Le paradoxe d’une lutte mené par des bourgeois œuvrant pour la
cause prolétaire
Au cours du 20ème siècle les intellectuels français ont été présents dans toutes les
luttes où la pensée et l'écriture pouvaient être utilisées comme des armes.
Beaucoup d’intellectuels bourgeois de gauche s’inscrivaient dans le combat qui
œuvrait pour la cause prolétaire bien qu’il existait une énorme frontière entre
leur milieu social et celui qu’ils prétendaient défendre.
C’est le paradoxe de cette lutte que Camus vient soulever lors de cet extrait, il
cite d’entrée « Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd’hui
parler au nom du prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés ».
C’est une
phrase qu’il citait en étant conscient des problèmes et critiques qu’il recevrait en
retour étant donné que nombreux étaient les communistes de son époque qui
défendaient la cause prolétaire en étant issues de milieux aisées.
Il les
connaissait et sans doute les visait.
Parmi eux son ancien ami Jean-Paul Sartre
avec qui il s’était éloigner en raison des avis divergents qui existait entre eux
après que Camus décide d’abandonner le communisme.
Des nombreuses
querelles existent entre les deux écrivains surtout après l’émergence de l’idée de
Camus voyant dans la lutte des bourgeois pour la cause prolétaire un grand
paradoxe.
Des nombreux échanges entre les deux sont publiés dans la revue
politique Les temps modernes où Sartre d’un côté reproche à Camus de remettre
en cause ses compétences philosophiques et dit qu’il refuse de faire une
distinction entre lui et les opprimés et de l’autre Camus qui lui répond dans une
des multiples lettres qu’il lui fait qu’il refuse de se faire dire quoi écrire par des
intellectuels qui défendent certaines idées révolutionnaires tout en vivant dans le
velours.
Pour lui Sartre a beau, en ces années-là, se situer toujours plus à
gauche, il reste un héritier.
Ainsi on comprend que pour Camus la parole émise
par ces intellectuels n’est pas légitime et qu’elle relève de quelque chose qui ne
serait pas logique selon lui.
A la ligne 3 il cite « Je me borne à signaler au
sociologue une anomalie et un objet d’études.
» En effet il ne comprend pas
comment un bourgeois pourrait parler légitimement d’une classe sociale qui est
à distance de la sienne.
Il ne critique donc pas la classe bourgeoise mais critique
le fait que celle-ci parle au nom d’une autre classe qu’elle méconnait et que
même si elle chercherait à connaitre des éléments sur celle-ci, ceci ne serait pas
suffisant pour lui permettre de réaliser des œuvres entières à son propos comme
si elle en était concerné.
C’est pour ces raisons que Camus dit dans la préface
« Ce n’est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance, et je ne trouve cela ni
bien ni mal » En ajoutant quelques lignes plus tard « On peut d’ailleurs essayer
d’expliquer ce paradoxe en soutenant, avec un sage de mes amis, que parler de
ce qu’on ignore finit par vous l’apprendre.
»
C’est cette même idée qu’il reprend plus tard et qui est expliqué par Jean Daniel
au journal le monde en 2010.
Daniel dirigeait la revue Caliban en 1947 et s’étant
lié d’amitié avec Camus publie un article portant sur la préface.
Suite à ceci
Clause Roy, écrivain français bourgeois contacte Daniel en lui disant "Alors il y
aura donc une légitimité de la misère ? Il faudrait un examen de passage avant
d'en parler ?" Ce à quoi Camus répond "Ne t'en fais pas (...), de toute manière,
ils ont partiellement raison.
Les penseurs révolutionnaires sont tous d'origine
bourgeoise.
Qu'ils nous enseignent à sortir de la misère d'accord, mais qu'ils
écrivent comme s'ils en étaient, jamais ! "
B) La critique de propos menés par des intellectuels bourgeois
possédant juste un regard extérieur sur le prolétariat sans réelle
connaissance de la situation
Ainsi Camus continue à affirmer son idée, pour lui l’écart de classe est une
grande entrave qui ne leur permet pas de parler de la cause prolétaire.
C’est
donc pour cela qu’il émet une critique des propos menés par des intellectuels
bourgeois possédant juste un regard extérieur sur la prolétariat sans réelle
connaissance de la situation.
Dans la préface il cite « La pauvreté, par exemple,
laisse à ceux qui l’ont vécue une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un
certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause.
».
Ici on peut
constater que l’attaque en est délibérément offensive.
Pour Camus les
intellectuels communistes n’ont aucune expérience de la condition prolétarienne
ce qui leur ferait avoir un regard seulement extérieur qui n’assurerait pas des
informations exactes.
Pour lui leur regard sur le prolétariat serait celui d’un
ethnologue devant une « tribu » et il justifiera ses propos en utilisant comme
exemple des textes universitaires qui parlent des prolétaires comme une “ tribu
aux étranges coutumes ”.
Le risque résiderait donc selon lui, dans le fait de
sombrer dans la “ flatterie dégoutante ” , de basculer dans le mépris insultant,
dans la sublimation imaginaire et de cette façon mener des luttes en s’appuyant
sur des stéréotypes.
Ainsi selon Camus des luttes sont menées en étant basées
sur des mythes étant donné que ceux qui les mènent ne peuvent pas avoir une
approche véridique car ils ne se sont jamais retrouver dans la situation de ceux
pour qui ils prétendent combattre.
De plus la manière dont ils écrivent leur
ouvrage risque de ne pas être comprise par les principaux concernés, les
prolétaires.
Camus vient donc également critique ceci puisque comment mener
un combat si on risque de ne même pas être compris par les personnes que l’on
prétend défendre ? Ceci peut également créer une frustration par les prolétaires....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MAISON DU PEUPLE (La). (résumé)
- Le Temple Bâti sur le mont Moria, le temple, c'est la maison de Dieu à Jérusalem, lieu central du culte pour le peuple juif.
- 178997 Quand Israël sortit d'Égypte, Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine.
- Expliquer cette pensée de Beaumarchais (Préface du Barbier de Séville) : « Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme à la barbe et dans la maison du tuteur. Voilà le fond, dont on eût pu faire9 avec un égal succès, une tragédie, une comédie, un drame, un opéra, etc. L'Avare de Molière est-il autre chose? Le grand Mithridate est-il autre chose? Le genre d'une pièce, comme celui de toute autre action
- Un personnage du roman de Roger lkor, Les poulains, se demande ce que doit apporter aux hommes une maison de la culture et il sep dit : « Ce ne sera gagné que si Socrate et Paulo se sentent pareillement chez eux dans ma maison. Alors un jardin pour Socrate et un juke-box pour Paulo ? Cela revient à se demander si l'éducation doit s'abaisser au niveau du peuple pour l'aider à se hisser vers les sommets, ou se placer d'emblée au sommet, quitte à décourager les bonnes volontés. En somme,