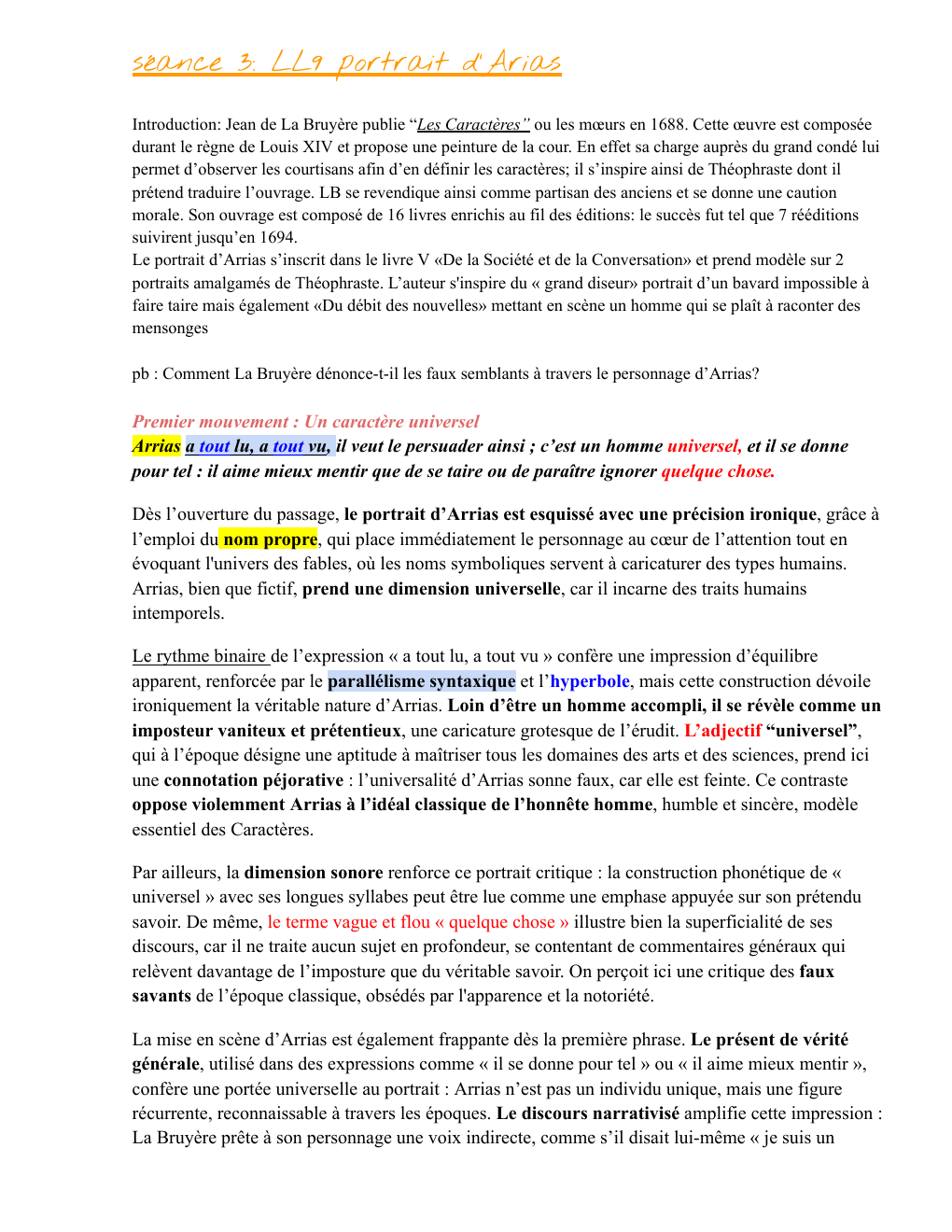séance 3: LL9 portrait d’Arias
Publié le 21/10/2025
Extrait du document
«
séance 3: LL9 portrait d’Arias
Introduction: Jean de La Bruyère publie “Les Caractères” ou les mœurs en 1688.
Cette œuvre est composée
durant le règne de Louis XIV et propose une peinture de la cour.
En effet sa charge auprès du grand condé lui
permet d’observer les courtisans afin d’en définir les caractères; il s’inspire ainsi de Théophraste dont il
prétend traduire l’ouvrage.
LB se revendique ainsi comme partisan des anciens et se donne une caution
morale.
Son ouvrage est composé de 16 livres enrichis au fil des éditions: le succès fut tel que 7 rééditions
suivirent jusqu’en 1694.
Le portrait d’Arrias s’inscrit dans le livre V «De la Société et de la Conversation» et prend modèle sur 2
portraits amalgamés de Théophraste.
L’auteur s'inspire du « grand diseur» portrait d’un bavard impossible à
faire taire mais également «Du débit des nouvelles» mettant en scène un homme qui se plaît à raconter des
mensonges
pb : Comment La Bruyère dénonce-t-il les faux semblants à travers le personnage d’Arrias?
Premier mouvement : Un caractère universel
Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi ; c’est un homme universel, et il se donne
pour tel : il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose.
Dès l’ouverture du passage, le portrait d’Arrias est esquissé avec une précision ironique, grâce à
l’emploi du nom propre, qui place immédiatement le personnage au cœur de l’attention tout en
évoquant l'univers des fables, où les noms symboliques servent à caricaturer des types humains.
Arrias, bien que fictif, prend une dimension universelle, car il incarne des traits humains
intemporels.
Le rythme binaire de l’expression « a tout lu, a tout vu » confère une impression d’équilibre
apparent, renforcée par le parallélisme syntaxique et l’hyperbole, mais cette construction dévoile
ironiquement la véritable nature d’Arrias.
Loin d’être un homme accompli, il se révèle comme un
imposteur vaniteux et prétentieux, une caricature grotesque de l’érudit.
L’adjectif “universel”,
qui à l’époque désigne une aptitude à maîtriser tous les domaines des arts et des sciences, prend ici
une connotation péjorative : l’universalité d’Arrias sonne faux, car elle est feinte.
Ce contraste
oppose violemment Arrias à l’idéal classique de l’honnête homme, humble et sincère, modèle
essentiel des Caractères.
Par ailleurs, la dimension sonore renforce ce portrait critique : la construction phonétique de «
universel » avec ses longues syllabes peut être lue comme une emphase appuyée sur son prétendu
savoir.
De même, le terme vague et flou « quelque chose » illustre bien la superficialité de ses
discours, car il ne traite aucun sujet en profondeur, se contentant de commentaires généraux qui
relèvent davantage de l’imposture que du véritable savoir.
On perçoit ici une critique des faux
savants de l’époque classique, obsédés par l'apparence et la notoriété.
La mise en scène d’Arrias est également frappante dès la première phrase.
Le présent de vérité
générale, utilisé dans des expressions comme « il se donne pour tel » ou « il aime mieux mentir »,
confère une portée universelle au portrait : Arrias n’est pas un individu unique, mais une figure
récurrente, reconnaissable à travers les époques.
Le discours narrativisé amplifie cette impression :
La Bruyère prête à son personnage une voix indirecte, comme s’il disait lui-même « je suis un
homme universel ».
Ce choix de style permet au lecteur de ressentir le ridicule d’Arrias en
l’imaginant s’exprimer avec une assurance démesurée.
L’ironie mordante de La Bruyère réside enfin dans le vocabulaire de l’artifice, particulièrement
dans les verbes tels que « paraître » ou « se donner pour tel », qui révèlent une obsession du paraître
chez Arrias.
Ce personnage ne cherche pas à acquérir un véritable savoir, mais à en afficher
l’illusion.
La chute du masque est immédiate grâce à l’intervention explicite du narrateur : « il veut
le persuader ainsi ».
Cette dénonciation directe des faux-semblants ancre la critique dans une
réflexion plus large sur les travers humains, où l’apparence triomphe souvent de la réalité.
deuxième mouvement : Une anecdote satirique
On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord : il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient
dire ce qu’ils en savent ; il s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en était originaire ; il
discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes ; il récite des
historiettes qui y sont arrivées ; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater.
Dès les premières lignes, le cadre spatial se dessine avec précision, soulignant la place qu’occupe
Arrias dans un milieu social élevé.
Les expressions telles que « table d’un Grand » et « cour du Nord
» ancrent le personnage dans un contexte aristocratique, un environnement prestigieux et codifié.
Cependant, cette mise en scène dévoile également une critique implicite : en évoluant dans ces
cercles, Arrias ne se contente pas d’y être présent, il s’impose au centre de l’attention par une
attitude ostentatoire et inconvenante.
La longueur de la phrase, qui s’étire sur six lignes, reflète
cette propension à s’approprier l’espace discursif, tandis que l’antithèse entre “prend” et “ôte”
accentue l’image d’un véritable « voleur de parole », selon l’expression suggestive de La Bruyère.
L’usage du pronom indéfini “on” confère une portée universelle à la situation, transformant une
anecdote singulière en critique intemporelle des courtisans, dont le comportement reste
reconnaissable à travers les époques.
Ce choix est renforcé par la multiplication de la troisième
personne dans des phrases comme « il prend… il s’oriente… il discourt », qui met en relief
l’omniprésence d’Arrias dans la scène.
L’énumération “des mœurs, des femmes, des lois, des
coutumes”, dépourvue d’ordre logique, illustre bien l’agitation et la superficialité du personnage,
cherchant avant tout à impressionner par un savoir factice.
Le verbe “discourt”, à la connotation péjorative, évoque l’image d’un orateur pompeux,
transformant une simple conversation en véritable conférence.
Cette attitude se traduit également par
l’emploi de “récite”, qui présente Arrias comme un comédien jouant un rôle.
Le terme
“historiettes”, quant à lui, dévalorise ses propos en soulignant leur futilité et leur manque de
profondeur.
La Bruyère accentue ainsi l’artificialité du personnage, dont le comportement repose sur
la duperie et l’exagération.
Cette théâtralisation atteint son apogée dans l’image de l’explorateur imaginaire suggérée par le
verbe « s’orienter ».
Employé métaphoriquement, ce terme évoque à la fois un mouvement physique
et une prise de parole stratégique : Arrias semble manier son discours comme un navigateur
manipulant une boussole.
En prétendant être « originaire » d’une région lointaine, il alimente
l’illusion d’un savoir qu’il ne possède pas, jouant avec l’exotisme pour séduire son auditoire.
Cette stratégie repose sur le décalage entre la réalité et la fiction, un ressort narratif qui rend la
scène à la fois comique et révélatrice.
La critique de La Bruyère se resserre sur l’excès et le narcissisme d’Arrias, soulignés par
l’hyperbole « jusqu’à éclater », qui décrit un homme bruyant et démesuré.
Le complément
circonstanciel “le premier” aggrave encore son attitude : non seulement il s’amuse de ses propres
propos, mais il anticipe les réactions de son public, qu’il domine par sa suffisance.
Cette scène,
presque filmique, met en lumière un personnage incapable de respecter les codes de bienséance :
Arrias ne se contente pas d’être un acteur exubérant, il devient également spectateur de son propre
jeu, prenant plaisir à se contempler dans son rôle.
Enfin, la chute du récit est déjà en germe dans cette partie.
La mention d’un « lieu lointain » et
l’expression en filigrane de l’adage « À beau mentir qui vient de loin » annoncent ironiquement la
révélation finale.
Le verbe “mentir”, présent dès la première phrase, se trouve ici réactivé, tandis
que la subordonnée « ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent » laisse deviner le décalage entre le
discours d’Arrias et la réalité.
Le verbe “savoir”, opposé à « ignorer », rappelle l’inanité de ses
prétentions : contrairement à lui, d’autres possèdent un savoir authentique.
troisième mouvement : une interruption contrariante
Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas
vraies.
Arrias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l’interrupteur : « Je n’avance, lui
dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original : je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de
France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Séance 3 : Quelques rencontres fatidiques : un thème littéraire Cours complet
- analyse linéaire Les Caractères V, 9 (portrait d'Arrias)
- La beauté dans la laideur en poésie _ Séance 14 : Du Parnasse ... au Symbolisme
- Portrait de Mlle de Chartres
- Bilan de la séance 1 : comment le régime politique de la III e République est-il fondé et stabilisé (1870-1884) ?