Victor Hugo, Les Misérables, 1862, 1ère partie, Livre 7ème, Chapitre 3 : Une tempête sous un crâne de « Il se demanda donc où il en était... » / « Pour la 1ère fois depuis 8 années » à «...c'était en sortir en réalité.»)
Publié le 21/01/2022

Extrait du document
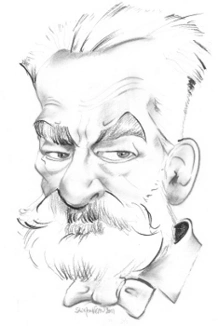
«
sa véritable identité et en laissant accuser à sa place Champmathieu.
Mais
cette décision ne lui procure pas la joie attendue.
L'ancien forçat se trouve
dans l'obligation de continuer à se sonder comme l'exprime la conjonction
de coordination à valeur de conséquence « donc ».
« Il se demanda
donc
où il en était » (ligne.
1) .
L'expression « où il en était » signale,
quant à elle, le nécessaire « état des lieux » auquel doit se livrer Jean
Valjean.
Le choix de la focalisation interne , amorcée par les verbes utilisés par le
narrateur, nous permet donc d'épouser le point de vue du personnage qui
poursuit son introspection : « Il
s’interrogea sur cette « résolution
prise ».
Il se confessa à lui-même que tout ce qu’il venait
d’arranger
dans son esprit était monstrueux, que « laisser aller
les
choses, laisser faire le bon Dieu », c’était tout simplement
horrible » ( ligne 3) Ces verbes : (« se demander » ( l.
1),
« s'interroger » (l.1), « se confesser » (l.
1) sont soumis à une gradation.
Chacun d'eux signale un degré supplémentaire d'approfondissement dans
l'auto-analyse engagée.
« Se demander », terme un peu vague, conserve
une certaine neutralité, alors que « s'interroger » accentue l'effort de
discernement, donne à l'entreprise un cadre plus formel.
L'emploi du
verbe « se confesser » rend compte de la dimension religieuse de la
réflexion dont l'issue a une portée hautement morale : faire le choix du
Bien ou du Mal.
C'est bien d'un homme seul face à sa conscience, seul
face à Dieu dont nous parle ici le narrateur.
Il s'agit dans les trois cas de verbes pronominaux qui montrent l'activité
réflexive entreprise par le maire de Montreuil, activité réflexive renforcée,
pour le dernier, par le COI« à lui-même » (l.
2).
Le fait de mettre entre guillemets l'expression « la résolution prise »,
montre la mise à distance de cette décision .
Cela est d'ailleurs confirmé
par la périphrase « tout ce qu'il venait d 'arranger dans son esprit » (l.2)
le verbe « arranger » rendant compte du « bricolage » moral orchestré
par l'ancien forçat.
De plus, Jean Valjean fustige durement cette première
résolution en recourant à des adjectifs dévalorisants tels « monstrueux »,
« horrible ».
Le protagoniste questionne d'autres formules, exprimées par lui en
pensée : « laisser aller les choses, laisser faire le bon Dieu » (l.3) et
s'indigne de la passivité qui allait être la sienne.
Cette passivité est rendue
par la périphrase verbale « laisser +infinitif » où le semi-auxiliaire dit
l'absence de volonté exercée par le sujet.
La passivité est ici synonyme de
lâcheté et de manquement grave à la morale « dernier degré de l'indignité
hypocrite, « crime ».
Les lignes suivantes prennent la forme d'un monologue intérieur qui
précipite le lecteur au sein de la conscience torturée de l'ancien bagnard.
«
Laisser s’accomplir cette méprise de la destinée et des hommes,
ne
pas l’empêcher, s’y prêter par son silence, ne rien faire enfin,
c’était
faire tout ! c’était le dernier degré de l’indignité hypocrite !
c’était
un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux ! » (l.
6)Le
narrateur s'efface pour laisser place aux seules pensées de son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor HUGO, Les Misérables, Première partie, Livre quatrième, chapitre 2, 1862.
- Victor HUGO (1802-1885). Le dedans du désespoir. (Livre II, « La chute », chapitre 7.) Les Misérables (Ire partie).
- Victor Hugo : « Misérables » Livre 6 - 4ème partie – Chapitre 11 (commentaire)
- Les Misérables (1862) HUGO - IIe partie, chapitre 10, « Le plateau de Mont Saint-Jean ».
- Victor Hugo, Les Misérables, V, livre 1, chapitre 15 : « la mort de Gavroche ». Commentaire composé

































