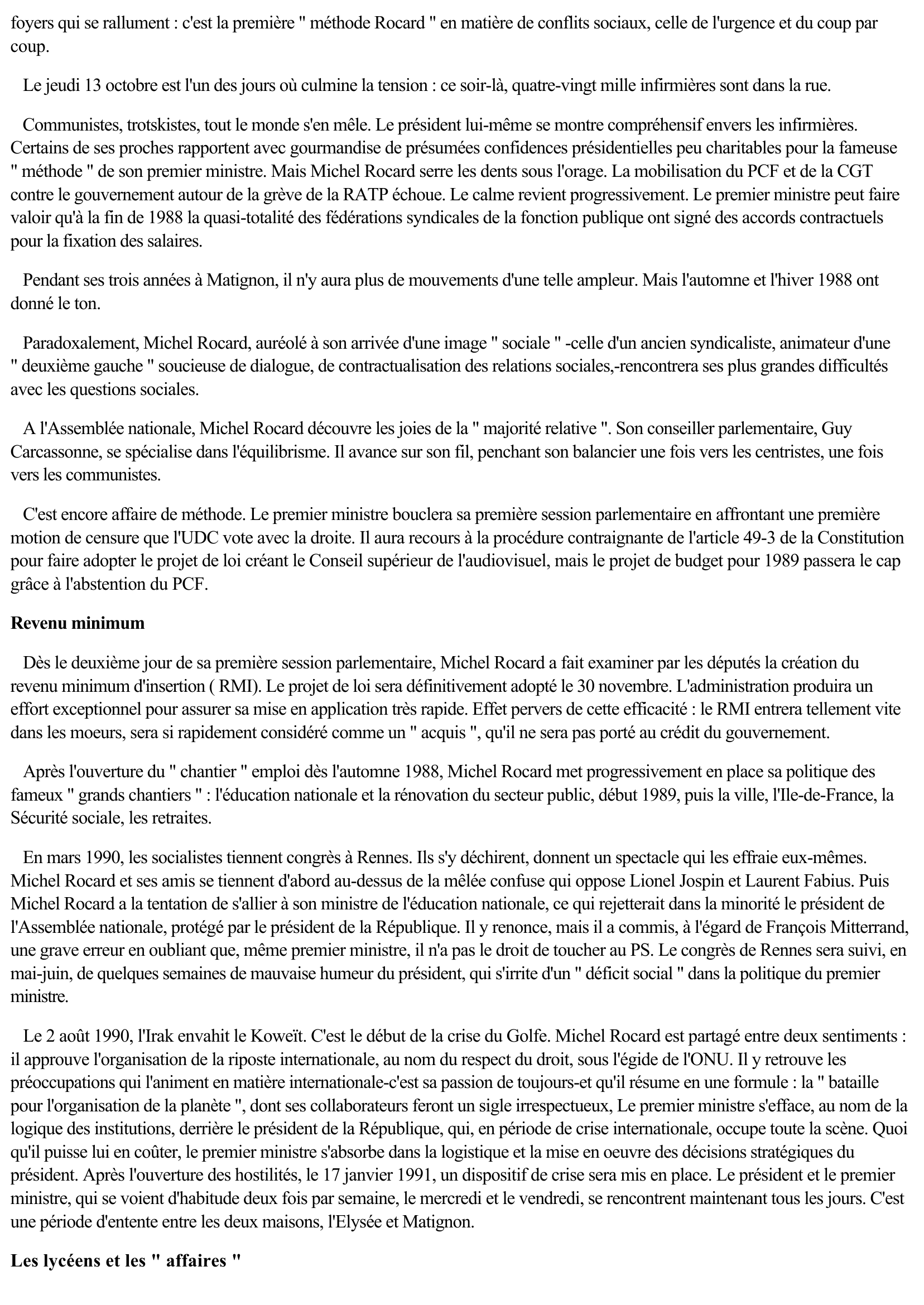2 avril 1992 - Une femme à Matignon ! Le choix par M. François Mitterrand de Mme Edith Cresson pour remplacer, le 15 mai 1991, M. Michel Rocard à la tête du gouvernement a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Depuis des semaines le " Tout-Paris politique " bruissait de ces rumeurs dont il raffole : rien n'allait plus entre le président de la République et le premier ministre le " père " de la " gauche tranquille " ne supportait décidément plus Michel Rocard, son vieil adversaire, l'idole de la " nouvelle gauche " Dans les " cafés du Commerce ", les salles de rédaction, les antichambres ministérielles, chacun se livrait au délicieux jeu des pronostics. Bien vite, un tiercé fut sur toutes les lèvres : dans le désordre, M. Jean-Louis Bianco, M. Michel Delebarre, Mme Edith Cresson mais seuls les amoureux des outsiders osaient parier sur les chances du ministre de l'agriculture de l'époque de la " gauche triomphante ".
Pourtant c'est ce choix-là qui était annoncé sur le perron de l'Elysée, à la suite d'un conseil des ministres ordinaire, quelques minutes avant que les députés n'entrent dans leur hémicycle pour la traditionnelle séance de questions hebdomadaire.
La prouesse de l'artiste fut, sur le moment, saluée.
Une femme à Matignon ! C'était vraiment une bonne idée pour redonner un peu de popularité à des socialistes déjà frappés par l'usure du pouvoir. En ces temps où celles qui ont été toujours tenues à l'écart du pouvoir arrachent, les unes après les autres, les places fortes que les hommes se gardent jalousement, où elles représentent plus de la moitié du corps électoral, le pari de permettre à l'une d'elles de diriger, pour la première fois dans l'histoire de la République, les affaires de la France, paraissait à beaucoup un coup de maître.
A une époque où il est de bon ton de prétendre que les cadres du privé sont plus utiles à la collectivité que les fonctionnaires, n'était-il pas adroit de choisir comme premier ministre, pour la première fois sous la Ve République, quelqu'un qui n'était pas issu de l'administration, qui, au contraire, lors de son passage au ministère de l'industrie, avait découvert les mérites de l'entreprise, et qui, après son départ du gouvernement, le 2 octobre 1990, s'était mis au service d'un symbole du capitalisme familial : le groupe Schneider ?
A un moment où les habitudes, pour ne pas dire les manies, des " technocrates " issus des grandes écoles, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils servent le privé ou le public, semblaient déconnectées des attentes des citoyens, n'était-il pas habile de confier le pouvoir à une simple ancienne élève d'une modeste école, HEC-JF ?
Les ministres de M. Rocard
Bien vite, pourtant, il fallut déchanter.
L'incompréhension domina rapidement la surprise. M. Rocard était trop le " chouchou " des sondages, donc de l'opinion, pour que son limogeage fût facilement admis. Son départ n'aurait été compris que si son successeur avait d'emblée conquis. Ce ne fut pas le cas. Mme Cresson dut faire face à la coalition de ceux qui font l'opinion, et qui n'acceptèrent pas que le gouvernement fût confié à une femme étrangère à leur monde : les intellectuels, qu'elle ne s'est jamais vantée de fréquenter les journalistes, qu'elle n'a jamais cherché à flatter la haute fonction publique, qu'elle a toujours méprisée. Ses erreurs personnelles, son caractère, sa difficulté à assimiler les gros dossiers techniques inhérents à la direction d'un gouvernement s'ajoutèrent à ce handicap originel.
Elle eut surtout à payer le prix de ce qui devait apparaître comme une erreur politique du chef de l'Etat. Ce dernier ne lui facilita pas la tâche. Lui refusant de composer le gouvernement de ses rêves, il lui imposa de conserver l'essentiel de l'équipe ministérielle précédente.
Ce fut sa première déception : pourquoi avoir chassé M. Rocard, si c'était pour garder " ses " ministres ?
Elle-même commit une série de faux pas. Malgré son long parcours ministériel, elle n'avait pas su se constituer un groupe de conseillers fidèles. Elle a toujours usé, lassé ses conseillers avec une rapidité déconcertante, et le dernier carré de ses proches ne supportait plus l'influence envahissante prise par l' " éminence " qu'elle avait découverte lors de son passage au ministère de l'industrie, M. Abel Farnoux, et qui symbolise tout ce qu'elle aurait aimé rencontrer dans son milieu d'origine : la Résistance, la prestance, l'ouverture sur le monde, un carnet d'adresses planétaire, les capacités administratives mises au service de l'industrie.
Lorsque M. Rocard lui transmit ses pouvoirs, Mme Cresson était seule ou presque. Son cabinet, pour l'essentiel, fut constitué de militants, d'énarques qui lui furent recommandés par M. Michel Charasse, et qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec elle. Immédiatement, il fut envahi par les querelles intestines, l'équipe personnelle que se constitua M. Farnoux entrant en compétition avec l' " officielle ".Personne, surtout, ne lui expliqua qu'un chef de gouvernement ne pouvait s'exprimer comme un ministre " de base ". Son premier entretien dans la presse écrite fut pour le Journal du dimanche quatre jours après son installation à Matignon, elle y eut cette phrase : " La Bourse, je n'en ai rien à cirer. " Le style du nouveau premier ministre était imprimé elle ne devait guère en changer.
Le " trou " de la Sécurité sociale
Sa première prestation à l'Assemblée nationale, pour la traditionnelle " déclaration de politique générale ", confirma que le chef du gouvernement n'avait guère de talent oratoire. Pendant cinquante minutes, elle lut un texte touffu, confus, sans relief, sans souffle, sans sensibilité... et sans aucun hommage à l'action M. Rocard.
Là encore le ton était donné : pendant les premiers mois de son gouvernement, elle ne cessa de faire comprendre qu'elle était là - au-delà de la mission officielle que lui avait confiée le président de la République : préparer l'entrée de la France dans l'Europe unie de 1993 - pour réparer les erreurs commises par les précédentes équipes socialistes et pour faire tout ce que n'avait pas eu le courage de faire son prédécesseur, trop occupé, à ses yeux, par son avenir présidentiel.
Les premiers dossiers qu'elle trouve sur son bureau lui permettent de marteler ce message. Dès le 29 mai, le conseil des ministres doit avaliser un plan de M. Pierre Bérégovoy pour freiner la croissance du déficit budgétaire, conséquence de mauvaises rentrées fiscales, et, le 13 juin, elle doit, pour la première fois, engager la responsabilité de son gouvernement à l'Assemblée nationale pour empêcher son rejet l'opposition réplique par une motion de censure, mais les communistes ne s'y associent pas, ce qui sauve le premier ministre. Surtout, il lui faut faire face au sempiternel " trou " de la Sécurité sociale, dont elle assure avoir découvert l'importance en arrivant à Matignon.
Elle choisit, le 12 juin, de le combler par une hausse de 0,9 point de la cotisation salariale d'assurance-maladie, mais elle demande que soit mise en place une vraie politique de maîtrise des dépenses de santé. Après de longues et délicates négociations, M. Jean-Louis Bianco, le nouveau ministre des affaires sociales, parviendra à un accord en ce sens avec la Caisse nationale d'assurance-maladie et la Confédération syndicale des médecins français à la fin du mois de février.
Autre obligation : la situation des banlieues. Moins de quinze jours après sa nomination, Mme Cresson s'était rendue dans la famille d'un jeune immigré mort, faute de soins, au cours de sa garde à vue dans le commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) aussi, le 11 juin, lorsqu'elle doit retourner dans cette ville pour les obsèques d'une polcière tuée alors qu'elle tentait de s'opposer à un " rodéo " de voitures volées, doit-elle faire face à une manifestation de mauvaise humeur des forces de l'ordre.
Pour éviter que l'été ne soit " chaud " dans les quartiers déshérités, le gouvernement décide, le 12 juin, tout à la fois de renforcer les moyens des policiers et de débloquer 140 millions de francs pour une série d'animations ponctuelles destinées à leurs jeunes habitants. Pour une fois l'administration sait aller vite : tout est effectivement en place dans les semaines suivantes, et l'été se passe sans drame, en-dehors de l'agitation des enfants de Harkis.
Cette fois la " méthode Cresson " a été efficace : des mesures simples, facilement compréhensibles par l'opinion grâce à un langage direct et rapidement mises en place du pragmatique, du concret, sans théorisation. Il est loin d'en aller toujours de même. Ainsi, le premier ministre éprouve le plus grand mal à faire admettre par les dirigeants socialistes et les enseignants, donc par le ministre de l'éducation nationale, son souhait de développer en France l'apprentissage sur le modèle allemand. Elle doit arracher une à une les mesures permettant cette transformation à une administration réticente, et multiplier les occasions de symboliser son objectif, afin d'expliquer que c'est un des moyens de lutter contre ce qui est, et restera, sa préoccupation dominante : le chômage.
L'apprentissage devient le leitmotiv de toutes ses interventions médiatiques, qui sont aussi diverses que nombreuses, non sans erreur. Au cours d'un entretien préenregistré à TF 1, Mme Cresson, en réponse à une question, n'exclut pas l'utilisation de " charters " pour expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est immédiatement le tollé, une partie de la gauche lui reprochant de tenir un langage " digne " de celui de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, le 10 juillet, au surlendemain de la diffusion de cette déclaration, le gouvernement adopte un plan de lutte contre l'immigration clandestine, mais réaffirme le respect du droit d'asile.
Le premier ministre n'en a pas pour autant fini avec ce dossier, puisqu'elle laissera en janvier son ministre de l'intérieur imposer le vote au Parlement d'un dispositif de contrôle des demandeurs d'asile, que le Conseil constitutionnel jugera contraire aux grands principes de protection des libertés individuelles.
Les vacances, et surtout celles du Parlement, viennent heureusement permettre au premier ministre de ralentir une activité qui ressemblait parfois à de l'agitation. Mme Cresson en profite pour remettre de l'ordre dans son cabinet, et prendre des mesures souhaitées depuis longtemps par les écologistes : non-construction de barrages sur la Loire, modification de l'itinéraire du tunnel du Somport.
Il était grand temps, tant son image s'était vite détériorée dans l'opinion, chaque vague de sondage, ou presque, annonçant une nouvelle baisse de sa popularité.
Son passage, en septembre, à l'université d'été du PS, puis son intervention au cours des journées d'études des parlementaires socialistes confirment aussi que les animateurs de son propre parti, déjà inquiets de la manière dont a été accueillie la réaction de M. Mitterrand à la tentative de putsch à Moscou, ne lui font guère confiance pour les mener à la victoire électorale, malgré la présentation de ce qu'elle appellera le " programme Matignon ".
La première présentation de ce programme est faite à Bordeaux, le 16 septembre, lorsque, devant la confédération des PME, elle expose son plan d'aide aux petites et moyennes entreprises. Celui-ci n'est vraiment bien reçu que par ceux qui vont en bénéficier les patrons des grandes entreprises reprochent à Mme Cresson de le financer par un accroissement de la taxe sur les profits financiers les socialistes ne comprennent pas pourquoi est donnée satisfaction à des électeurs traditionnels de la droite, alors que les leurs sont toujours soumis à la rigueur budgétaire.
Le " programme Matignon "
Surtout, la gauche regrette que ce plan n'ait pas été accompagné de contreparties sociales, ni mis au point avec le soutien de l'administration, mais avec l'aide des réflexions des GEM, ces fameux groupes d'études et de mobilisation que Mme Cresson avait mis en place lorsqu'elle était aux affaires européennes et qui, sous l'impulsion de M. Farnoux, réunissent de nombreux dirigeants d'entreprise et quelques fonctionnaires.
Ce style de gouvernement ne fait rien pour améliorer les rapports du premier ministre avec les " éléphants ", qu'elle déteste autant qu'ils ne la comprennent pas. Ne se voulant que dans " l'écurie " de M. Mitterrand, Mme Cresson est en butte aux critiques des autres, de tous les autres, qu'ils soient à l'extérieur du gouvernement ou à l'intérieur. Elle a le plus grand mal à imposer son autorité aux plus importants de ses ministres, et tout particulièrement à MM. Lionel Jospin et Pierre Bérégovoy les incidents sont réguliers entre l'équipe de Matignon et celle de Bercy.
L'automne, pour une fois, respecte la tradition : il est chaud. La grogne des infirmières, dont avait tant souffert M. Rocard, renaît de cendres mal éteintes, sans retrouver l'ampleur de l'année précédente. S'y mêle cette fois la lassitude des assistantes sociales. FO tente de profiter de ce mécontentement pour lancer un ordre de grève générale. Mme Cresson parvient pourtant à le désamorcer en s'entendant avec les autres syndicats réformistes, et permet, surtout, à son ministre de la fonction publique de signer un accord contractuel avec les organisations de fonctionnaires. L'agitation paysanne, commencée par une gigantesque manifestation pacifique dans les rues de Paris, le 29 septembre, prend en province une tournure dont le chef de l'Etat juge qu'elle " met en péril la République ", et le gouvernement paraît, un temps, débordé parla violence de certains incidents.
Les faux pas ministériels ne font qu'aggraver les choses. Le gouvernement s'empêtre dans le scandale de la transfusion sanguine. Même si ce sont MM. Bianco et Bruno Durieux qui sont en première ligne, Mme Cresson est atteinte lorsque son arbitrage sur le financement de l'indemnisation est refusé par les députés socialistes. Le climat est aussi perturbé par le lancinant débat sur la réforme du mode de scrutin législatif, que le premier ministre doit assumer, alors que la solution n'est pas de son domaine. Tout cela fait oublier que ces nouveaux conseillers lui ont appris à maîtriser ses interventions, et qu'elle a, en présentant le projet sur la répression du travail clandestin, prononcé au Palais-Bourbon un discours sur l'immigration qui l'a réconciliée, au moins sur ce sujet, avec les parlementaires du PS.
Tout cela, surtout, atténue l'impact des décisions qui lui appartiennent en propre. Avec l'aide de M. Delebarre, son ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, elle réussit à imposer ce que n'avait pu faire aucun de ses prédécesseurs : l'installation en province d'administrations trop habituées aux prestiges des hôtels du coeur de Paris. Pour montrer qu'aucune bastille ne lui fait peur, elle ordonne le déplacement à Strasbourg du saint des saints de la nomenklatura française : l'ENA. La fille d'un haut fonctionnaire parisien, mais qui est plus à son aise sur les marchés de sa ville de Châtellerault que dans les dîners en ville, se moque des cris d'orfraie du " microcosme "; elle préfère satisfaire ce qu'elle croit être les récriminations de la " France profonde ".
L'amélioration de la formation et le soutien aux industries d'avenir resteront les deux axes de son action gouvernementale. Le 18 décembre, elle prévient le conseil des ministres qu'elle a décidé de fusionner les activités industrielles du Commissariat à l'énergie atomique et celles non militaires du groupe Thomson. D'être accusée de jouer au mécano industriel ne lui fait ni chaud ni froid.
Elle se flatte, au contraire, de renouer avec la grande époque du gaullo-pompidolisme, quand l'Etat mettait en place des sociétés assez fortes pour résister à la concurrence étrangère dans les secteurs d'avenir. Son credo industriel n'est pourtant pas nationaliste. Elle en donne la preuve quand, le 28 janvier, elle annonce que pour permettre le maintien d'une industrie électronique française, Bull va s'associer avec IBM : la société créée pour résister à la domination du géant américain va travailler avec lui pour contrer la puissance japonaise.
La préparation de l'avenir et le sauvetage du présent justifient, aux yeux du premier ministre, ces décisions.
Car elle sait bien qu'avant le jugement de l'histoire son parti, dont elle se veut, malgré tout, une militante de base, devra affronter celui des électeurs et que leur seul critère sera le niveau du chômage. En parfaite entente avec son ministre du travail, Mme Martine Aubry, elle multiplie les " plans " tout en refusant le " traitement social ".
Elle espère que le soutien fiscal apporté aux emplois qualifiés de proximité permettra de mettre au jour un gisement d'emplois, mais, comme elle n'en est pas tout à fait convaincue, le 8 janvier, de nouvelles mesures en faveur des jeunes et des chômeurs de longue durée sont annoncées. Les élections approchent.
Une dernière épreuve attend le chef du gouvernement avant les régionales : l'affaire Habache. Oh ! chacun comprend vite que ce n'est pas à son niveau qu'a été prise la décision de laisser entrer en France le chef palestinien, ni même que le " feu vert " aurait dû être obtenu, mais c'est l'hôtel Matignon qui doit gérer les conditions de son départ et faire face à la bronca parlementaire que suscitent les dysfonctionnements de l'Etat ainsi révélés. Elle ne le fait pas comme elle l'aurait souhaité, puisque M. François Mitterrand lui a refusé le départ du ministre de l'intérieur, qu'elle avait demandé, et a fortiori celui du ministre des affaires étrangères, qu'elle savait inutile de solliciter. Elle doit se contenter de sanctions contre leurs principaux collaborateurs.
Se montrant pour une fois bonne stratège, Mme Cresson profite de la réunion extraordinaire du Parlement pour prononcer, le 7 février, un véritable discours électoral et négocier un virage presque complet, mais tardif : pour la première fois, elle assume la totalité du bilan de la gauche, revendique l'héritage des trois précédents premiers ministres socialistes et se présente en chef de guerre de la gauche pour les combats électoraux à venir. Persuadée que les dirigeants du PS vont se contenter de batailler dans leur fief, elle est bien décidée, elle, à mener une campagne nationale. Elle en donne le ton, le 27 février à Créteil, où, au cours d'un meeting aux candidats socialistes en Ile-de-France, elle assure que " la majeure partie de la droite n'est qu'un faux nez de l'extrême droite ".
L'opération est renouvelée au cours d'un voyage de soutien à M. Delebarre, de deux jours dans le Nord-Pas-de-Calais, les 4 et 5 mars, pendant lequel elle patronne une décision arrachée de longue lutte : le transfert de la gestion du patrimoine immobilier des Houillères aux collectivités locales. Mais son nouveau discours passe mal.
L'image d'une ardente avocate des valeurs socialistes est trop en contradiction avec celle d'une protectrice de l'industrie, donc des entreprises, donc des patrons, chargée de faire avaler à une gauche déjà saturée les dernières couleuvres du réalisme.
De la déroute aux élections régionales du 22 mars, elle n'est pas seule responsable. D'en être le bouc émissaire ne la chagrinera pas, tant cela fait longtemps qu'elle a mesuré l'ingratitude du monde politique. Elle en gardera au moins la satisfaction d'avoir eu l'impression de sauver l'honneur de son camp en arrachant le départ du gouvernement de M. Soisson, après qu'il eut été soupçonné d'avoir été élu président du conseil régional de Bourgogne grâce aux voix du Front national.
Elle quittera - complètement et définitivement, dit-elle - le " microcosme " politique avec plaisir, trop heureuse de pouvoir retrouver celui des dirigeants des entreprises privées. Cela fait déjà un certain temps qu'en privé elle expliquait, en pastichant M. Robert Hersant lorsque celui-ci a vendu sa chaîne de télévision : " A Matignon, pour un premier ministre, il n'y a que deux moments heureux celui de sa nomination et celui de son départ "...
THIERRY BREHIER
Le Monde du 3 avril 1992