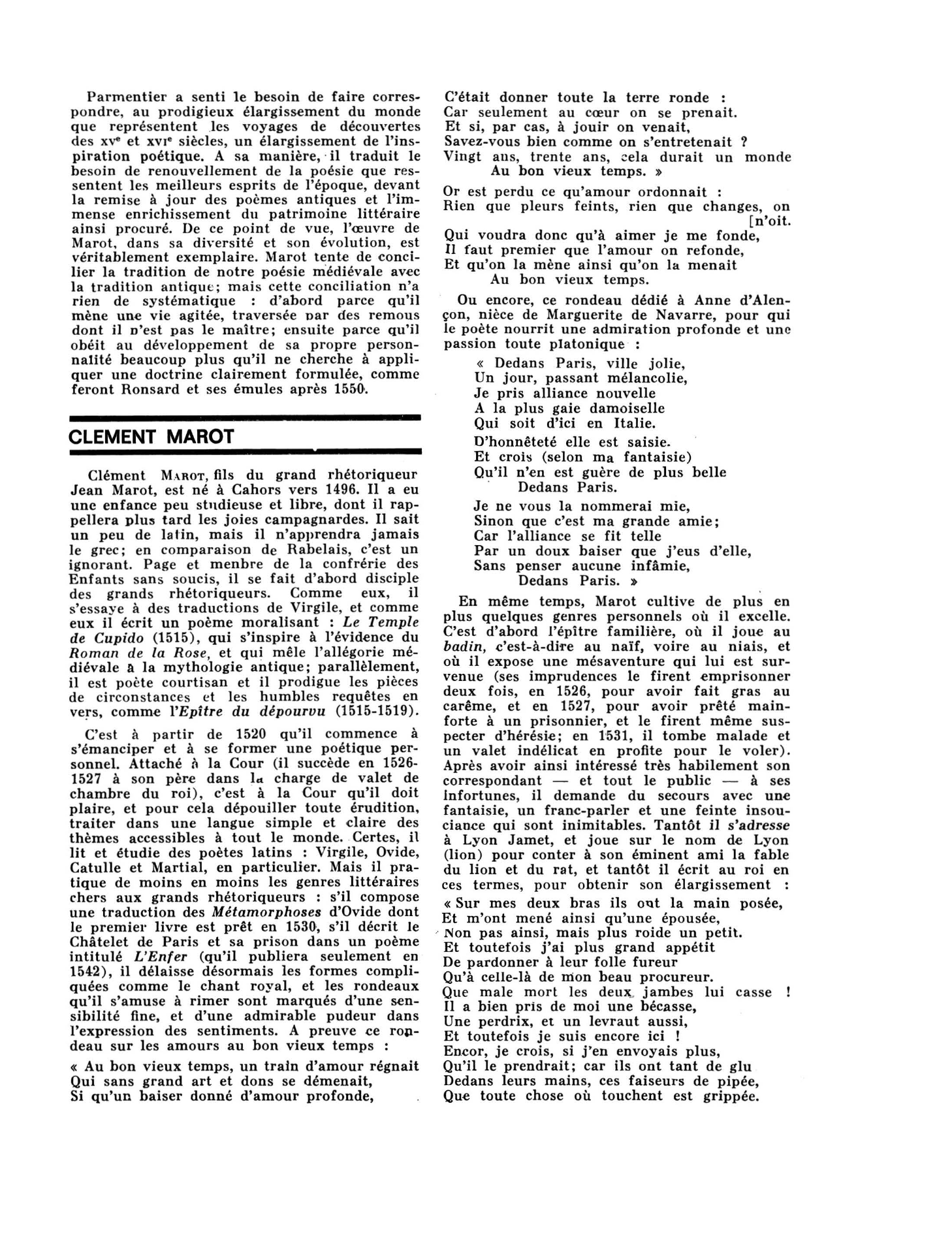LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DE LA RENAISSANCE - Le renouvellement de la poésie : Marot, du Bellay, Ronsard, Agrippa d'Aubigné
Publié le 18/10/2011
Extrait du document

Clément MAROT, fils du grand rhétoriqueur Jean Marot, est né à Cahors vers 1496. Il a eu une enfance peu studieuse et libre, dont il rappellera plus tard les joies campagnardes. Il sait un peu de latin, mais il n'apprendra jamais le grec; en comparaison de Rabelais, c'est un ignorant. Page et menbre de la confrérie des Enfants sans soucis, il se fait d'abord disciple des grands rhétoriqueurs. Comme eux, il s'essaye à des traductions de Virgile, et comme eux il écrit un poème moralisant : Le Temple de Cupido (1515), qui s'inspire à l'évidence du Roman de la Rose, et qui mêle l'allégorie médiévale a la mythologie antique; parallèlement, il est poète courtisan et il prodigue les pièces de circonstances et les humbles requêtes en vers, comme l'Epître du dépourvu (1515-1519).

«
Parmentier a senti le besoin de faire corres pondre, au prodigieux élargissement du monde que représentent .les voyages de découvertes des xv" et xv1• siècles, un élargissement de l'ins piration poétique.
A sa manière, · il traduit le besoin de renouvellement de la poésie que res sentent les meilleurs esprits de l'époque, devant la remise à jour des poèmes antiques et l'im mense enrichissement du patrimoine littéraire ainsi procuré.
De ce point de vue, l'œuvre de Marot, dans sa diversité et son évolution, est véritablement exemplaire.
Marot tente de conci lier la tradition de notre poésie m·édiévale avec la tradition antique; mais cette conciliation n'a rien de systématique : d ' abord parce qu'il mène une vie agitée, traversée nar des remous dont il n'est pas le maître; ensuite parce qu'il obéit au développement de sa propre person nalité beaucoup plus qu'il ne cherche à appli quer une doctrine clairement formulée, comme feront Ronsard et ses émules après 155(}.
CLEMENT MAROT
Clément MAROT, fils du grand rhétoriqueur Jean Marot, est né à Cahors vers 1496.
Il a eu une enfance peu st•tdieuse et libre, dont il rap pellera plu3 tard les joies campagnardes.
Il sait un peu de lat-in, mais il n'apprendra jamais le grec; en comparaison de Rabelais, c'est un ignorant.
Page et menbre de la confrérie des Enfants sans soucis, il se fait d'abord disciple des grands rhétoriqueurs.
Comme eux, il s'essaye à des traductions de Virgile, et comme eux il écrit un poème moralisant : Le Temple de Cupido (1515), qui s'inspire à l'évidence du Roman de la Rose, et qui mêle l'allégorie mé diévale a la mythologie antique; parallèlement, il est poète courtisan et il prodigue les pièces de circonstances et les humbles requêtes en vers, comme l'Epître du dépourvu (1515-1519).
C'est à partir de 1520 qu'il commence à s'émanciper et à se former une poétique per sonnel.
Attaché il la Cour (il succède en 1526-
1527 à son père dans la charge de valet de chambre du roi) , c'est à la Cour qu'il doit plaire, et pour cela dépouiller toute érudition, traiter dans une langue simple et claire des thèmes accessibles à tout le monde.
Certes, il lit et étudie des poètes latins : Virgile, Ovide, Catulle et Martial, en particulier.
Mais il pra tique de moins en moins les genres littéraires chers aux grands rhétoriqueurs : s'il compose une traduction des Métamorphoses d'Ovide dont le premier livre est prêt en 153(}, s'il décrit le Châtelet de Paris et sa prison dans un poème intitulé L'Enfer (qu'il publiera seulement en 1542), il délaisse désormais les formes compli quées comme le chant royal, et les rondeaux qu'il s'amuse à rimer sont marqués d'une sen sibilité fine, et d'une admirable pudeur dans l'expression des sentiments.
A preuve ce rop deau sur les amours au bon vieux temps :
« Au bon vieux temps, un train d'amour régnait Qui sans grand art et dons se démenait, Si qu'un baiser donné d'amour profonde,
C'était donner toute la terre ronde : Car seulement au cœur on se prenait.
Et si, par cas, à jouir on venait, Savez-vous bien comme on s'entretenait ? Vingt ans, trente ans, cela durait un monrle Au bon vieux temps.
»
Or
est perdu ce qu'amour ordonnait Rien que pleurs feints, rien que changes, on [n'oit.
Qui voudra donc qu'à aimer je me fonde, II faut premier que l'amour on refonde, Et qu'on la mène ainsi qu'on la menait Au bon vieux temps.
Ou encore, ce rondeau dédié à Anne d' Alen çon, nièce de Marguerite de Navarre, pour qui le poète nourrit une admiration profonde et une passion toute platonique :
« Dedans Paris, ville jolie, Un jour, passant mélancolie, Je pris alliance nouvelle A la plus gaie damoiselle Qui soit d'ici en Italie.
D'honnêteté elle est saisie.
Et crois (selon ma fantaisie) Qu'il n'en est guère de plus belle · Dedans Paris.
Je ne vous la nommerai mie, Sinon que c'est ma grande amie; Car l'alli ance se fit telle Par un doux baiser que j'eus d'elle, Sans penser aucune infâmie, Dedans Paris.
»
En même temps, Marot cultive de plus en plus quelques genres personnels où il excelle.
C'est d'abord l'épître familière, où il joue au badin, c'est-à-dire au naïf, voire au niais, et où il expose une mésaventure qui lui est sur venue (ses imprudences le firent emprisonner deux fois, en 1526, pour avoir fait gras au carême, et en 1527, pour avoir prêté main forte à un prisonnier, et le firent même sus pecter d'hérésie; en 1'531, il tombe malade et un valet indélicat en profite pour le voler).
Après avoir ainsi intéressé très habilement son correspondant - et tout le public - à ses Infortunes, il demande du secours avec une fantaisie, un franc-parler et une feinte insou ciance qui sont inimitables.
Tantôt il s'adresse à Lyon Jamet, et joue sur le nom de Lyon (lion) pour conter à son éminent ami la fable du lion et du rat, et tantôt il écrit au roi en ces termes, pour obtenir son élargissement :
« Sur mes deux bras ils oqt la main posée, Et m'ont mené ainsi qu'une épousée, · Non pas ainsi, mais plus roide un petit.
Et toutefois j'ai plus grand appétit De pardonner à leur folle fureur Qu'à celle-là de Ilion beau procureur.
Que male mort les den~ jambes lui casse Il a bien pris de moi une bécasse, Une perdrix, et un levraut aussi, Et toutefois je suis encore ici ! Encor, je crois, si j'en envoyais plus, Qu'il le prendrait; car ils ont tant de glu Dedans leurs mains, ces faiseurs de pipée, Que toute chose où touchent est grippée..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de la Fayette nous dépeint dans « La Princesse de Clèves » une fresque de la cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vo
- Giotto di Bondone par Pietro Toesca Professeur d'histoire de l'art à l'Université, Rome Le renouvellement de la peinture en Italie, que Vasari, en historien clairvoyant, a appelé " renaissance " s'est affirmé avec Giotto comme en poésie avec Dante.
- Aubigné, Agrippa d' - littérature.
- BELLAY, Joachim du (1522-1560) Poète, ami et collaborateur de Ronsard, il rédige le manifeste de la Pléiade, Défense et illustration de la langue française.