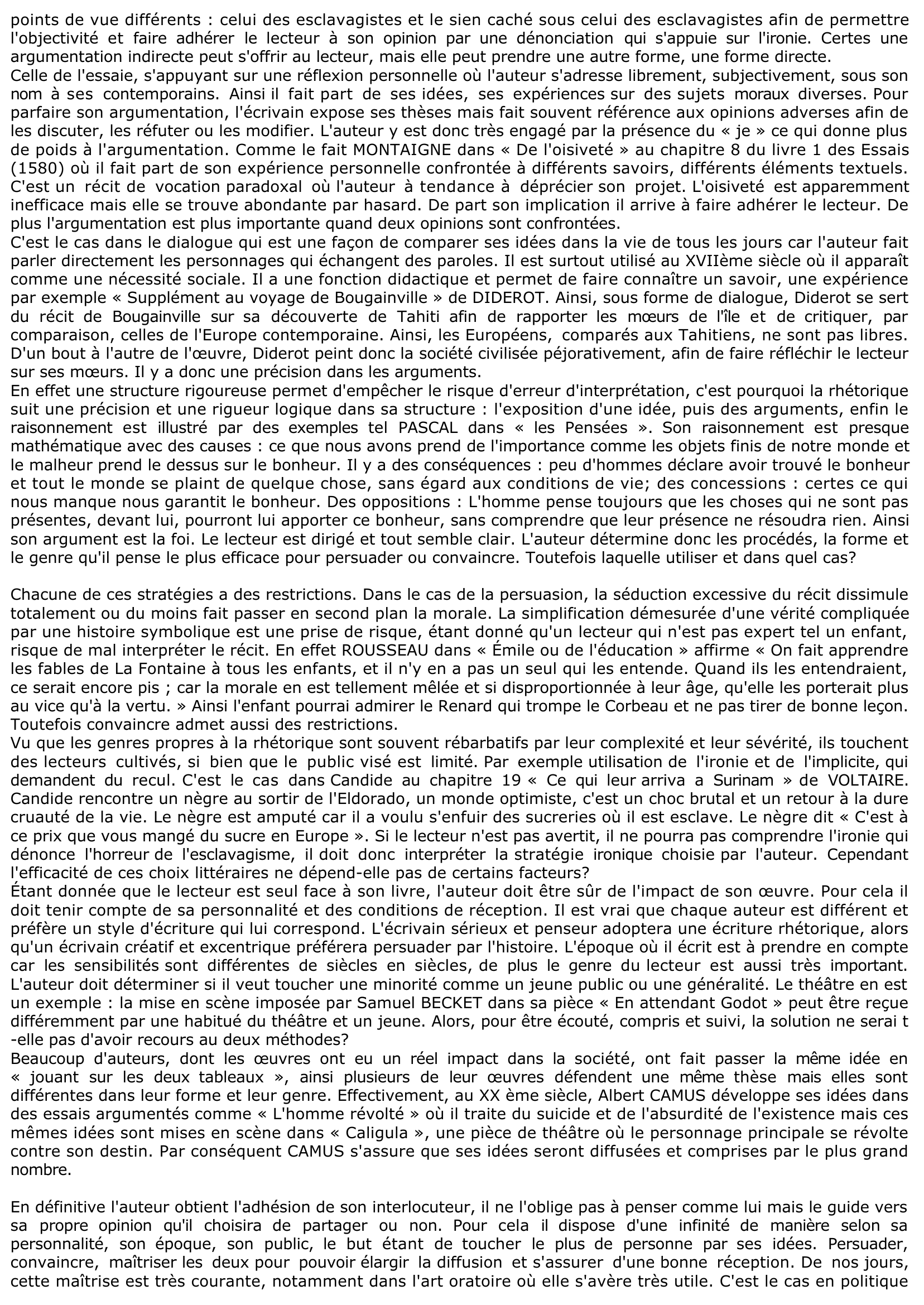Irigoyen, Hipólito
Publié le 23/02/2013
Extrait du document
Irigoyen, Hipólito (1852-1933), avocat, enseignant et homme d'État, puis deux fois président de la République argentine (1916-1922 et 1928-1930).
Né à Buenos Aires, dans une famille proche de cercles politiques radicaux, Hipólito Irigoyen est d'abord instituteur, avant de se tourner résolument vers la politique. Après avoir participé à la fondation du Parti radical, en 1891, Irigoyen en devient le chef en 1896, le marquant de son empreinte pendant les quarante années qui suivent. Il combat les fraudes électorales, la rigidité et l’anachronisme du système politique, parfois par les armes, souvent en boycottant les élections, ce jusqu'à la mise en place de réformes, en 1912. Il est élu président quatre ans plus tard. C’est la première fois que la loi électorale dite de Sáenz Peña, qui instaure le suffrage universel, secret et obligatoire, est mise en application. L’élection d’Irigoyen représente ainsi l’ouverture démocratique de l’État argentin vers les classes moyennes et les immigrés récents, autrement dit vers les couches sociales que le radicalisme maintient depuis plus de vingt ans.
Le premier mandat d’Irigoyen est marqué par la réussite et par la libération du climat socio-politique. Sur le plan diplomatique et économique, il fait en sorte que l'Argentine ne prenne pas part à la Première Guerre mondiale, ce qui permet au pays, gros producteur de viande, de tirer parti du cours élevé du bœuf sur le marché mondial. Sur le plan social et politique, l’Argentine connaît, en 1918, le mouvement étudiant dit de la « Réforme universitaire «, mouvement qui s’étend au reste du continent et exprime une nouvelle sensibilité de la jeunesse face aux problèmes contemporains. Née à Córdoba, cette vague contestataire se radicalise rapidement, prêche la liberté de conscience, la participation étudiante, l’ouverture des universités à la société et la modernisation des méthodes d’enseignement.
En 1928, Irigoyen est réélu président avec une avance confortable. Il a déjà soixante-seize ans, mais n’a rien perdu de sa fougue réformiste. Les conservateurs et les gardiens des intérêts nord-américains (en particulier ceux de la puissante Standard Oil Company) se méfient de ce président qu’ils accusent bientôt de sénilité. La dépression consécutive à la crise économique de 1929 entraîne sa destitution, à la suite d'un coup d'État militaire en 1930.
«
points de vue différents : celui des esclavagistes et le sien caché sous celui des esclavagistes afin de permettrel'objectivité et faire adhérer le lecteur à son opinion par une dénonciation qui s'appuie sur l'ironie.
Certes uneargumentation indirecte peut s'offrir au lecteur, mais elle peut prendre une autre forme, une forme directe.Celle de l'essaie, s'appuyant sur une réflexion personnelle où l'auteur s'adresse librement, subjectivement, sous sonnom à ses contemporains.
Ainsi il fait part de ses idées, ses expériences sur des sujets moraux diverses.
Pourparfaire son argumentation, l'écrivain expose ses thèses mais fait souvent référence aux opinions adverses afin deles discuter, les réfuter ou les modifier.
L'auteur y est donc très engagé par la présence du « je » ce qui donne plusde poids à l'argumentation.
Comme le fait MONTAIGNE dans « De l'oisiveté » au chapitre 8 du livre 1 des Essais(1580) où il fait part de son expérience personnelle confrontée à différents savoirs, différents éléments textuels.C'est un récit de vocation paradoxal où l'auteur à tendance à déprécier son projet.
L'oisiveté est apparemmentinefficace mais elle se trouve abondante par hasard.
De part son implication il arrive à faire adhérer le lecteur.
Deplus l'argumentation est plus importante quand deux opinions sont confrontées.C'est le cas dans le dialogue qui est une façon de comparer ses idées dans la vie de tous les jours car l'auteur faitparler directement les personnages qui échangent des paroles.
Il est surtout utilisé au XVIIème siècle où il apparaîtcomme une nécessité sociale.
Il a une fonction didactique et permet de faire connaître un savoir, une expériencepar exemple « Supplément au voyage de Bougainville » de DIDEROT.
Ainsi, sous forme de dialogue, Diderot se sertdu récit de Bougainville sur sa découverte de Tahiti afin de rapporter les mœurs de l'île et de critiquer, parcomparaison, celles de l'Europe contemporaine.
Ainsi, les Européens, comparés aux Tahitiens, ne sont pas libres.D'un bout à l'autre de l'œuvre, Diderot peint donc la société civilisée péjorativement, afin de faire réfléchir le lecteursur ses mœurs.
Il y a donc une précision dans les arguments.En effet une structure rigoureuse permet d'empêcher le risque d'erreur d'interprétation, c'est pourquoi la rhétoriquesuit une précision et une rigueur logique dans sa structure : l'exposition d'une idée, puis des arguments, enfin leraisonnement est illustré par des exemples tel PASCAL dans « les Pensées ».
Son raisonnement est presquemathématique avec des causes : ce que nous avons prend de l'importance comme les objets finis de notre monde etle malheur prend le dessus sur le bonheur.
Il y a des conséquences : peu d'hommes déclare avoir trouvé le bonheuret tout le monde se plaint de quelque chose, sans égard aux conditions de vie; des concessions : certes ce quinous manque nous garantit le bonheur.
Des oppositions : L'homme pense toujours que les choses qui ne sont pasprésentes, devant lui, pourront lui apporter ce bonheur, sans comprendre que leur présence ne résoudra rien.
Ainsison argument est la foi.
Le lecteur est dirigé et tout semble clair.
L'auteur détermine donc les procédés, la forme etle genre qu'il pense le plus efficace pour persuader ou convaincre.
Toutefois laquelle utiliser et dans quel cas?
Chacune de ces stratégies a des restrictions.
Dans le cas de la persuasion, la séduction excessive du récit dissimuletotalement ou du moins fait passer en second plan la morale.
La simplification démesurée d'une vérité compliquéepar une histoire symbolique est une prise de risque, étant donné qu'un lecteur qui n'est pas expert tel un enfant,risque de mal interpréter le récit.
En effet ROUSSEAU dans « Émile ou de l'éducation » affirme « On fait apprendreles fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende.
Quand ils les entendraient,ce serait encore pis ; car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge, qu'elle les porterait plusau vice qu'à la vertu.
» Ainsi l'enfant pourrai admirer le Renard qui trompe le Corbeau et ne pas tirer de bonne leçon.Toutefois convaincre admet aussi des restrictions.Vu que les genres propres à la rhétorique sont souvent rébarbatifs par leur complexité et leur sévérité, ils touchentdes lecteurs cultivés, si bien que le public visé est limité.
Par exemple utilisation de l'ironie et de l'implicite, quidemandent du recul.
C'est le cas dans Candide au chapitre 19 « Ce qui leur arriva a Surinam » de VOLTAIRE.Candide rencontre un nègre au sortir de l'Eldorado, un monde optimiste, c'est un choc brutal et un retour à la durecruauté de la vie.
Le nègre est amputé car il a voulu s'enfuir des sucreries où il est esclave.
Le nègre dit « C'est àce prix que vous mangé du sucre en Europe ».
Si le lecteur n'est pas avertit, il ne pourra pas comprendre l'ironie quidénonce l'horreur de l'esclavagisme, il doit donc interpréter la stratégie ironique choisie par l'auteur.
Cependantl'efficacité de ces choix littéraires ne dépend-elle pas de certains facteurs?Étant donnée que le lecteur est seul face à son livre, l'auteur doit être sûr de l'impact de son œuvre.
Pour cela ildoit tenir compte de sa personnalité et des conditions de réception.
Il est vrai que chaque auteur est différent etpréfère un style d'écriture qui lui correspond.
L'écrivain sérieux et penseur adoptera une écriture rhétorique, alorsqu'un écrivain créatif et excentrique préférera persuader par l'histoire.
L'époque où il écrit est à prendre en comptecar les sensibilités sont différentes de siècles en siècles, de plus le genre du lecteur est aussi très important.L'auteur doit déterminer si il veut toucher une minorité comme un jeune public ou une généralité.
Le théâtre en estun exemple : la mise en scène imposée par Samuel BECKET dans sa pièce « En attendant Godot » peut être reçuedifféremment par une habitué du théâtre et un jeune.
Alors, pour être écouté, compris et suivi, la solution ne serai t-elle pas d'avoir recours au deux méthodes?Beaucoup d'auteurs, dont les œuvres ont eu un réel impact dans la société, ont fait passer la même idée en« jouant sur les deux tableaux », ainsi plusieurs de leur œuvres défendent une même thèse mais elles sontdifférentes dans leur forme et leur genre.
Effectivement, au XX ème siècle, Albert CAMUS développe ses idées dansdes essais argumentés comme « L'homme révolté » où il traite du suicide et de l'absurdité de l'existence mais cesmêmes idées sont mises en scène dans « Caligula », une pièce de théâtre où le personnage principale se révoltecontre son destin.
Par conséquent CAMUS s'assure que ses idées seront diffusées et comprises par le plus grandnombre.
En définitive l'auteur obtient l'adhésion de son interlocuteur, il ne l'oblige pas à penser comme lui mais le guide verssa propre opinion qu'il choisira de partager ou non.
Pour cela il dispose d'une infinité de manière selon sapersonnalité, son époque, son public, le but étant de toucher le plus de personne par ses idées.
Persuader,convaincre, maîtriser les deux pour pouvoir élargir la diffusion et s'assurer d'une bonne réception.
De nos jours,cette maîtrise est très courante, notamment dans l'art oratoire où elle s'avère très utile.
C'est le cas en politique.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓