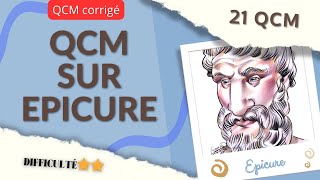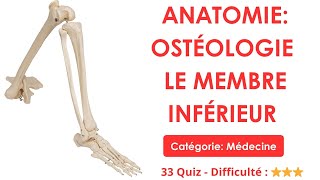Simone Veil : j'ai peur des procès quarante ans après
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Mémoire 1983 - Les dossiers d'anciens collaborateurs comme René Bousquet, Jean Leguay et Maurice Papon sont instruits par la justice.
-Quelle est votre réaction devant ces poursuites pour crimes contre l'humanité ?
-J'ai une position très personnelle sur ce problème et je comprends très bien qu'elle puisse choquer, qu'elle ne soit pas comprise. En dehors des problèmes français que vous venez de citer, je me suis toujours posé la question de l'opportunité, au plan même des principes, de rechercher-sauf cas tout à fait exceptionnels-pour crimes contre l'humanité, des hommes en revenant sur le principe de la prescription et donc de faire jouer une loi rétroactivement.
J'ai toujours été étonnée que certains, qui ont des principes très rigoureux quant au droit, aient, dans ce cas, admis le principe de la rétroactivité. Il y a là pour moi un point d'interrogation. Cela dit, je mets à part le cas d'Eichmann-c'était un symbole. Je pense aussi que le cas de Mengele, le médecin-chef du camp d'Auschwitz, si on le retrouvait, justifierait des dispositions exceptionnelles.
Pour le reste, j'ai assez peur des procès quarante ans après. Même en dehors des principes, sur le plan des faits, il est très difficile de conduire ces procès en raison de difficultés matérielles, concrètes. Les témoignages sont délicats. Je ne pourrais pas témoigner de façon précise en disant : " C'est bien lui ", " Je le reconnais ". Ce n'est pas possible. Et puis, je crains que toute peine prononcée ne soit dérisoire par rapport aux faits incriminés. Et donc que cela nuise à l'objectif poursuivi et à la justice. C'est un problème.
-Est-ce l'ancien magistrat qui parle ?
-Oui. Et puis ce sont les principes. On peut craindre une disparité entre les peines prononcées. On voit mal une cour condamner, après quarante ans, à la réclusion perpétuelle.
Non. Il me semble normal de les rechercher, de faire en sorte que les responsables soient connus, qu'ils ne mènent pas une petite vie tranquille comme si rien ne s'était passé. Mais cette dénonciation de leurs actes me paraîtrait suffisante, la société, plutôt que la justice, ayant à en tirer les conséquences.
Ce qu'on peut aussi déplorer, c'est que, dans certains cas, cela ait mis si longtemps à se savoir : en raison de la loi du silence, de complaisances. J'ai une approche personnelle parce qu'autant je pense qu'il est indispensable que, collectivement, on dénonce les faits et que l'on empêche que ces faits ne soient oubliés, et même minimisés (toute banalisation des faits me paraît très grave), autant une responsabilité individuelle, maintenant, ne m'intéresse plus tellement. C'est le phénomène collectif qui me paraît important, et c'est la raison pour laquelle, sur le plan historique, il me paraît nécessaire de l'étudier, de voir comment il s'est produit, en montrant comment quelqu'un peut être responsable-même sans avoir pris directement de décisions-par les idées ou les idéologies qu'il a répandues, ou encore par les lâchetés successives qu'il a admises. C'est l'histoire qui m'intéresse. Le processus historique.
-Il ne s'agit pas d'oubli ou de pardon ?
-Pas du tout. Il serait très grave d'oublier. Mais pour vous expliquer : quand je suis rentrée de déportation, on m'a dit que j'avais été dénoncée. Je n'ai même pas cherché à savoir. Au fond, cela ne m'intéressait pas. Ce qui n'aurait intéressée, c'est de savoir pourquoi et comment on avait été entraîné dans ce climat de dénonciation. Ou pourquoi des responsables politiques ou administratifs, aussi bien que des intellectuels, peuvent être amenés, dans certaines circonstances, à accepter certaines choses. Ce qui est important, c'est de savoir jusqu'où on peut penser qu'on est utile, dans certaines circonstances, parce qu'on " limite la casse " et à quel moment il faut se démettre sous peine d'être complice. Parce que la question peut toujours se poser. Même quarante ans après.
Liens utiles
- EMC: Simone Veil
- Veil Simone, née en 1927 à Nice (Alpes-Maritimes), personnalité politique française.
- Anne de Bretagne par Simone Martin-Chauffier Anne n'avait pas douze ans lorsque la mort de François II, son père, la fit duchesse de Bretagne, mais elle avait déjà le goût et le sens de l'autorité.
- Discours de Simone Veil sur l'avortement (anthologie de textes juridiques).
- Veil, Simone - biographie.