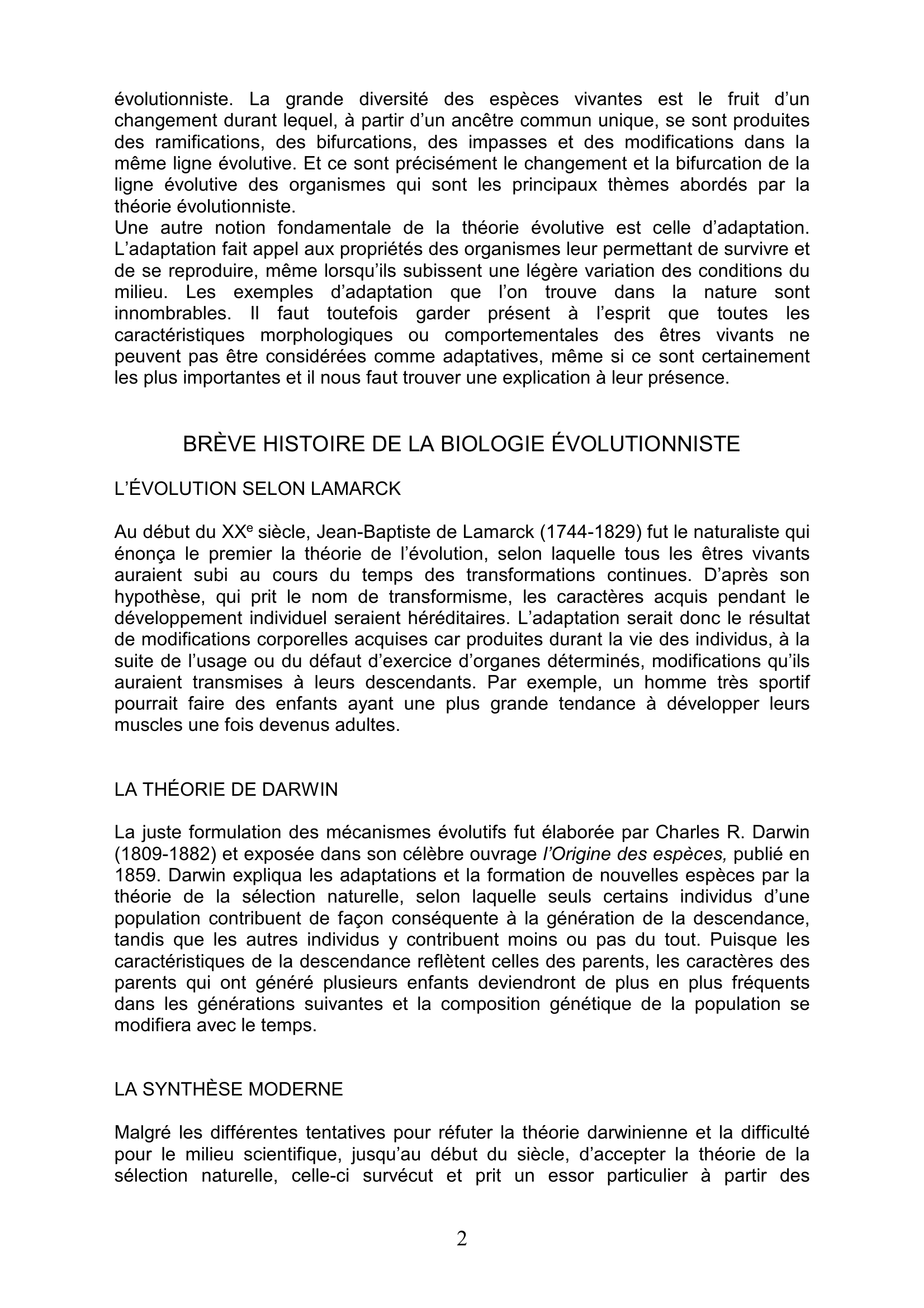L'ÉVOLUTION BIOLOGIQUE
Publié le 02/05/2019

Extrait du document
CLADISME ET PHÉNÉTIQUE
Il existe différentes écoles de taxinomie qui usent de méthodes et des philosophies différentes pour classer les organismes. L’école cladistique, ou phylogénétique, vise à construire un système au sein duquel les organismes sont regroupés en catégories qui rendent compte de leurs rapports de parenté. Selon son fondateur, Willi Hennig, il s’agit de transformer un arbre généalogique en classification, sur la base de critères déterminés. Les caractères sont analysés et reconnus comme caractères ancestraux ou bien comme caractères dérivés (c'est-à-dire comme caractères plus avancés et plus modernes du point de vue évolutif), et ce critère sert de guide pour la reconstruction phylogénétique et la définition systématique des animaux et des plantes. L’école phénétique considère en revanche le plus grand nombre possible de caractères, indépendamment de leur signification évolutive, et les utilise comme méthodes d’élaboration mathématique (taxinomie numérique). Elle renonce a priori à opérer une reconstruction évolutive des organismes et vise à une classification d’ordre pratique. Les résultats des deux types de méthodologie peuvent être complètement différents. Par exemple, les Oiseaux et les crocodiles ont un ancêtre commun moins lointain que l’ancêtre commun des crocodiles et des lézards. L’école phénétique mettrait les crocodiles l’un à côté de l’autre dans une classification, tandis que l’école phylogénétique unirait dans un même groupe les Oiseaux et les crocodiles. Ces deux systèmes de classification présentent des limites. La méthode phénétique ne fournit pas d’informations sur les relations de parenté qui existent entre les organismes. Cette classification peut laisser de côté des caractères importants parce qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une détermination numérique. L’école phylogénétique, de son côté, tout en étant nettement plus objective, peut parfois être incertaine et présenter des lacunes, précisément parce que l’histoire évolutive d’une espèce donnée et ses rapports phylogénétiques avec d’autres espèces ne sont pas toujours clairs ou bien connus. Depuis peu, une nouvelle école de classification, la taxinomie évolutive, admet l’usage des deux approches méthodologiques (l’analyse phylogénétique des caractères et l’élaboration numérique), unifiant en une seule méthode les avantages des deux écoles précédentes.
LE CONCEPT D’ESPÈCE
DU CRITÈRE MORPHOLOGIQUE AU CONCEPT BIOLOGIQUE
Les biologistes s’accordent presque tous sur le fait que l’espèce est l’unité fondamentale de la classification biologique, mais pas sur sa définition. Cette controverse est de nature théorique. Pour des problèmes pratiques, comme la distinction de deux espèces de mouettes dans une baie, on a recours en général à une approche de type morphologique. Un guide de reconnaissance des Oiseaux donnera une série d’indications généralement simples pour distinguer un moineau d’un chardonneret. Le problème se pose cependant quand deux populations d’une même espèce qui vivent dans des localités géographiques différentes présentent des caractères différents. En effet, ce type de variation, dite variation géographique, est plutôt fréquente dans la nature, et elle est présente aussi chez l’homme (variabilité de l’homme). D’autres fois, la définition pratique d’une espèce est beaucoup plus complexe, comme dans le cas d’espèces pour lesquelles on a un passage graduel de l’une à l’autre correspondant à leur distribution géographique. Dans ce cas, l’approche simplement morphologique n’est pas appropriée car, s’agissant d’espèces descendant d’un ancêtre commun, il est probable qu’il existe des populations intermédiaires difficiles à distinguer comme espèces séparées. C’est ainsi que les biologistes évolutionnistes ont commencé à proposer différentes définitions du concept d’espèce. La plus ancienne est sans aucun doute la définition morphologique, selon laquelle l’espèce est définie comme un groupe comprenant une série d’organismes se ressemblant et pouvant être distingués d’un autre groupe. En 1969, le biologiste évolutionniste Ernst Mayr (1904) définit l’espèce comme un ensemble de populations naturelles en mesure de se croiser (interfécondes) et isolées du point de vue reproductif d’autres populations semblables. C’est là le concept biologique d’espèce le plus répandu, même s’il n’est pas universellement accepté. Si l’on met l’accent sur la reproduction, l’espèce peut être identifiée par son patrimoine génétique. Deux individus qui ne peuvent pas s’accoupler entre eux et ne peuvent donc pas non plus s’échanger de gènes, sont isolés du point de vue reproductif et appartiennent à deux espèces différentes. Du point de vue pratique, il est plutôt difficile de définir une espèce selon cette conception. Nous devrions suivre le moineau ou le chardonneret durant toute la saison de reproduction et vérifier qu’il n’existe pas d’hybrides. Il va de soi que le critère morphologique est beaucoup plus direct dans ce cas, et qu’il est pleinement justifié par le concept biologique d’espèce, du simple fait que les caractères morphologiques communs à deux individus de la même espèce indiquent leur interfécondité. Très souvent, toutefois, les membres d’une même espèce n’ont pas de caractères uniformes, c'est-à-dire qu’on distingue en leur sein de nombreux types morphologiques. C’est le cas des espèces dites polytypiques (formées de nombreuses races géographiques distinctes). Les populations qui composent chaque race peuvent cependant se croiser entre elles et appartiennent donc à la même espèce. Le morphologiste classique ne résisterait pas à la tentation de distinguer les populations en différentes espèces. Au contraire, il peut arriver que deux populations morphologiquement identiques soient en revanche isolées du point de vue reproductif, raison pour laquelle elles doivent être considérées comme des espèces distinctes (on parle dans ce cas d’espèces sœurs), même si pour le morphologiste elles constitueraient une seule espèce. La discussion sur le concept biologique d’espèce peut être encore approfondie. On peut se demander quels sont les mécanismes qui empêchent le croisement entre différentes espèces. Une jument est plutôt rétive à s’accoupler avec un âne, parce qu’elle générerait une descendance stérile (le mulet), et tous les efforts qu’elle déploierait pour transmettre ses gènes seraient vains à la génération suivante. Il est donc clair que la sélection naturelle doit avoir agi et agit encore puissamment dans le maintien des mécanismes d’isolement reproductif. Les espèces ne se croisent pas pour une foule de raisons : parce qu’elles ont des habitats différents, parce qu’elles ont des périodes de reproduction différentes, des comportements nuptiaux et des langages différents. Il en découle que les espèces ont une identité génétique bien définie, et que sont produits des hybrides stériles.
LE CONCEPT ÉCOLOGIQUE
Outre les concepts déjà examinés, il existe un autre concept d’espèce, fondé sur les caractéristiques écologiques des populations naturelles. Ce concept définit une espèce comme l’ensemble des organismes occupant la même niche écologique. Le concept écologique d’espèce souligne les raisons plus générales en vertu desquelles la sélection limite dans la pratique le croisement entre différentes espèces. Du point de vue écologique, la sélection limiterait la formation d’hybrides parce que ces derniers ne sont pas bien adaptés. Les hybrides reçoivent des gènes de deux espèces différentes, et ces gènes, étant donné la différence de passé évolutif des deux espèces, ne peuvent pas interagir de façon appropriée. Bref, les hybrides sont, pour ainsi dire, totalement neutre. Dans la nature, selon les tenants de cette approche, il n’y aurait pas de place pour de tels organismes, car la nature est divisée en zones adaptatives, avec des sauts entre l’une et l’autre. Chaque zone adaptative est définie de façon plutôt précise et chaque espèce s’y est adaptée au cours de son histoire évolutive. L’hybride ne serait jamais en mesure d’exploiter une zone adaptative, et il ne pourrait donc pas survivre. Ce concept explique pourquoi les hybrides sont si rares, et met l’accent sur la sélection naturelle comme facteur déterminant de l’identité d’une espèce. En réalité, le concept biologique et le concept écologique d’espèce sont étroitement liés. Si les membres d’une espèce se croisaient avec une gamme trop large de partenaires, donnant vie à une descendance inadaptée, la sélection agirait, essayant de rectifier le tir, pour les rendre un peu plus sélectifs dans leurs choix... Dans ce sens, l’approche écologique et l’approche biologique peuvent s’intégrer.
L’ESPÈCE CLADISTIQUE
Les arguments théoriques concernant la définition du concept d’espèce peuvent être portés sur un terrain différent, le terrain historique. L’espèce est visible aujourd’hui, mais son histoire évolutive dure peut-être depuis des millions d’années. Dans cette vue perspective, comment pouvons-nous distinguer une espèce de celle qui l’a précédée ? À quel point de la ligne évolutive pouvons-nous insérer une ramification ou une divergence ? Ni le concept morphologique (en raison de son caractère arbitraire), ni le concept biologique (comment connaître les habitudes reproductives d’une espèce éteinte ?), ni le concept écologique (il n’est pas toujours possible de reconstruire les caractéristiques écologiques de formes fossiles) ne peuvent nous aider à ce sujet. Une solution objective pourrait venir de l’école cladistique (ou phylogénétique) de classification (cladisme). L’espèce cladistique peut être définie comme un ensemble d’organismes qui occupent une ligne évolutive comprise entre deux points de bifurcation. Cela enlève tout caractère arbitraire à la subdivision de la ligne évolutive. Un autre concept faisant entrer en ligne de compte le passé évolutif de l’espèce est le concept évolutif, qui définit l’espèce comme une séquence de populations entre les ancêtres et les descendants évoluant séparément d’autres lignes évolutives.
CONSIDÉRATIONS FINALES
Comme on le voit, les définitions sont multiples et englobent différents aspects de la réalité complexe de l’espèce. Dans la nature, la variabilité est la norme. Séparer, rendre discret quelque chose qui se présente comme un continuum tant du point de vue spatial que du point de vue temporel, cela suppose un processus articulé. Le problème est d’ordre philosophique. Les espèces, mais aussi les genres, les familles, les classes, existent-ils vraiment dans la nature, ou bien s’agit-il de catégories imposées artificiellement par l’homme ? En ce qui concerne l’espèce, le concept biologique et peut-être aussi le concept écologique définissent quelque chose qui existe réellement. On ne peut pas dire la même chose du concept cladistique ou évolutif. C’est déjà quelque chose. Mais que dire des regroupements supérieurs ? Pendant longtemps, ils ont été définis à travers des attributs surtout morphologiques. On a vu précédemment que le choix de ces attributs est plutôt subjectif. À cette considération, il convient d’ajouter une autre observation : face à un groupe de Japonais, un Européen n’est pas toujours en mesure de leur trouver des différences (mais la même chose vaut quand ce sont les Européens qui se rendent au Japon). Toutefois, si un Européen vivait au Japon pendant quelque temps, il serait probablement en mesure de distinguer des jumeaux. Le critère morphologique a un niveau de subjectivité très élevé, et si les regroupements supérieurs étaient fondés sur ce critère, nous devrions conclure qu’ils n’existent pas dans la nature, et qu’ils ne sont que des simplifications utiles et nécessaires quand on aborde l’étude de la nature.
MACROÉVOLUTION
Quand on aborde des problèmes relatifs à des phénomènes qui ont lieu à un niveau situé au-dessous de l’espèce, on parle de microévolution. La spéciation est un mécanisme qui est étudié au-dessous du niveau de l’espèce, et par conséquent c’est un mécanisme microévolutif. Quand on abandonne ce niveau d’observation, et que l’on commence à observer les changements évolutifs à une grande échelle, on aborde des problèmes de macroévolution. La question principale qui se pose quand on passe à cette échelle d’observation est la suivante : la macroévolution est-elle une microévolution extrapolée sur une échelle temporelle beaucoup plus grande, ou bien est-elle un phénomène à part, non pas incompatible, mais qui prévoit des mécanismes différents par rapport à ceux de la microévolution ? L’instrument fondamental pour l’étude de la macroévolution est constitué par la mesure du taux d’évolution d’une structure ou d’une espèce à partir de la datation des fossiles.
LE TAUX D’ÉVOLUTION
Le taux d’évolution est une mesure facilement calculable une fois que les fossiles ont été datés. C’est une fonction de la différence entre la structure examinée chez l’individu le plus moderne et celle de l’individu ancestral, le tout divisé par l’intervalle de temps écoulé. L’étude des taux d’évolution permet par exemple d’observer que le taux d’évolution des Mammifères est plus rapide que celui des Mollusques, et qu’en général les formes de vie les plus complexes subissent une évolution plus rapide que celle des formes les plus simples. En outre, on a suggéré, toujours sur la base de l’étude des taux d’évolution, que les espèces tendent à évoluer plus rapidement pendant les phénomènes de spéciation plutôt qu’entre. Ce dernier thème constitue la base de l’une des controverses actuelles concernant la macroévolution, qui oppose les tenants de la théorie des équilibres ponctués et les tenants du gradualisme.
LES ÉQUILIBRES PONCTUÉS
Le caractère incomplet des fossiles avait posé quelques problèmes à Darwin lui-même, puisqu’il ne montrait pas des changements évolutifs graduels. Depuis lors, de nombreux paléontologues se sont mis au travail pour trouver des exemples fossiles de changements évolutifs graduels. Deux d’entre eux en particulier, Niels Eldredge et Stephen J. Gould, ont concentré leur attention sur les mécanismes de spéciation allopatrique. Si les B évoluent dans une zone géographiquement différente de celle de l’espèce ancestrale de A, ces deux espèces ne laisseront de fossiles que dans les aires qu’ils habitent respectivement, à moins que les B n’envahissent de nouveau les aires occupées par les A. Dans ce cas, la nouvelle espèce appartiendra à une lignée de B et sera probablement plutôt différente de l’espèce ancestrale des A. Quand le paléontologue trouvera les restes de ces anciennes espèces, il découvrira des fossiles de A et de B dans les mêmes strates de roche, mais il ne trouvera pas de formes intermédiaires AB. Par conséquent, le changement évolutif semblera n’avoir pas été graduel, simplement parce que le processus de divergence aura eu lieu aillleurs. C’est en partant de cette considération que les deux savants ont proposé une théorie, appelée théorie « des équilibres ponctués », dans laquelle ils soutiennent les points fondamentaux suivants :
1) les espèces évoluent surtout par subdivision des lignes évolutives, le nouveau se formant à partir de l’espèce ancestrale par divergence ;
2) les nouvelles espèces évoluent rapidement ;
3) les nouvelles espèces se forment à partir d’une petite population de la forme ancestrale ;
4) la nouvelle espèce se forme dans une petite portion de l’aire de distribution de l’espèce ancestrale, de préférence dans une zone périphérique isolée.
LE GRADUALISME
En opposition à la théorie des équilibres ponctués (voir paragraphe précédent), les tenants du gradualisme soutiennent que, en général, les A se modifient graduellement dans le temps, donnant vie aux B, que cette transformation est graduelle et lente, et qu’elle implique toute la population originale de A. La différence substantielle entre les deux théories concerne les taux d’évolution pendant et entre les événements de spéciation. Dans le cas du gradualisme, le taux est constant au cours du temps ; pour les tenants des équilibres ponctués, ce taux est très élevé au moment de la subdivision de la ligne évolutive, tandis que, entre les événements de spéciation, le changement évolutif est très petit ou inexistant, période que Eldredge et Gould appellent « stase évolutive ». La controverse est encore très actuelle et a eu le mérite de stimuler un grand nombre d’études visant de façon très précise à tenter d’étayer l’une ou l’autre théorie. Il reste encore beaucoup de travail pour éclaircir les mécanismes macroévolutifs, mais la stimulation intellectuelle fournie par deux théories différentes semble riche en perspectives et en éclaircissements. Le tout, au bénéfice de la compréhension de l’histoire évolutive.
PHÉNOMÈNES MACROÉVOLUTIFS
L’étude de la macroévolution permet non seulement de déterminer les taux d’évolution et les mécanismes par lesquels le changement se produit (voir paragraphes précédents), mais pose aussi le problème de la définition des modalités suivant lesquelles les transitions entre les grands groupes d’animaux eurent lieu. L’évolution des Mammifères et des Oiseaux à partir des Reptiles, la conquête de la terre ferme par les Amphibiens ou les plantes terrestres, l’évolution d’organismes pluricellulaires à partir d’organismes unicellulaires sont autant de thèmes qui nécessitent une explication touchant les modalités par lesquelles la vie a atteint sa richesse actuelle. Un autre thème important dans les études concernant la macroévolution porte sur le phénomène de la coévolution, terme par lequel on indique l’évolution interdépendante de deux espèces (ou plus) ayant une relation écologique claire et tirant toutes deux bénéfice des interactions. C’est le cas d’une espèce de fourmi largement répandue en Europe (Formica fusca) qui utilise comme nutriment une substance produite par un organe particulier d’une chenille. La chenille semble ne produire cette sécrétion que pour nourrir la fourmi. La fourmi, en retour, protège la chenille contre une série de parasites dangereux. Le phénomène, très répandu dans la nature, est appelé mutualisme. L’évolution du comportement de la fourmi (défense contre les parasites) et celle de l’organe de la chenille sont étroitement liées. D’un point de vue évolutif, on peut imaginer que, le liquide produit augmentant, la fourmi a eu tendance à décourager de plus en plus les parasites qui auraient pu affaiblir ou tuer cette fabrique ambulante de délices. Ce comportement protecteur avantageait la chenille, et, du point de vue évolutif, favorisait les organes les plus actifs dans la production de la substance. Dans ce cas comme dans d’autres, il se crée une espèce de compétition qui tend vers le bien être des deux espèces. Ce type de mécanisme produit un changement évolutif ; c’est pourquoi on l’appelle coévolution. Un autre type de coévolution concerne le rapport entre l’hôte et le parasite. Une amélioration des capacités du parasite doit nécessairement comporter, sous peine de mort, une augmentation des capacités défensives de l’hôte au cours de l’évolution. L’évolution du système immunitaire est très étroitement lié aux phénomènes coévolutifs. Cette « course aux armements » peut être évidente même quand on étudie les fossiles de proies et de prédateurs du passé et qu’on les compare avec des formes actuellement vivantes. On remarque par exemple que les dimensions du cerveau augmentent chez l’un et l’autre, aussi bien chez la proie que chez le prédateur, avec le temps. Plus le prédateur est rusé, plus la proie doit être rusée pour lui échapper, plus la proie est rusée, plus le prédateur doit devenir rusé pour la capturer et ainsi de suite. Si l’intelligence d’une proie ou d’un prédateur est liée aux dimensions du cerveau, on constatera une augmentation du volume cérébral chez les différentes espèces de proies et de prédateurs. Attention toutefois, nous parlons ici de temps évolutifs à grande échelle (des dizaines de millions d’années), et d’une série d’espèces au cours du temps. Ce concept ne peut et ne doit pas être étendu à l’homme. Il serait absurde de considérer comme stupides ceux qui ont une petite tête, comme ont pourtant tenté de le faire des savants de mauvaise foi du siècle passé. Le cerveau d’Albert Einstein (1879-1975) a un poids qui correspond parfaitement à la moyenne. Cela devrait servir d’avertissement à tous ceux qui tentent, à travers des argumentations pseudo-évolutives, de justifier des attitudes racistes ou discriminantes dans un contexte qui n’a rien de commun avec le contexte évolutif.
LA THÉORIE NEUTRALISTE
Au niveau moléculaire, l’importance relative de la sélection naturelle dans l’évolution a été récemment remise en question par ce que l’on appelle la « théorie neutraliste », proposée par le généticien japonais Motoo Kimura. Selon cette théorie, fondée sur une série d’observations effectuées au niveau moléculaire, l’évolution est essentiellement due à des mutations neutres en ce qui concerne la sélection, c’est-à-dire à des changements qui n’améliorent ni ne diminuent la fitness de l’individu. Les neutralistes soutiennent donc que la plupart des changements évolutifs des molécules sont dus à une dérive génétique fortuite, tandis que, selon les tenants de la sélection naturelle, c’est cette dernière qui détermine l’évolution, même au niveau des molécules. Selon la théorie neutraliste, la dérive fortuite n’explique pas tous les changements évolutifs, et la sélection naturelle est encore nécessaire pour expliquer l’adaptation. La théorie neutraliste souligne que les adaptations observées dans la nature ne sont représentatives que d’une minorité de changements évolutifs présents et enregistrés dans l’ADN. Au niveau de l’ADN et des protéines, selon les neutralistes, le hasard a un effet fondamental et, par conséquent, la plupart des changements que l’on observe à ce niveau sont des changements non adaptatifs. La discussion entre les deux écoles, neutraliste et traditionaliste, est encore plutôt vive et le thème présente un très grand intérêt et a d’importantes conséquences sur le plan théorique.
USAGES ET ABUS DE LA THÉORIE ÉVOLUTIVE
LES ABUS
Certains savants, par le passé et jusqu’à récemment, ont souvent manifesté des préjugés raciaux, et étendu des théories formulées dans des contextes particuliers pour mettre en lumière de lourds préjugés sociaux. Du XIXe siècle à nos jours, les partisans de la discrimination à l’égard des Afro-américains, des Indiens d’Amérique, des Juifs, et en général à l’égard de tout type de « différence », ont recherché des fondements scientifiques à leurs théories. Ces préjugés, nés de l’ignorance, alimentent malheureusement encore les sentiments racistes dans nos sociétés actuelles. Une partie influente du monde scientifique a avalé et soutenu ces attitudes. Il ne faut pas oublier qu’à la rédaction du manifeste de la race, fondement de la discrimination et du génocide des Juifs, participèrent d’éminents scientifiques en Allemagne, en France et même en Italie, où, lors de la réunion pour la rédaction du manifeste, dirigée par le fasciste Starace, le 13 juillet 1938, dix professeurs d’universités italiennes signèrent le document.
Le concept de survie du plus adapté, emprunté au contexte darwinien, fut par le passé utilisé pour légitimer la pauvreté des couches sociales les plus faibles, et la supériorité des plus aisés, le colonialisme, l’impérialisme conçu comme conséquence inévitable de la « suprématie » biologique de la race occidentale. Il n’y a rien de biologique et de scientifiquement correct dans ces attitudes. Les résultats de certaines recherches ont été manipulés, les expériences révélant des vices de fond et des perspectives faussées. Des éléments empruntés à la théorie évolutive furent également appliqués à la criminologie. Cesare Lombroso (1835-1909), médecin italien de la deuxième moitié du XIXe siècle, tenta d’établir une relation entre la physionomie des délinquants et celle des singes, affirmant qu’un criminel l’est dès la naissance. De façon grotesque, Lombroso essaya de démontrer la tendance au crime chez les espèces animales pour justifier sa propre approche de la criminologie. L’équation « animal = criminel » fut portée à des conséquences ridicules, puisque Lombroso parvint à postuler une ressemblance significative entre l’asymétrie du visage de certains criminels et celle des soles, dont les deux yeux résident sur une seule partie du corps, ou bien en établissant que les prostituées avaient une tendance à avoir les pieds préhensiles comme ceux des singes. La pensée de Lombroso fut déterminante et son influence se manifesta pendant de nombreuses années dans les cercles pénaux. Aujourd’hui encore, de façon intermittente, le comportement criminel est mis en relation avec des caractéristiques physiques, mais la mauvaise foi est plus subtile et utilise des études de génétique pour tenter de démontrer ces hypothèses fallacieuses, oubliant l’importance fondamentale que revêt le milieu social dans la formation de tendances criminelles. Il faut donc garder cela présent à l’esprit, plutôt que d’essayer d’attribuer le comportement violent de personnes désespérées à des caractéristiques physiques ou génétiques.
PHILOSOPHIE
L’impact de la théorie de l’évolution sur la pensée philosophique et sur la position de l’homme dans la nature détermina une révolution culturelle. L’homme pré-copernicien pensait être au centre d’un univers créé pour lui et à cause de lui. Kepler, Galilée et Newton modifièrent plus tard l’image de l’Univers et de l’homme. La Terre fut vue comme une planète plutôt petite, tournant autour d’un Soleil beaucoup plus grand ; il n’y avait plus de sphères célestes mais seulement le vide, d’autres planètes et des galaxies. L’homme était perdu dans les espaces cosmiques. Darwin représente dans un certain sens le Newton de la biologie, car il démontra que les espèces biologiques, y compris l’homme, ne sont pas apparues sur la Terre comme un paquet préemballé. Chaque espèce descend d’ancêtres différents et a une histoire évolutive différente. La diversité des êtres vivants est une conséquence de l’adaptation à des milieux différents. La variété infinie de structures et de fonctions rend possible une diversité infinie de modes de vie. L’espèce humaine présente toutefois une particularité par rapport aux autres espèces animales. L’adaptation au milieu dans lequel elle vit est fortement influencée par la culture. De génération en génération, l’hérédité culturelle est transmise, dégageant l’homme, au moins partiellement, des conditionnements du milieu physique dans lequel il vit. Le concept du devenir et la transformation sont vus à la lumière de l’évolution comme des caractéristiques fondamentales du monde biologique. Le devenir est par conséquent un processus omniprésent, qui peut être étendu à tout l’Univers. Il est évident que cette conception change de façon radicale la position de l’homme dans la nature. L’Univers va-t-il quelque part ? Et où ? La régularité sereine des lois physiques de l’Univers, qui nous permettrait peut-être de dormir plus tranquillement, est bouleversée par ce changement constant. Même si les mécanismes par lesquels opère l’évolution inorganique sont différents de ceux qui intéressent l’évolution biologique et l’évolution culturelle de l’homme, le devenir et le mouvement représentent le contexte dans lequel l’homme évolue. Devenir et mouvement sont des concepts qui sont entrés dans la science grâce à la théorie évolutive. L’Univers n’est pas statique mais dynamique. Le mouvement a une direction, et on a assisté à de nombreuses controverses entre les théoriciens de la biologie évolutionniste pour savoir si ce mouvement était ou non assimilable à un progrès. En réalité, la notion de progrès n’est pas applicable à l’évolution animale. Il existe une direction dans le changement, mais le terme de progrès a une connotation éthique qui n’a rien à voir avec les processus qui régissent l’évolution des structures et des organes. Une bactérie qui se reproduit de manière exponentielle et qui laisse une multitude de descendants en quelques heures est-elle moins évoluée qu’un couple avec un enfant unique ? La conception de progrès dans le monde animal est fortement influencée par notre anthropocentrisme. Dans ce contexte, on peut se demander ce que représente l’homme. L’évolution est un processus créatif, et la créativité risque souvent l’insuccès, l’impasse. Chaque espèce biologique, y compris la nôtre, est une expérience de la nature. Mais l’on ne doit pas oublier que notre rôle dans la nature est beaucoup plus conditionnant que celui de toutes les autres espèces :
« Quel rôle l’homme doit-il jouer dans l’évolution ? Doit-il en être le simple spectateur, le metteur en scène ou, par hasard, la pointe de diamant de ce processus ? Il y a des personnes qui se libéreraient de cette question en haussant les épaules, ou l’éviteraient, en la considérant comme la manifestation d’une folle arrogance. Toutefois, puisque l’homme est un être rationnel, et probablement le seul, à avoir acquis la conscience du processus de l’évolution, il peut difficilement éviter de se poser de telles questions. Le problème impliqué n’est rien d’autre que celui du sens de son existence même. L’homme vit-il seulement pour vivre, n’y a-t-il pas pour lui de but ou de sens autre que celui-ci ? Ou bien est-il appelé à participer à la construction du meilleur des univers pensables ? » (Theodosius Dobzhansky, 1975 : Diversité génétique et égalité humaine).
PSYCHOLOGIE
La psychologie aussi a pu tirer des avantages de son intégration aux théories évolutives. Le fait de considérer l’homme comme descendant d’autres Vertébrés peut nous aider à comprendre certains de ses comportements et à mettre en lumière certains de ses aspects apparemment contradictoires. Ces contrastes peuvent être simplement des compromis entre les nécessités instinctives héritées de parents ancestraux et les influences culturelles du milieu social dans lequel il vit. Le cortex cérébral, la partie du cerveau qui a fait son apparition à une époque plutôt récente, est fondamental pour les capacités intellectuelles, la logique, la résolution de problèmes complexes, les décisions et les choix de l’esprit humain. Parfois, les parties cérébrales situées sous le cortex, plus anciennes, poussent l’homme à se comporter de façon plus appropriée du point de vue évolutif. L’équilibre de l’homme dépend beaucoup de la flexibilité de l’intégration des stimulus provenant de ces deux zones différentes du cerveau, et une caractéristique de nombreux troubles psychiques consiste précisément à altérer cette plasticité, déterminant toute une série de maladies psychologiques.
MÉDECINE ET AGRICULTURE
Au cours des dernières décennies, l’échec des approches traditionnelles dans la lutte contre les maladies infectieuses et contre les agents nuisibles dans les cultures agricoles semble de plus en plus évident. C’est ainsi que l’augmentation du nombre de substances antibiotiques semble s’être accompagnée de l’apparition de maladies nouvelles et dangereuses. C’est en effet ces dernières années que sont apparues des maladies telles que le sida, la fièvre hémorragique vénézuélienne, la maladie du légionnaire, le virus Ebola. En outre, l’augmentation du nombre de pesticides s’accompagne d’une augmentation des problèmes dérivant des infestations des cultures, avec de lourds préjudices pour l’agriculture. Tout cela laisse à penser que la façon dont les pays occidentaux ont jusqu’à présent abordé les organismes nuisibles est arrivée à un point mort. Les consciences se sont enthousiasmées pour les premiers résultats des antibiotiques et des pesticides, et se sont fossilisées sur ces modalités de lutte. L’étude du nouveau a été abordée en prenant pour acquis que le nouveau était identique à l’ancien. Aujourd'hui, de nombreux savants s’accordent à montrer que ces stratégies ne sont plus adaptées. C’est ainsi que sont nées de nouvelles lignes de pensée telles que ce que l’on appelle la « médecine darwinienne » ou la lutte biologique contre les agents nuisibles. Dans ce sens, la théorie moderne de l’évolution peut aider, avec l’écologie, à déterminer une approche complètement nouvelle. Il faut considérer la variabilité génétique des espèces, tenir compte du fait que l’espèce et le milieu sont des entités complexes, dont les dynamiques ne sont pas toujours prévisibles, et penser que rien n'est en réalité constant dans le temps. Nos solutions doivent toujours être considérées comme temporaires.
Si l’on commence par considérer le corps humain comme le produit de l’évolution, comme un corps parfait et compliqué sous de nombreux points de vue, mais encore plein d’imperfections et de compromis dus à son historie évolutive, alors le point de vue change, et change aussi notre approche de la médecine. Nous sommes en mesure d’expliquer la nausée et les vomissements chez les femmes enceintes comme des réactions adaptatives, en ce sens qu’elles conduisent à éviter des substances qui peuvent d’une façon ou d’une autre être dangereuses pour le fœtus. Nous pouvons expliquer notre dégoût pour certains plats par le fait qu’ils contiennent des substances que notre organisme considère comme dommageables. En même temps, il faut chercher une explication à ces phénomènes qui nous rendent extrêmement imparfaits. Pourquoi la sélection naturelle n’a-t-elle pas éliminé ces gènes qui permettent le dépôt de cholestérol dans les veines, qui entraîne des maladies cardio-vasculaires et parfois même la mort ? Pourquoi sommes-nous gourmands d’aliments souvent nocifs alors que nous regardons avec dédain les légumes et les féculents ? Pourquoi continuons-nous à manger même quand nous savons que nous sommes trop gros ?
Les virus, les Bactéries et tous les autres agents nuisibles doivent aussi être considérés comme le fruit de l’évolution, répondant à la sélection naturelle, en changement permanent, en relation phylogénétique avec d’autres espèces (phylogenèse). En même temps, les causes d’une maladie devraient être considérées dans leur ensemble. Un individu donné tombe malade non pas parce que le virus l’a contaminé, mais parce que son milieu interne à ce moment précis correspondait aux nécessités du virus, et parce qu’il est entré en contact avec un autre individu malade qui lui a transmis cet agent pathogène. Dans une vision plus large, l’eutrophisation des eaux côtières, due à l’érosion, aux fertilisants utilisés en agriculture, aux décharges humaines et au réchauffement de la mer, détermine des floraisons d’algues qui servent de terrain de culture pour le vibrion du choléra, dans des pays où l’hygiène et les services sociaux présentent en général des carences. La faible assistance sociale due aux conditions économiques des pays pauvres (causée par la dette contractée avec les pays les plus riches) fait que les gouvernements sous-estiment la portée du phénomène. C’est ainsi que le choléra prolifère et fait de nombreuses victimes. Ce dernier exemple est extrême et montre que non seulement il nous faut trouver une nouvelle approche médicale, dans laquelle la théorie évolutive trouve sa juste place, mais qu’un changement d’échelle pour la considération des problèmes est fortement recommandé. On ne peut pas penser que la cause d’une infection est simplement due à la pénétration physique d’un virus, et que l’on ne peut non plus combattre une épidémie de choléra en isolant simplement les personnes contaminées. La théorie évolutive peut nous aider à acquérir une vision globale des phénomènes, nécessaire pour en comprendre les mécanismes.
«
2
évolutionniste.
La grande diversité des espèces vivantes est le fruit d’un
changement durant lequel, à partir d’un ancêtre commun unique, se sont produites
des ramifications, des bifurcations, des impasses et des modifications dans la
même ligne évolutive.
Et ce sont précisément le changement et la bifurcation de la
ligne évolutive des organismes qui sont les principaux thèmes abordés par la
théorie évolutionniste.
Une autre notion fondamentale de la théorie évolutive est celle d’adaptation.
L’adaptation fait appel aux propriétés des organismes leur permettant de survivre et
de se reproduire, même lorsqu’ils subissent une légère variation des conditions du
milieu.
Les exemples d’adaptation que l’on trouve dans la nature sont
innombrables.
Il faut toutefois garder présent à l’esprit que toutes les
caractéristiques morphologiques ou comportementales des êtres vivants ne
peuvent pas être considérées comme adaptatives, même si ce sont certainement
les plus importantes et il nous faut trouver une explication à leur présence.
BRÈVE HISTOIRE DE LA BIOLOGIE ÉVOLUTIONNISTE
L’ÉVOLUTION SELON LAMARCK
Au début du XX esiècle, Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) fut le naturaliste qui
énonça le premier la théorie de l’évolution, selon laquelle tous les êtres vivants
auraient subi au cours du temps des transformations continues.
D’après son
hypothèse, qui prit le nom de transformisme, les caractères acquis pendant le
développement individuel seraient héréditaires.
L’adaptation serait donc le résultat
de modifications corporelles acquises car produites durant la vie des individus, à la
suite de l’usage ou du défaut d’exercice d’organes déterminés, modifications qu’ils
auraient transmises à leurs descendants.
Par exemple, un homme très sportif
pourrait faire des enfants ayant une plus grande tendance à développer leurs
muscles une fois devenus adultes.
LA THÉORIE DE DARWIN
La juste formulation des mécanismes évolutifs fut élaborée par Charles R.
Darwin
(1809-1882) et exposée dans son célèbre ouvrage l’Origine des espèces, publié en
1859.
Darwin expliqua les adaptations et la formation de nouvelles espèces par la
théorie de la sélection naturelle, selon laquelle seuls certains individus d’une
population contribuent de façon conséquente à la génération de la descendance,
tandis que les autres individus y contribuent moins ou pas du tout.
Puisque les
caractéristiques de la descendance reflètent celles des parents, les caractères des
parents qui ont généré plusieurs enfants deviendront de plus en plus fréquents
dans les générations suivantes et la composition génétique de la population se
modifiera avec le temps.
LA SYNTHÈSE MODERNE
Malgré les différentes tentatives pour réfuter la théorie darwinienne et la difficulté
pour le milieu scientifique, jusqu’au début du siècle, d’accepter la théorie de la
sélection naturelle, celle-ci survécut et prit un essor particulier à partir des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉVOLUTION BIOLOGIQUE INTRODUCTION La théorie de l'évolution est indubitablement la théorie la plus importante dans le domaine biologique, tant par ses potentialités scientifiques que par les recherches intellectuelles qu'elle suscite.
- évolution biologique - science.
- homme, évolution de l' 1 PRÉSENTATION homme, évolution de l', évolution biologique et culturelle de l'espèce humaine, Homo sapiens.
- évolution biologique 1 PRÉSENTATION évolution biologique, processus par lequel les espèces vivantes se modifient au cours du temps et engendrent de nouvelles espèces.
- évolution biologique (Biologie et Anatomie).