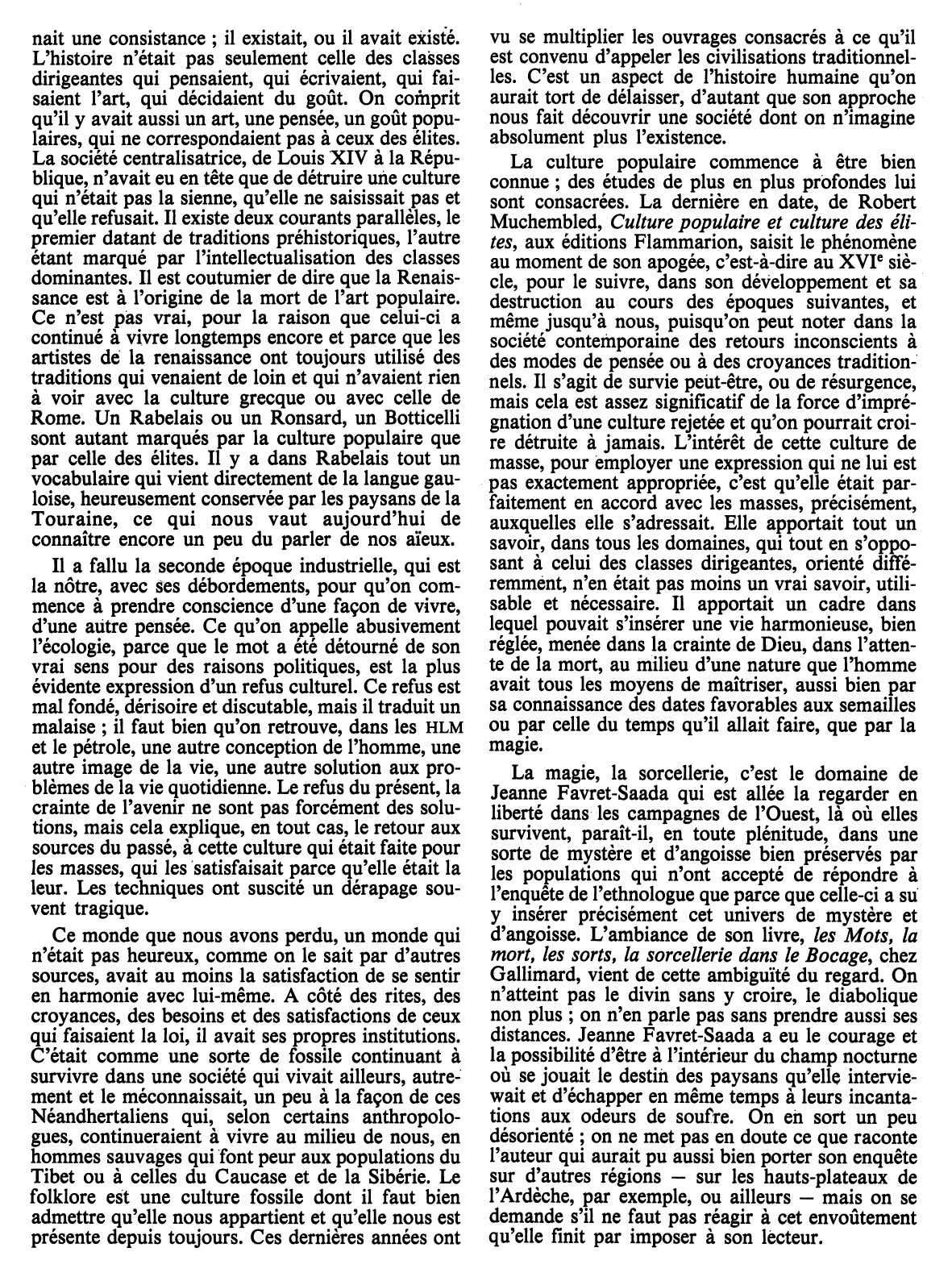Comment on tue une civilisation
Publié le 06/12/2011

Extrait du document
Il y a des civilisations qu'on tue. Les exemples ne manquent pas. Un des plus célèbres est celui des Etrusques, qui nous est proche. Voilà une population italienne, qui avait sa langue, sa culture, sa religion, sa littérature et son art et qui, sous les coups des Romains, disparaît en moins de deux siècles. On parlait encore l'étrusque au temps d'Auguste. On ne possède plus aujourd'hui ni le moindre texte ni le moindre dictionnaire étrusques. La même remarque vaut ailleurs. Quand les Espagnols vont au Mexique, ils se montrent d'abord très ouverts à la civilisation indienne qui les étonne justement comme le ferait ·ta découverte d'une autre galaxie, et puis, presque gratuitement, le respect qu'ils manifestaient à l'égard d'un peuple inconnu se transforme en haine, et ils détruisent tout.
«
naît une consistance ; il existait, ou il avait e:irisié.
L'histoire n'était pas seulement celle des classes
dirigeantes qui pensaient, qui écrivaient, qui fai
saient l'art, qui décidaient du goût.
On comprit
qu'il y avait aussi un art, une pensée, un goût popu
laires, 9.ui ne correspondaient pas à ceux des élites.
La societé centralisatrice, de Louis XIV à la Répu
blique, n'avait eu en tête que de détruire une culture
qui n'était pas la sienne, qu'elle ne saisissait pas et
qu'elle refusait.
Il existe deux courants parallèles, le
premier datant de traditions préhistoriques, l'autre
étant marqué
par l'intellectualisation des classes
dominantes.
Il est coutumier de dire que la Renais
sance est à l'origine de la mort de l'art populaire.
Ce n'est pas vrai, pour la raison que celui-ci a
continué à vivre longtemps encore et parce que les
artistes
de la renaissance ont toujours utilisé des
traditions qui venaient de loin et qui n'avaient rien
à voir avec
la culture grecque ou avec celle de
Rome.
Un Rabelais ou un Ronsard, un Botticelli
sont autant marqués par la culture populaire que
par celle des élites.
Il y a dans Rabelais tout un
vocabulaire qui vient directement de
la langue gau
loise, heureusement conservée par les paysans de la Touraine, ce qui nous vaut aujourd'hui de
connaître encore un peu du parler de nos aïeux.
Il a fallu
la seconde époque industrielle, qui est la nôtre, avec ses débordements, pour qu'on com
mence à prendre conscience d'une façon de vivre,
d'une
autre pensée.
Ce qu'on appelle abusivement
l'écologie, parce que le mot a eté détourné de son
vrai sens pour des raisons politiques, est la plus
évidente expression d'un refus culturel.
Ce refus est
mal fondé, dérisoire et discutable, mais il traduit un
malaise; il faut bien qu'on retrouve, dans les
HLM et le pétrole, une autre conception de l'homme, une
autre image de la vie, une autre solution aux pro
blèmes de la vie quotidienne.
Le refus du présent, la
crainte de l'avenir ne sont pas forcément des solu
tions, mais cela explique, en tout cas, le retour aux
sources du passé, à cette culture qui était faite pour
les masses, qui les
·satisfaisait parce qu'elle était la
leur.
Les techniques ont suscité un dérapage sou
vent tragique.
Ce monde que nous avons perdu, un monde qui
n'était pas heureux, comme on le sait
par d'autres
sources, avait au moins la satisfaction de se sentir
en harmonie avec lui-même.
A côté des rites, des
croyances, des besoins et des satisfactions de ceux
qui faisaient
la loi, il avait ses propres institutions.
C'était comme une sorte de fossile continuant à
survivre dans une société qui vivait ailleurs,
autre~ ment et le méconnaissait, un peu à la façon de ces
Néandhertaliens qui, selon certains anthropolo
gues, continueraient à vivre au milieu de nous, en
hommes sauvages qui font peur aux populations du
Tibet ou à celles du Caucase et de la Sibérie.
Le
folklore
est une culture fossile dont il faut bien
admettre qu'elle nous appartient et qu'elle nous est
présente depuis toujours.
Ces dernières années ont vu
se multiplier
les ouvrages consacrés à ce qu'il
est convenu d'appeler les civilisations traditionnel
les.
C'est un aspect de l'histoire humaine qu'on
aurait tort de délaisser, d'autant que son approche
nous fait découvrir une société dont on n'imagine
absolument plus l'existence.
La culture populaire commence à être bien
connue ; des études de plus en plus profondes lui
sont consacrées.
La dernière en date, de Robert
Muchembled, Culture populaire et culture des éli tes, aux éditions Flammarion, saisit le phénomène
au moment de son apogée, c'est-à-dire au XVIe siè cle, pour le suivre, dans son développement et sa
destruction au cours des époques suivantes, et
même jusqu'à nous, puisqu'on peut noter dans la
société contemporaine des retours inconscients à
des modes de pensée ou à des croyances
tradition~ nels.
Il s'agit de survie peut-être, ou de résurgence,
mais cela est assez significatif de la force d'impré
gnation d'une culture rejetée et qu'on pourrait croi
re détruite à jamais.
L'intérêt de cette culture de
masse, pour employer une expression qui ne lui est
pas exactement appropriée, c'est qu'elle était par
faitement en accord avec les masses, précisément,
auxquelles elle s'adressait.
Elle apportait tout un
savoir, dans tous les domaines, qui tout en s'oppo
sant à celui des classes dirigeantes, orienté diffé
remment, n'en était pas moins un vrai savoir, utili
sable et nécessaire.
Il apportait un cadre dans
lequel pouvait s'insérer une vie harmonieuse, bien
réglée, menée dans
la crainte de Dieu, dans l'atten
te de la mort, au milieu d'une nature que l'homme
avait tous les moyens de maîtriser, aussi bien par sa connaissance des dates favorables aux semailles
ou par celle du temps qu'il allait faire, que par la magie.
La magie,
la sorcellerie, c'est le domaine de
Jeanne Favret-Saada qui est allée la regarder en
liberté dans les campagnes de l'Ouest, là où elles
survivent, paraît-il, en toute plénitude, dans une
sorte de mystère et d'angoisse bien préservés
par les populations qui n'ont accepté de répondre à
l'enquëte de l'ethnologue que parce que celle-ci a sli y insérer précisément cet univers de mystère et
d'angoisse.
L'ambiance de son livre, les Mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le Bocage, chez
Gallimard, vient de cette ambiguïté du regard.
On n'atteint pas le divin sans y croire, le diabolique
non plus ; on n'en parle pas sans prendre aussi ses
distances.
Jeanne Favret-Saada a eu le courage et
la possibilité d'être à l'intérieur du champ nocturne
où se jouait le destiil des paysans qu'elle intervie
wait et d'échapper en même temps à leurs incanta
tions aux odeurs de soufre.
On eil.
sort un peu
désorienté ; on ne met pas en doute ce que raconte
l'auteur qui aurait pu aussi bien porter son enquête
sur d'autres régions -sur les hauts-plateaux de
l'Ardèche,
ear exemple, ou ailleurs -mais on se
demande s'd ne faut pas réagir à cet envoûtement
qu'elle fmit par imposer à son lecteur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d'étude : Sigmund Freud, Le Malaise dans la civilisation - comment la civilisation peut-elle répondre à l'agressivité ?
- Thème Civilisation spécialité HLP questions
- L’EMPIRE DU GHANA (Evolution et civilisation)
- CIVILISATION ÉGÉENNE (La). (résumé & analyse)
- ÉROS ET CIVILISATION, Contribution à Freud, Herbert Marcuse