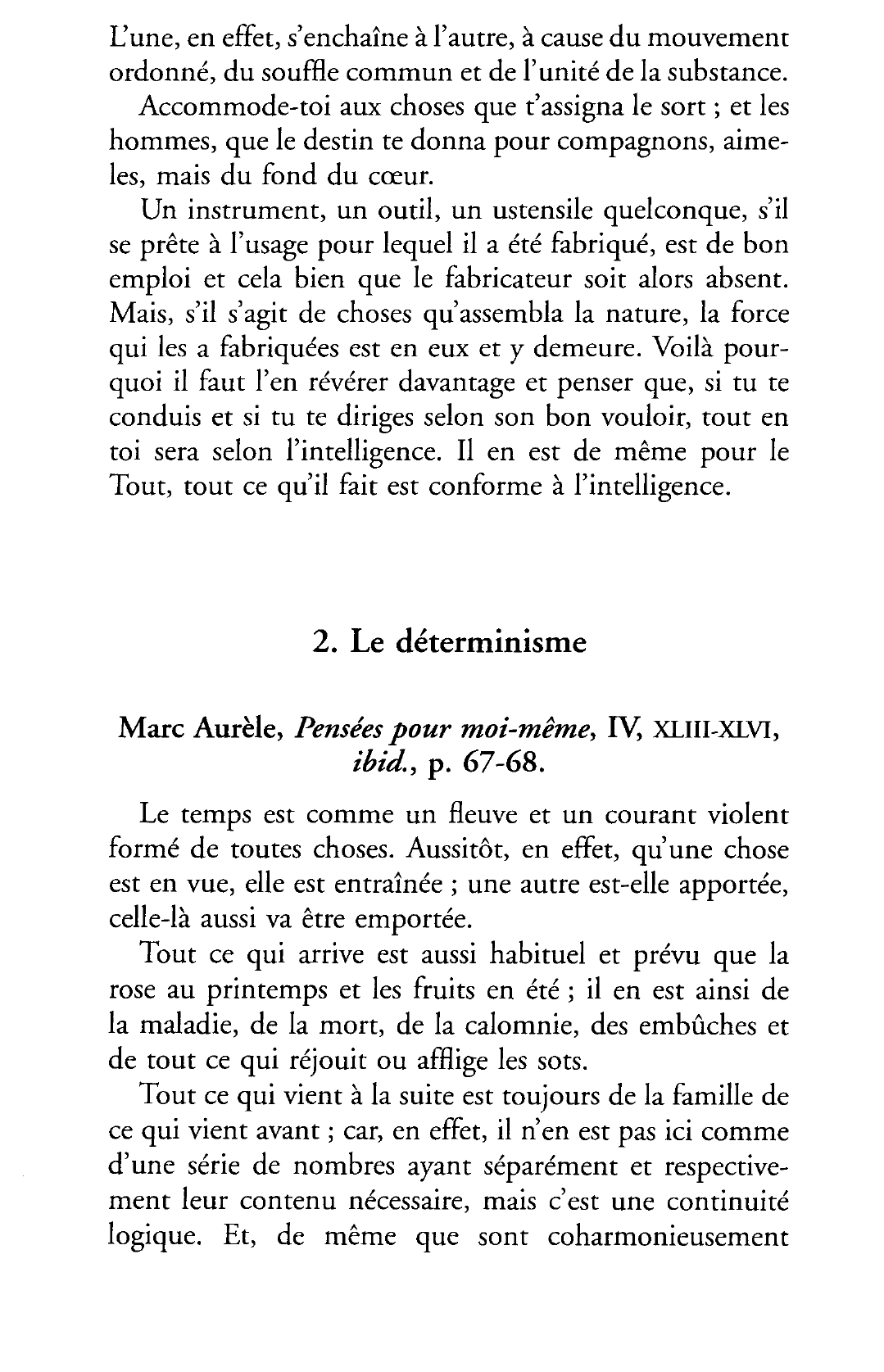EXTRAITS STOÏCISME ANTHOLOGIE PHILOSOPHIQUE
Publié le 17/06/2015

Extrait du document
ordonnées les choses qui sont, les choses qui naissent manifestent, non une simple succession, mais un admirable apparentement.
Constamment se souvenir de cette pensée d'Héraclite : « La mort de la terre est de devenir eau, la mort de l'eau est de devenir air, et la mort de l'air, de se changer en feu, et inversement. «
Se souvenir aussi « de l'homme qui oublie où le chemin conduit «. Et de ceci encore : « Que les hommes, dans le commerce qu'ils entretiennent continuellement avec la raison qui gouverne le Tout, ne s'accordent pas toujours avec elle, et qu'ils regardent comme étrangers les événements qui chaque jour leur arrivent. « Et, en outre, qu'« il ne faut ni agir ni parler comme en dormant «, car il nous semble alors que nous agissons aussi et que nous parlons, « ni comme des fils de menuisiers «, c'est-à-dire par routine et comme nous l'avons appris.
3. Les « superstitions « des stoïciens
Épictète, Manuel, XXXII, trad. Emmanuel Cattin, GF-Flammarion, 1997, p. 79-80.
Quand tu te tournes vers la divination, rappelle-toi : tu ne sais pas ce qui adviendra, mais tu es là pour l'apprendre du devin, cependant tu sais en arrivant de quelle nature est l'événement, si du moins tu es philosophe. Si en effet il est du nombre des choses qui sont hors de notre portée, de toute nécessité il ne s'agit ni d'un bien ni d'un mal. N'emporte donc chez le devin ni désir ni aversion, et n'approche pas de lui en tremblant, mais avec la pensée distincte que tout ce qui adviendra est indifférent et n'est rien pour toi, quelle qu'en soit la nature il sera en ton pouvoir
ne le pouvaient absolument pas. Car, vivant sur la terre, et enchaînés à un tel corps et à de tels compagnons, comment aurions-nous pu ne pas être entravés pour ce reste par les objets du dehors ?
Que dit Jupiter ? « Épictète, si je l'avais pu, j'aurais encore fait libres et indépendants ton petit corps et ta petite fortune. Mais, ne l'oublie pas, ce corps n'est pas à toi ; ce n'est que de la boue artistement arrangée. Comme je n'ai pu l'affranchir, je t'ai donné une partie de nous-même, la faculté de te porter vers les choses ou de les repousser, de les désirer ou de les éviter, en un mot, de savoir user des idées. Si tu la cultives, si tu vois en elle seule tout ce qui est à toi, jamais tu ne seras empêché ni entravé ; jamais tu ne pleureras ; jamais tu n'accuseras ni ne flatteras personne. «
6. « Les destins conduisent ceux qui les acceptent et traînent ceux qui les refusent «
Sénèque, Lettres à Lucilius, CVII, trad. Joseph Baillard et divers collaborateurs, in Œuvres de Sénèque, le philosophe, Garnier frères, t. II, 1860, p. 131-134.
Où est cette prudence qui vous distinguait, cette sagacité qui appréciait si bien les événements ; où est votre grandeur de courage ? Une bagatelle vous désole ? Vos esclaves ont profité de vos nombreuses occupations pour s'échapper. Prenez que c'étaient de faux amis (et en vérité laissons-leur ce nom d'amis que leur donne Épicure) ; consentez à voir vos foyers purgés de leur présence ; passez-vous de gens qui absorbaient tous vos soins et vous rendaient souvent de mauvaise humeur.
Rien en cela d'étrange, rien d'inattendu. S'en émouvoir est aussi ridicule que de se plaindre d'être mouillé ou crotté en pleine rue. On doit compter dans la vie, sur les mêmes accidents qu'aux bains publics, dans une foule, sur une grande route : il y en aura de prémédités, il y en aura de fortuits. Ce n'est pas une affaire de plaisir que la vie. Engagé dans une longue carrière, il faut que l'homme trébuche, chancelle, tombe, qu'il s'épuise enfin, et s'écrie : « Ô mort ! «, c'est-à-dire qu'il mente. Ici vous laisserez en chemin l'un de vos compagnons, là vous enterrerez l'autre, un troisième menacera vos jours. Voilà au milieu de quels encombres il faut parcourir cette route hérissée d'écueils. — Un ami vouloir ma mort ! — Préparez votre âme à tout cela. Vous êtes venu, sachez-le bien, là où éclate la foudre ; vous êtes venu sur des bords
Où les Chagrins et les Remords vengeurs ont fixé leur demeure, où habitent les pâles Maladies et la triste Vieillesse.
Voilà la société dans laquelle il faut passer sa vie. Éviter tant d'ennemis est impossible ; mais on peut les braver, et on les brave, quand on y a songé souvent et tout prévu d'avance. On affronte plus hardiment le péril contre lequel on s'est longtemps préparé ; les plus dures atteintes, dès qu'on s'y attend, s'amortissent, comme les plus légères effrayent, si elles sont imprévues. Tâchons que rien ne soit inopiné pour nous ; et comme tout mal dans sa nouveauté pèse davantage, nous devrons à une méditation continuelle de n'être neufs pour aucun.
Mes esclaves m'ont abandonné ! — D'autres ont pillé leur maître, l'ont calomnié, massacré, trahi, foulé aux pieds, empoisonné, attaqué devant la justice, poursuivi criminellement. Tout ce que vous diriez de plus affreux est arrivé mille fois. Mais en outre, quelle multitude et quelle variété de traits nous menacent ! Les uns déjà nous ont percés ; on brandit les autres : en ce moment même
Cléanthe en vers éloquents que l'exemple de l'éloquent Cicéron me permet de traduire. S'ils vous plaisent, vous m'en saurez gré ; sinon, songez à Cicéron, dont je n'ai fait que suivre l'exemple.
Guide-moi, mon père, ô toi qui régis le ciel élevé ; j'obéis sans délai : je suis prêt. Si tes ordres contrarient mes désirs, je te suivrai en gémissant ; méchant, je dois au moins souffrir ce que l'homme de bien a pu souffrir. Les destins conduisent celui qui se soumet à leurs arrêts ; ils entraînent celui qui résiste.
Que tels soient et notre vie et notre langage ! que le destin nous trouve prêts et déterminés ! Une âme grande s'abandonne à Dieu : au contraire, les esprits faibles et pusillanimes veulent lutter, ils calomnient l'ordre de l'univers, et prétendent réformer la Providence plutôt qu'eux-mêmes.
7. Hipparchia et Cratès font l'amour au grand jour
Diogène Lerce, Vie, doctrines et sentences
des philosophes illustres, VI, trad. Robert Genaille,
GF-Flammarion, t. II, 1933, p. 44.
Les discours de ces philosophes convertirent encore la soeur de Métroclès, Hipparchia. Comme lui, elle était de Maronée. Elle s'éprit si passionnément de la doctrine et du genre de vie de Cratès qu'aucun prétendant, fût-il riche, noble ou bien fait, ne put la détourner de lui. Elle alla jusqu'à menacer ses parents de se tuer si elle n'avait pas son Cratès. Cratès fut invité par eux à la détourner de son projet : il fit tout ce qu'il put pour cela, mais finalement,
n'arrivant pas à la persuader, il se leva, se dépouilla devant elle de ses vêtements, et lui dit : « Voilà votre mari, voilà ce qu'il possède, décidez-vous, car vous ne serez pas ma femme si vous ne partagez mon genre de vie. « La jeune fille le choisit, prit le même vêtement que lui, le suivit partout, fit l'amour avec lui au grand jour, et alla avec lui aux repas. Un jour où elle vint à un repas chez Lysimaque, elle confondit Théodore, surnommé l'Impie, par le raisonnement suivant : « Ce que Théodore ferait sans y voir une injustice, Hipparchia peut aussi le faire sans injustice. Or Théodore peut se frapper sans dommage, donc Hippar-chia, en frappant Théodore, ne lui fait aucun dommage. « L'autre ne répondit rien, mais lui souleva son vêtement. Mais Hipparchia n'en fut ni frappée, ni effrayée, bien que femme. Et comme il lui disait : « Qui donc a laissé sa navette sur le métier ? « elle lui répondit : « C'est moi, Théodore, mais ce faisant, crois-tu donc que j'ai mal fait, si j'ai employé à l'étude tout le temps que, de par mon sexe, il me fallait perdre au rouet ? «
On raconte encore bien d'autres bons mots de cette femme philosophe.
8. Ne pas craindre la mort
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, IV, XLVII-L, op. cit., p. 68-70.
Si l'un des Dieux te disait : « Tu mourras demain ou, en tout cas, après-demain «, tu n'attacherais plus une grande importance à ce que ce soit dans deux jours plutôt que demain, à moins d'être le dernier des rustres, car qu'est-ce que ce délai ? De même, ne crois pas que mourir dans beaucoup d'années plutôt que demain soit de grande importance.
Considère sans cesse combien de médecins sont morts, après avoir tant de fois froncé les sourcils sur les malades ; combien d'astrologues, après avoir prédit, comme un grand événement, la mort d'autres hommes ; combien de philosophes, après s'être obstinés à discourir indéfiniment sur la mort et l'immortalité ; combien de chefs, après avoir fait périr tant de gens ; combien de tyrans, après avoir usé avec une cruelle arrogance, comme s'ils eussent été immortels, de leur pouvoir de vie et de mort ; combien de villes, pour ainsi dire, sont mortes tout entières : Hélice, Pompéi, Herculanum, et d'autres innombrables ! Ajoutes-y aussi tous ceux que tu as vus toi-même mourir l'un après l'autre. Celui-ci rendit les derniers devoirs à cet autre, puis fut lui-même exposé par un autre, qui le fut à son tour, et tout cela en peu de temps ! En un mot, toujours considérer les choses humaines comme éphémères et sans valeur : hier, un peu de glaire ; demain, momie ou cendre. En conséquence, passer cet infime moment de la durée conformément à la nature, finir avec sérénité, comme une olive qui, parvenue à maturité, tomberait en bénissant la terre qui l'a portée, et en rendant grâces à l'arbre qui l'a produite.
Ressembler au promontoire contre lequel incessamment se brisent les flots. Lui, reste debout et, autour de lui, viennent s'assoupir les gonflements de l'onde.
« Malheureux que je suis, parce que telle chose m'est arrivée ! « Mais non, au contraire : « Bienheureux que je suis, puisque telle chose m'étant arrivée, je persiste à être exempt de chagrin, sans être brisé par le présent, ni effrayé par ce qui doit venir. « Chose pareille, en effet, aurait pu survenir à n'importe qui ; mais n'importe qui n'aurait point su persister de ce fait à être exempt de chagrin. Pourquoi donc cet accident serait-il un malheur, plutôt que cet autre bonheur ? Appelles-tu, somme toute, revers pour un homme, ce qui n'est pas un revers pour la nature de l'homme ? Et cela te paraît-il être un revers
pour la nature de l'homme, ce qui n'est pas contraire à l'intention de sa nature ? Eh quoi ! cette intention, tu la connais. Cet accident t'empêche-t-il d'être juste, magnanime, sage, circonspect, pondéré, véridique, réservé, libre, etc., toutes vertus dont la réunion fait que la nature de l'homme recueille les biens qui lui sont propres ? Souviens-toi d'ailleurs, en tout événement qui te porte au chagrin, d'user de ce principe : ceci n'est pas un revers, mais c'est un bonheur que de noblement le supporter.
Secours vulgaire, mais tout de même efficace, pour atteindre au mépris de la mort, que de se rappeler ceux qui ont voulu s'attacher opiniâtrement à la vie. Qu'ont-ils de plus que ceux qui sont morts avant l'heure ? De toute façon, ils gisent enfin quelque part, Cadicianus, Fabius, Julianus, Lépidus, et tous leurs pareils, qui, après avoir conduit bien des gens au tombeau, ont fini par y être conduits. En somme, l'intervalle est petit, et à travers quelles épreuves, avec quels compagnons et dans quel corps faut-il le passer ! Ne t'en fais donc pas un souci. Regarde derrière toi l'infinité de la durée ; et, devant toi, un autre infini. Dans cette immensité, en quoi différent celui qui a vécu trois jours et celui qui a duré trois fois l'âge du Gérénien 1 ?
9. Accepter le destin
Épictète, Entretiens, II, v, op. cit., p. 123-124.
[...] Ne dis jamais des choses extérieures qu'elles sont bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles, ni quoi que ce soit en ce genre.
1. Ce Gérénien, qui vécut trois âges d'homme, est Nestor. Voir Homère, Iliade, I, 262.
10. La philosophie stoïcienne contre l'espérance Épictète, Entretiens, I, xv, ibid., p. 53-54.
Quelqu'un le consultait sur les moyens de persuader à son frère de ne plus vivre mal avec lui. La philosophie ne s'engage pas, lui dit-il, à procurer à l'homme quoi que ce soit d'extérieur ; autrement, elle s'occuperait de choses étrangères à ce qui est sa matière particulière. Le bois est la matière du charpentier ; l'airain est la matière du fondeur de statue ; l'art de vivre, à son tour, a pour matière dans chaque homme la vie de cet homme même. Que dire donc de la vie de ton frère ? Qu'elle relève de son savoir-faire à lui ; mais que, par rapport au tien, elle est au nombre des choses extérieures, ainsi que l'est un champ, ainsi que l'est la santé, ainsi que l'est la gloire. Or, sur toutes ces choses la philosophie ne s'engage à rien. « Dans toutes les circonstances, dit-elle, je maintiendrai la partie maîtresse en conformité avec la nature. « —Mais la partie maîtresse de qui ? — De l'être dans lequel je suis. — Comment donc faire pour que mon frère ne soit plus irrité contre moi ? — Amène-le-moi, et je lui parlerai ; mais je n'ai rien à te dire, à toi, au sujet de sa colère.
Celui qui le consultait ajouta : « Je te demande encore comment je pourrai me conformer à la nature, au cas où mon frère ne se réconcilierait pas avec moi. « Il lui répondit : « Aucune chose considérable ne se produit en un instant, pas plus que le raisin et les figues. Si tu me disais maintenant : je veux une figue, je te dirais : il faut du temps ; laisse l'arbre fleurir, puis les fruits y venir et mûrir. « Et, lorsque le fruit du figuier n'arrive pas à sa perfection d'un seul coup et en un instant, tu voudrais cueillir si facilement et si vite les fruits de la sagesse humaine ! Je te dirai : ne l'espère pas.
retire. Que dit-il en effet ? « Hommes, ne vous laissez point tromper, ne vous laissez pas détourner de la vérité, ne vous égarez pas : il n'existe pas chez les êtres raisonnables un mutuel instinct de sociabilité ; croyez-moi bien. Ceux qui vous disent le contraire vous trompent et vous abusent. « Eh ! que t'importe ! laisse les autres se tromper. T'en trouveras-tu plus mal, quand nous croirons tous que la société est naturelle entre nous, et qu'il faut la maintenir à tout prix ? Au contraire, tu t'en trouveras bien mieux et bien plus en sûreté. Homme, pourquoi t'inquiéter de nous ? Pourquoi veiller à cause de nous ? Pourquoi allumer ta lampe ? Pourquoi te lever si matin ? Pourquoi écrire de si gros livres, afin qu'aucun de nous ne se trompe en pensant que les dieux s'occupent des hommes, ou ne croie qu'il y a d'autre bien réel que le plaisir ? Car, si les choses sont comme tu le dis, va-t'en dormir, mène la vie d'un ver, celle que tu te crois fait pour vivre, mange, bois, fais l'amour, va à la selle et ronfle. Que t'importe ce que les autres croiront sur les points dont tu parles ? Que t'importe qu'ils se trompent ou non ? Qu'as-tu à faire de nous ? Occupe-toi des brebis, parce qu'elles se laissent tondre, traire, et enfin égorger. Ne serait-il pas à désirer pour toi que les hommes pussent être séduits et ensorcelés par les stoïciens au point de s'endormir, et de se laisser tondre et traire par toi et par tes semblables ? Qu'as-tu besoin de dire à tes disciples ce que tu leur dis, au lieu de le leur cacher ? Ne devrais-tu pas bien plutôt leur persuader avant tout que nous sommes nés pour la société, et qu'il est bon d'être modéré, pour qu'on te gardât tout ? Ou bien serait-ce qu'il y a des gens avec lesquels il faut maintenir la société, et d'autres avec lesquels il ne le faut pas ? Quels sont donc ceux avec lesquels il faut la maintenir ? Ceux qui tendent à la maintenir de leur côté ou ceux qui lui font violence ? Et qu'est-ce qui lui fait plus violence que vous, avec de pareilles doctrines ?
Qu'était-ce donc qui arrachait Épicure au sommeil et le forçait à écrire ce qu'il écrivait ? Qu'était-ce, si ce n'est ce qu'il y a de plus fort dans l'homme, la nature, qui le tirait du côté où elle voulait, malgré sa résistance et ses soupirs ? « nomme ne te paraît pas fait pour la société ! Eh bien ! écris-le, et transmets-le aux autres ; veille à cet effet, et donne toi-même par tes actes un démenti à tes théories !... « Et, après cela, nous dirons qu'Oreste était poursuivi par des Furies qui l'arrachaient à son sommeil, et nous ne dirons pas que des Furies et des divinités vengeresses, autrement terribles, réveillaient Épicure, quand il dormait, ne lui permettaient pas de reposer et le forçaient à révéler lui-même ses misères, comme la colère et l'ivresse font pour les Gaulois ! Voilà la force invincible de la nature humaine. Est-ce que la vigne peut croître selon les lois, non de la vigne, mais de l'olivier ? Et l'olivier, suivant les lois, non de l'olivier, mais de la vigne ? Cela ne peut ni se faire ni se concevoir. De même l'homme non plus ne peut jamais cesser de vivre de la vie de l'homme ; ceux mêmes auxquels on enlève leur virilité, on ne peut leur enlever les désirs virils. De cette façon, Épicure a pu nous enlever tout ce qui est viril en nous, tout ce qui est du maître de maison, du citoyen et de l'ami, mais il ne nous a pas enlevé les penchants de l'humanité, parce qu'il ne le pouvait pas ; pas plus que les malheureux académiciens ne peuvent se débarrasser de leurs sens ou les rendre impuissants, quoiqu'ils en aient la meilleure envie du monde.
Quelle misère ! Voici un homme qui a reçu de la nature des mesures et des règles pour juger de la vérité, et il ne travaille pas à les compléter et à les enrichir de ce qui leur manque ! Bien loin de là, s'il y a quelque autre chose encore qui puisse aider à découvrir la vérité, il s'efforce de le supprimer et de le détruire ! « Dis-nous, philosophe, que te semble-t-il de la piété et de la sainteté ? — Si tu le veux, je t'établirai qu'elles sont un bien.
— Oui ; établis-le-moi, pour que nos concitoyens se réforment, honorent la divinité et cessent de négliger leurs intérêts les plus sérieux. — Tiens-tu bien ces preuves ? — Je les tiens ; et je t'en remercie. — Eh bien ! puisque ce système te plaît tant, écoute les preuves du contraire, les preuves qu'il n'y a pas de dieux, ou que, s'il y en a, ils ne s'occupent pas des hommes, et qu'il n'y a rien de commun entre eux et nous ; les preuves que ce que le vulgaire appelle piété et sainteté ne sont que des mensonges de charlatans et de faux sages, ou, par Jupiter ! de législateurs, pour effrayer et contenir les méchants. — Bravo, philosophe ! tu as rendu service à nos concitoyens, et tu as fait la conquête de nos jeunes gens, enclins déjà à mépriser les dieux ! — Quoi donc ! cela ne te plaît pas ! Écoute alors comment la justice n'est rien, comment la retenue est une sottise, comment le nom de père n'est rien, comment le nom de fils n'est rien. —Bravo, philosophe ! continue, et persuade nos jeunes gens, pour que nous ayons un plus grand nombre d'individus qui pensent et parlent comme toi ! Est-ce avec ces beaux discours-là qu'ont grandi les États qui ont eu de bonnes lois ? Sont-ce ces beaux discours-là qui ont fait Lacédémone ? Les convictions que Lycurgue a inculquées aux Spartiates, par ses lois et par son éducation, sont-elles celles-ci, que la servitude n'est pas plus une honte qu'un honneur, et la liberté pas plus un honneur qu'une honte ? Est-ce pour ces maximes que moururent ceux qui sont morts aux Thermopyles ? Est-ce avec des raisonnements de ce genre que les Athéniens abandonnèrent leur ville ? « Et ceux qui parlent ainsi se marient, ont des enfants, prennent part au gouvernement et s'établissent prêtres et prophètes ! De qui ? De ceux qui n'existent pas ? Et ils interrogent eux-mêmes la Pythie, pour entendre d'elle des mensonges, qu'ils rapportent aux autres en guise d'oracles ! Quel excès d'impudence et de charlatanisme !
Homme, que fais-tu ? Tu te réfutes toi-même tous les jours ? Ne te décideras-tu pas à laisser là ces insipides raisonnements ? Quand tu manges, où portes-tu la main ? À ta bouche ou à tes yeux ? Quand tu te baignes, où entres-tu ? As-tu jamais appelé la marmite une écuelle ou la cuiller une broche ? Si j'étais l'esclave d'un de ces individus, dût-il me faire tous les jours fouetter jusqu'au sang, je le mettrais au supplice. « Enfant, dirait-il, verse de l'huile dans le bain. « J'y verserais de la saumure, et je m'en irais en la lui répandant sur la tête. « Qu'est-ce que cela ? — Par ton Génie ! il y avait là pour moi une apparence impossible à distinguer d'avec celle de l'huile, tant elle lui ressemblait. — Donne ici la tisane. « Je lui apporterais un plat plein de saumure vinaigrée. « Ne t'ai-je pas demandé la tisane ? — Oui, maître ; et c'est là la tisane.
Ô les hommes reconnaissants et pleins de conscience, qui, à tout le moins, mangent chaque jour du pain, et qui osent dire : « Nous ne savons s'il y a une Cérès, une Proserpine, un Pluton ! « Je ne veux pas ajouter : « Ils jouissent du jour et de la nuit, du changement des saisons, des astres, de la mer, de la terre, de l'assistance des hommes ; et rien de tout cela ne les touche le moins du monde ! Ils ne songent qu'à expectorer leurs petites questions, et à s'en aller au bain, quand leur estomac a fait son office ! « Quant à ce qu'ils diront, au sujet qu'ils traiteront, aux personnes à qui ils parleront, et à ce qui résultera pour elles de pareils discours, ils ne s'en
occupent si peu que ce soit. Peu leur importe que ces discours produisent de l'effet sur un jeune homme de noble race, qui les entend, et que cet effet détruise en lui tous les nobles germes de sa race ! Peu leur importe de donner à un adultère des motifs de ne pas rougir de ce qu'il fait ! Peu leur importe qu'un voleur des deniers publics puise des excuses dans ces discours, et que quelqu'un qui néglige ses parents y trouve un encouragement ! « Eh ! qu'y a-t-il donc, leur dirai-je, de bon ou de mauvais, d'honorable ou de honteux, suivant vous ? Est-ce ceci ou cela ? «
Pourquoi donc disputer jamais contre un de ces hommes-là ? Pourquoi lui donner des explications ou en recevoir de lui ? Pourquoi essayer de le convertir ? Par Jupiter, vous pourriez bien plutôt essayer de convertir un débauché, que des gens qui sont si sourds et si aveugles à l'endroit de leurs maux.
13. « La mort n'est rien pour nous «
Épicure, Lettre à Ménécée, trad. Pierre-Marie Morel, GF-Flammarion, 2009, p. 45-46.
Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation ; or la mort est privation de sensation. Par suite, la sûre connaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il
pour ne rien dire, celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour ; car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné, précisément, que quand nous sommes, la mort n'est pas présente ; et que, quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants ni pour ceux qui sont morts, étant donné, précisément, qu'elle n'est rien pour les premiers et que les seconds ne sont plus.
Mais la plupart des hommes, tantôt fuient la mort comme si elle était le plus grand des maux, tantôt la choisissent comme une manière de se délivrer des maux de la vie. Le sage, pour sa part, ne rejette pas la vie et il ne craint pas non plus de ne pas vivre, car vivre ne l'accable pas et il ne juge pas non plus que ne pas vivre soit un mal.
14. L'enfer n'est qu'une allégorie
Lucrèce, De la nature, III, 978-1010, trad. José Kany-Turpin, GF-Flammarion, 1997, p. 235-237.
Tous les supplices qu'en l'abîme infernal
place la tradition, en notre vie résident.
Point de malheureux, un roc en suspens sur sa tête,
Tantale dit la légende, glacé d'un vain effroi.
Ce sont plutôt les peurs des mortels en leur vie :
vaine crainte des dieux et du sort qui les guette.
[...]
Sisyphe existe aussi dans la vie, sous nos yeux :
à demander au peuple faisceaux, haches cruelles,
il s'acharne et toujours s'en revient morne et vaincu.
Oui, demander un vain pouvoir qui n'est jamais donné
et supporter pour lui dure et constante fatigue,
c'est pousser à grand-peine en haut d'une montagne
un rocher qui pourtant du sommet toujours roule
et regagne aussitôt l'étendue de la plaine.
Et puis toujours repaître une âme ingrate de nature,
la remplir de bonnes choses sans jamais la satisfaire,
à l'instar des saisons dont le retour nous apporte
fruits et charmes divers sans que jamais pourtant
nous soyons comblés par les jouissances de la vie,
voilà, je crois, la fable des jeunes filles en fleur
occupées à verser de l'eau dans un vase percé
qu'aucun effort pourtant ne saurait remplir.
15. Eceuvre d'Épicure
Lucrèce, De la nature, III, 1-13, ibid., p. 181.
Toi qui fis jaillir la lumière du fond des ténèbres,
éclairant le premier les biens de l'existence,
toi l'honneur de la Grèce, aujourd'hui je te suis
et j'imprime mes pas dans les traces des tiens.
Non que je désire rivaliser avec toi,
c'est par amour plutôt que je veux t'imiter.
Comment l'hirondelle pourrait défier les cygnes,
et que vaudrait jamais contre un fougueux cheval
la course d'un cabri sur ses pattes tremblantes ?
Ô père, ô découvreur de l'univers, tu nous prodigues
tes préceptes paternels et dans tes livres, ô prince,
pareils à des abeilles dans les vallons en fleurs,
nous butinons tes paroles d'or, toutes d'or,
et toujours les plus dignes de la vie éternelle.
«
72 j ÉPICURIENS ET STOÏCIENS
L'une, en effet, s'enchaîne à l'autre, à cause du mouvement
ordonné,
du soufRe commun et de l'unité de la substance.
Accommode-toi aux choses que t'assigna le sort ; et
les
hommes, que le destin te donna pour compagnons, aime
les, mais
du fond du cœur.
Un instrument, un outil, un ustensile quelconque, s'il
se prête à l'usage pour lequel il a été fabriqué, est de bon
emploi et cela bien que le fabricateur soit alors absent.
Mais, s'il s'agit de choses qu'assembla la nature, la force
qui
les a fabriquées est en eux et y demeure.
Voilà pour
quoi il faut l'en révérer davantage et penser que,
si tu te
conduis et
si tu te diriges selon son bon vouloir, tout en
toi sera selon l'intelligence.
Il en est de même
pour le
Tout, tout ce qu'il fait est conforme à l'intelligence.
2.
Le déterminisme
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, IY, XLIII-XLVI,
ibid, p.
67-68.
Le temps est comme un fleuve et un courant violent
formé de toutes choses.
Aussitôt, en effet, qu'une chose
est en vue, elle est entraînée ; une autre est-elle apportée,
celle-là aussi va être emportée.
Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la
rose au printemps et
les fruits en été ; il en est ainsi de
la maladie, de la mort, de la calomnie, des embûches et
de
tout ce qui réjouit ou affiige les sots.
Tout ce qui vient à la suite est toujours de la famille de
ce qui vient avant ; car, en effet,
il n'en est pas ici comme
d'une série de nombres ayant séparément et respective
ment leur contenu nécessaire, mais c'est une continuité
logique.
Et, de même que sont coharmonieusement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
- Freud Extraits - Anthologie
- Lao-tseu, Daodejing (extraits) - anthologie religieuse.
- Lao-tseu, Daodejing (extraits) - anthologie.
- Confucius, Entretiens (extraits) - anthologie.