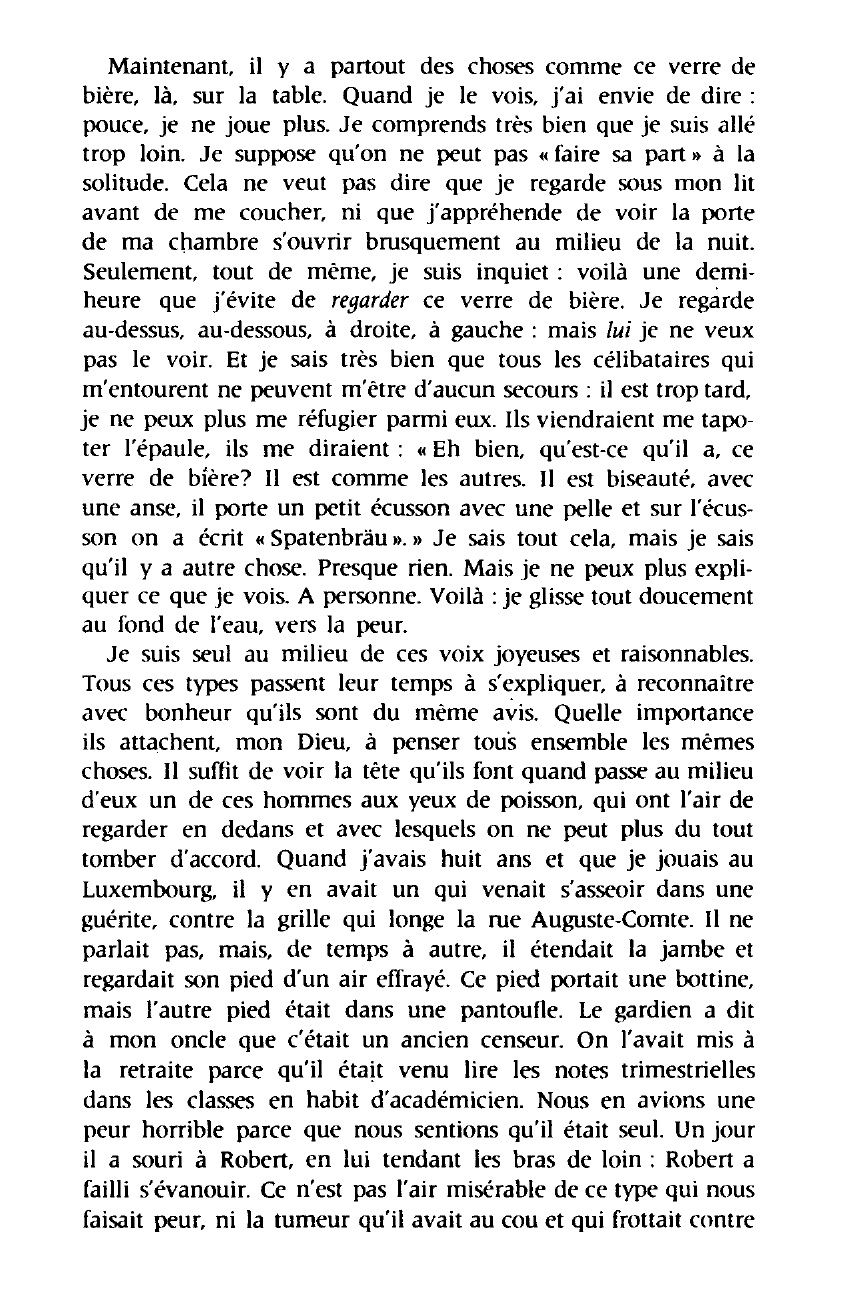Faire sa part à la solitude?
Publié le 20/06/2012

Extrait du document
La Nausée parait en 1938; ce premier roman de J.-P. Sartre
répond à un dessein qui restera celui de l'auteur dans ses romans
ultérieurs : « exprimer sous une forme littéraire des vérités et des
sentiments métaphysiques
Cette forme est, dans La Nausée,
celle du journal d'Antoine Roquentin, « un garçon sans importance
collective, tout juste un individu «, selon la formule de Céline placée
en exergue. Individu bien singulier en tant que personnage romanesque,
Roquentin se vide peu à peu de ce qui, traditionnellement,
caractérise le moi des journaux intimes. Bien qu'il ait peur de la
solitude, il n'en souffre pas à proprement parler; bien qu'il se
sente souvent exclu, il n'est pas seul parce qu'une femme, des amis,
ou Dieu l'ont abandonné, mais parce que la solitude est une dimension
de l'existence. Le moi de Roquentin ne se révèle qu'à travers
des expériences réflexives de la vacuité : « Tout ce qui reste de
rèel en moi, c'est de l'existence qui se sent exister. Et soudain
le Je pâlit, pâlit, et c' en est fait, il s'éteint.
«
FAIRE SA PART À LA SOLITUDE? RI
Maintenant, il y a partout des choses comme ce verre de
bière,
là, sur la table.
Quand je le vois, j'ai envie de dire:
pouce, je ne joue plus.
Je comprends très bien que je suis allé
trop loin.
Je suppose qu'on ne peut pas «faire sa part» à la
solitude.
Cela ne veut pas dire que je regarde sous
mon lit
avant de me coucher, ni que j'appréhende de voir la porte
de ma chambre s'ouvrir brusquement au milieu de la nuit.
Seulement, tout de mème, je suis inquiet : voilà une demi
heure que
j'évite de regarder ce verre de bière.
Je regarde
au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche : mais lui je ne veux
pas le voir.
Et je sais très bien que tous les célibataires qui
m'entourent ne peuvent m'être d'aucun secours:
il est trop tard,
je ne peux plus me réfugier parmi eux.
Ils viendraient me tapo
ter l'épaule, ils me diraient :
«Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce
verre de bîère?
Il est comme les autres.
Il est biseauté, avec
une anse,
il porte un petit écusson avec une pelle et sur l'écus
son
on a écrit « Spatenbrau ».
» Je sais tout cela, mais je sais
qu'il y a autre chose.
Presque rien.
Mais je ne peux plus expli
quer ce que je vois.
A personne.
Voilà
:je glisse tout doucement
au fond de
l'eau, vers la peur.
Je suis seul au milieu de ces voix joyeuses et raisonnables.
Tous ces types passent leur temps à s'expliquer, à reconnaître
avec bonheur qu'ils sont
du même avis.
Quelle importance
ils attachent,
mon Dieu, à penser tous ensemble les mêmes
choses.
Il suffit de voir la tête qu'ils font quand passe au milieu
d'eux
un de ces hommes aux yeux de poisson, qui ont l'air de
regarder en dedans et avec lesquels
on ne peut plus du tout
tomber d'accord.
Quand
j'avais huit ans et que je jouais au
Luxembourg,
il y en avait un qui venait s'asseoir dans une
guérite, contre la grille qui longe la rue Auguste-Comte.
Il ne
parlait
pas, mais, de temps à autre, il étendait la jambe et
regardait son pied
d'un air effrayé.
Ce pied portait une bottine,
mais l'autre pied était dans une pantoufle.
Le gardien a dit
à
mon oncle que c'était un ancien censeur.
On J'avait mis à
la retraite parce qu'il était venu lire les notes trimestrielles
dans les classes en habit d'académicien.
Nous
en avions une
peur horrible parce que nous sentions qu'il était seul.
Un jour
il a souri à Robert, en lui tendant les bras de loin : Robert a
failli s'évanouir.
Ce n'est pas l'air misérable de ce type qui nous
faisait peur, ni la tumeur qu'il avait au cou et qui frottait contre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition: FAIRE-PART, substantif masculin invariable.
- BARBES, Armand (1809-26 juin 1870) Révolutionnaire A peine arrivé à Paris pour y faire son droit, Barbès prend part à la vie de l'opposition républicaine à la monarchie de Juillet, qui vient de se mettre en place.
- Quelle part peut-on faire à l'enthousiasme dans le développement de la moralité ?
- La part qu'elle a à mon histoire est trop interressante, pour négliger de vous en faire le portrait. ? Charles de Fieux, chevalier de Mouhy, la Paysanne parvenue, ou les Mémoires de Madame la marquise de L. V.
- Madame Jean Dubois, son épouse, Monsieur Marc Dubois, son fils, Les familles Beaumont, Courtier, Robin ont l'immense douleur de vous faire part du décès de Monsieur Jean Dubois, Chevalier de la Légion d'honneur, survenu à Paris, le 24 juin 1996, dans sa 75e année.