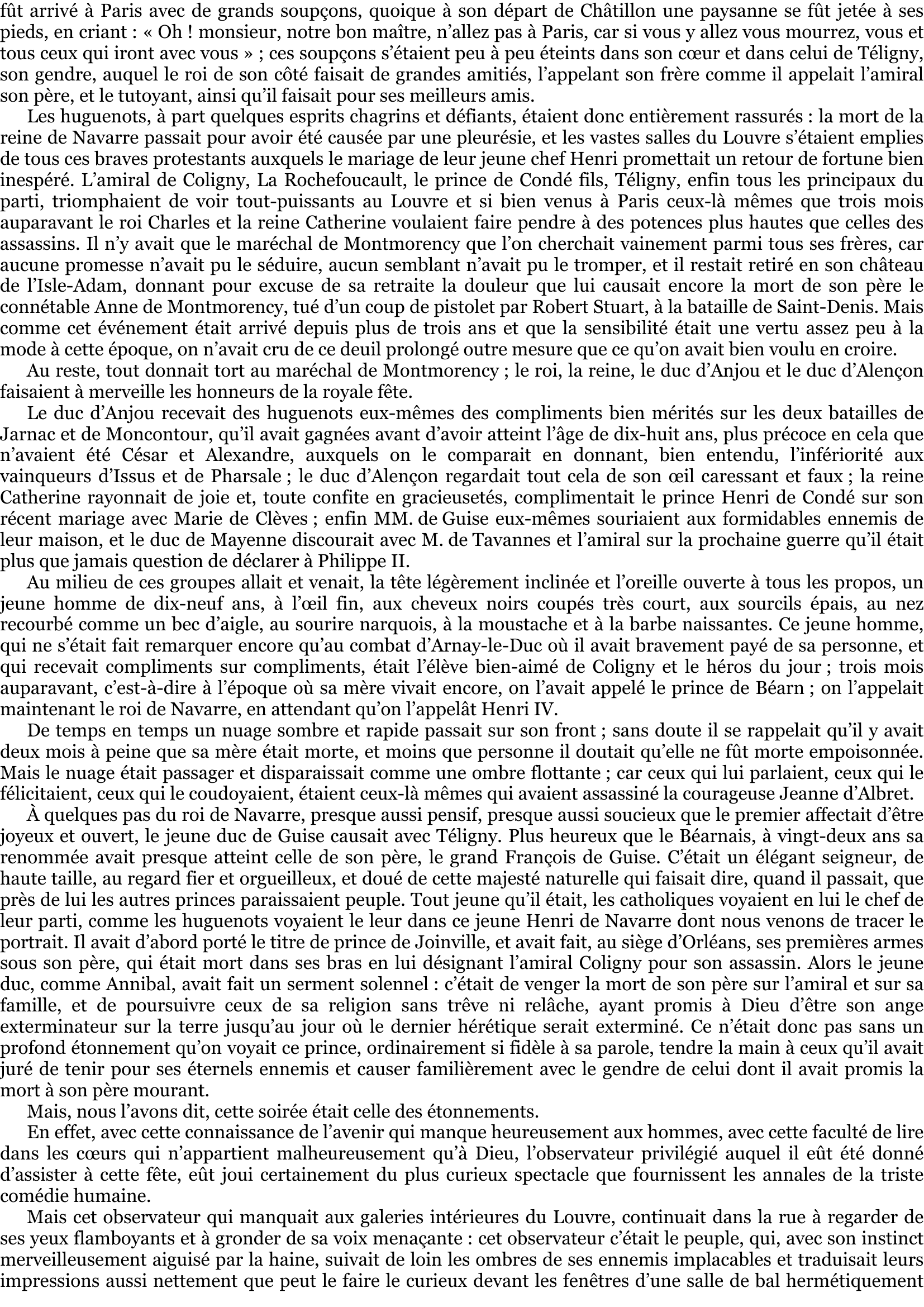I - Le latin de M.
Publié le 04/11/2013

Extrait du document
«
fût
arrivé àParis avecdegrands soupçons, quoiqueàson départ deChâtillon unepaysanne sefût jetée àses
pieds, encriant : « Oh !monsieur, notrebonmaître, n’allezpasàParis, carsivous yallez vous mourrez, vouset
tous ceux quiiront avecvous » ; cessoupçons s’étaientpeuàpeu éteints danssoncœur etdans celuideTéligny,
son gendre, auquelleroi deson côté faisait degrandes amitiés,l’appelant sonfrère comme ilappelait l’amiral
son père, etletutoyant, ainsiqu’ilfaisait poursesmeilleurs amis.
Les huguenots, àpart quelques espritschagrins etdéfiants, étaientdoncentièrement rassurés :lamort dela
reine deNavarre passaitpouravoir étécausée parune pleurésie, etles vastes sallesduLouvre s’étaient emplies
de tous cesbraves protestants auxquelslemariage deleur jeune chefHenri promettait unretour defortune bien
inespéré.
L’amiraldeColigny, LaRochefoucault, leprince deCondé fils,Téligny, enfintouslesprincipaux du
parti, triomphaient devoir tout-puissants auLouvre etsibien venus àParis ceux-là mêmesquetrois mois
auparavant leroi Charles etlareine Catherine voulaientfairependre àdes potences plushautes quecelles des
assassins.
Iln’y avait quelemaréchal deMontmorency quel’on cherchait vainement parmitoussesfrères, car
aucune promesse n’avaitpuleséduire, aucunsemblant n’avaitpuletromper, etilrestait retiréenson château
de l’Isle-Adam, donnantpourexcuse desaretraite ladouleur queluicausait encorelamort deson père le
connétable AnnedeMontmorency, tuéd’un coup depistolet parRobert Stuart,àla bataille deSaint-Denis.
Mais
comme cetévénement étaitarrivé depuis plusdetrois ansetque lasensibilité étaitunevertu assezpeuàla
mode àcette époque, onn’avait crudecedeuil prolongé outremesure quecequ’on avaitbienvoulu encroire.
Au reste, toutdonnait tortaumaréchal deMontmorency ; leroi, lareine, leduc d’Anjou etleduc d’Alençon
faisaient àmerveille leshonneurs delaroyale fête.
Le duc d’Anjou recevait deshuguenots eux-mêmes descompliments bienmérités surlesdeux batailles de
Jarnac etde Moncontour, qu’ilavait gagnées avantd’avoir atteintl’âgededix-huit ans,plus précoce encela que
n’avaient étéCésar etAlexandre, auxquelsonlecomparait endonnant, bienentendu, l’infériorité aux
vainqueurs d’Issusetde Pharsale ; leduc d’Alençon regardaittoutceladeson œilcaressant etfaux ; lareine
Catherine rayonnaitdejoie et,toute confite engracieusetés, complimentait leprince HenrideCondé surson
récent mariage avecMarie deClèves ; enfinMM. de Guise eux-mêmessouriaientauxformidables ennemisde
leur maison, etleduc deMayenne discourait avecM. de Tavannes etl’amiral surlaprochaine guerrequ’ilétait
plus quejamais question dedéclarer àPhilippe II.
Au milieu deces groupes allaitetvenait, latête légèrement inclinéeetl’oreille ouverte àtous lespropos, un
jeune homme dedix-neuf ans,àl’œil fin,aux cheveux noirscoupés trèscourt, auxsourcils épais,aunez
recourbé commeunbec d’aigle, ausourire narquois, àla moustache etàla barbe naissantes.
Cejeune homme,
qui nes’était faitremarquer encorequ’aucombat d’Arnay-le-Duc oùilavait bravement payédesapersonne, et
qui recevait compliments surcompliments, étaitl’élève bien-aimé deColigny etlehéros dujour ; troismois
auparavant, c’est-à-direàl’époque oùsamère vivait encore, onl’avait appelé leprince deBéarn ; onl’appelait
maintenant leroi deNavarre, enattendant qu’onl’appelât HenriIV.
De temps entemps unnuage sombre etrapide passait surson front ; sansdoute ilse rappelait qu’ilyavait
deux mois àpeine quesamère étaitmorte, etmoins quepersonne ildoutait qu’ellenefût morte empoisonnée.
Mais lenuage étaitpassager etdisparaissait commeuneombre flottante ; carceux quiluiparlaient, ceuxquile
félicitaient, ceuxquilecoudoyaient, étaientceux-là mêmesquiavaient assassiné lacourageuse Jeanned’Albret.
À quelques pasduroi deNavarre, presqueaussipensif, presque aussisoucieux quelepremier affectait d’être
joyeux etouvert, lejeune ducdeGuise causait avecTéligny.
Plusheureux queleBéarnais, àvingt-deux anssa
renommée avaitpresque atteintcelledeson père, legrand François deGuise.
C’était unélégant seigneur, de
haute taille,auregard fieretorgueilleux, etdoué decette majesté naturelle quifaisait dire,quand ilpassait, que
près delui les autres princes paraissaient peuple.Toutjeune qu’ilétait, lescatholiques voyaientenlui lechef de
leur parti, comme leshuguenots voyaientleleur dans cejeune Henri deNavarre dontnous venons detracer le
portrait.
Ilavait d’abord portéletitre deprince deJoinville, etavait fait,ausiège d’Orléans, sespremières armes
sous sonpère, quiétait mort danssesbras enlui désignant l’amiralColignypoursonassassin.
Alorslejeune
duc, comme Annibal, avaitfaitunserment solennel : c’étaitdevenger lamort deson père surl’amiral etsur sa
famille, etde poursuivre ceuxdesareligion sanstrêve nirelâche, ayantpromis àDieu d’être sonange
exterminateur surlaterre jusqu’au jouroùledernier hérétique seraitexterminé.
Cen’était doncpassans un
profond étonnement qu’onvoyait ceprince, ordinairement sifidèle àsa parole, tendrelamain àceux qu’ilavait
juré detenir pourseséternels ennemis etcauser familièrement aveclegendre decelui dontilavait promis la
mort àson père mourant.
Mais, nousl’avons dit,cette soirée étaitcelle desétonnements.
En effet, aveccette connaissance del’avenir quimanque heureusement auxhommes, aveccette faculté delire
dans lescœurs quin’appartient malheureusement qu’àDieu, l’observateur privilégiéauquelileût étédonné
d’assister àcette fête,eûtjoui certainement duplus curieux spectacle quefournissent lesannales delatriste
comédie humaine.
Mais cetobservateur quimanquait auxgaleries intérieures duLouvre, continuait danslarue àregarder de
ses yeux flamboyants etàgronder desavoix menaçante : cetobservateur c’étaitlepeuple, qui,avec soninstinct
merveilleusement aiguiséparlahaine, suivait deloin lesombres deses ennemis implacables ettraduisait leurs
impressions aussinettement quepeut lefaire lecurieux devantlesfenêtres d’unesalledebal hermétiquement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours Latin : Séquence 1: « Mare nostrum ? », Séquence II « Sacra peregrina »
- Diptyque de latin : les héros - Tite Live Ab Urbe condita liber XXI, IV
- Accents latin
- latin Anaximandre
- Traduction Cursive Latin