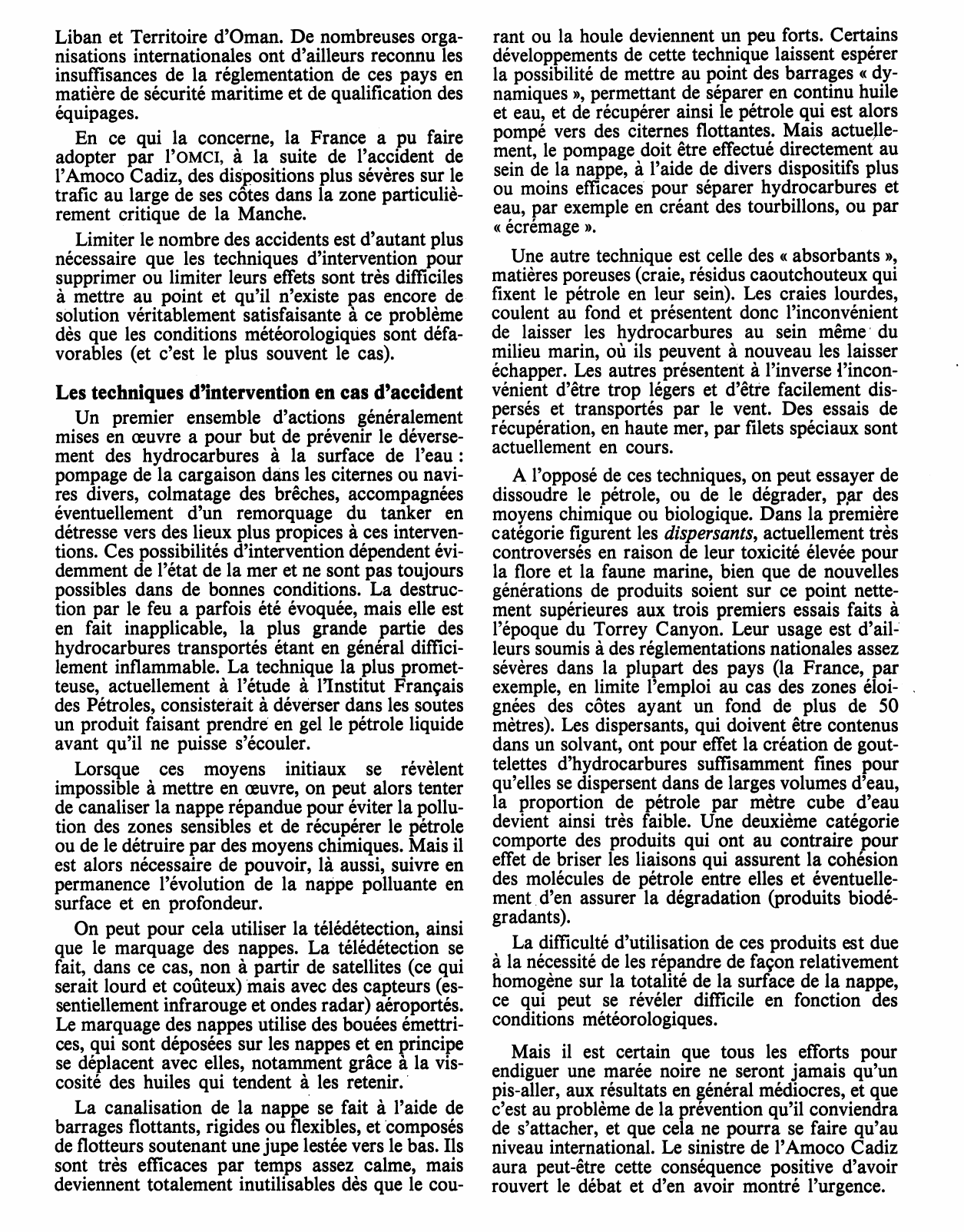La pollution des océans
Publié le 23/12/2011

Extrait du document
«
Liban et Territoire d'Oman.
De nombreuses orga
nisations internationales ont d'ailleurs reconnu les
insuffisances de la réglementation
de ces pays en
matière de sécurité maritime et de qualification des équipages.
En ce qui la concerne, la France a pu faire
adopter par
l'OMCI, à la suite de l'accident de
l' Amoco Cadiz, des dispositions plus sévères sur le trafic au large de ses côtes dans la zone particuliè
rement critique de la Manche.
Limiter
le nombre des accidents est d'autant plus
nécessaire que les techniques d'intervention pour
supprimer ou limiter leurs effets sont très difficiles
à mettre au point et qu'il n'existe pas encore de
solution véritablement satisfaisante à
ce problème dès que les conditions météorologiques sont défa
vorables (et c'est le plus souvent le cas).
Les techniques d'intervention en cas d'accident
Un premier ensemble d'actions généralement
mises en œuvre a pour but de prévenir le déverse
ment des hydrocarbures à la surface de l'eau :
pompage de la cargaison dans
les citernes ou navi res divers, colmatage des brêches, accompagnées
éventuellement d'un remorquage du tanker en détresse vers des lieux plus propices à ces interven
tions.
Ces possibilités d'intervention dépendent évi demment de l'état de la mer et ne sont pas toujours
possibles dans de bonnes conditions.
La destruc
tion par
le feu a parfois été évoquée, mais elle est en fait inapplicable, la plus grande partie des
hydrocarbures transportés étant en général diffici
lement inflammable.
La technique la plus promet
teuse, actuellement à l'étude à l'Institut Français
des Pétroles, consisterait à déverser dans les soutes un produit faisant prendre en gel le pétrole liquide
avant qu'il ne puisse s'écouler.
Lorsque ces moyens initiaux se révèlent
impossible à mettre en œuvre, on peut alors tenter
de canaliser la nappe répandue pour éviter la pollu
tion des zones sensibles et de récupérer le pétrole
ou de le détruire par des moyens chimiques.
Mais il est alors nécessaire de pouvoir, là aussi, suivre en
permanence l'évolution de la nappe polluante en
surface et
en profondeur.
On peut pour cela utiliser la télédétection, ainsi
que le marquage des nappes.
La télédétection se fait, dans ce cas, non à partir de satellites (ce qui
serait lourd et coûteux) mais avec des capteurs (es sentiellement infrarouge et ondes radar) aéroportés.
Le marquage des nappes utilise des bouées émettri
ces, qui sont déposées sur les nappes et en principe se déplacent avec elles, notamment grâce à la vis
cosité des huiles qui tendent à les retenir.
La canalisation
de la nappe se fait à l'aide de barrages flottants, rigides ou flexibles, et composés de flotteurs soutenant une jupe lestée vers le bas.
Ils
sont très efficaces par temps assez calme, mais
deviennent totalement inutilisables
dès que le cou-rant
ou la houle deviennent un peu forts.
Certains
développements
de cette technique laissent espérer
la possibilité de mettre au point des barrages « dy
namiques », permettant de séparer en continu huile
et eau, et de récupérer ainsi le pétrole qui est alors
pompé vers des citernes flottantes.
Mais actueJle
ment, le pompage doit être effectué directement au
sein de la nappe, à l'aide de divers dispositifs plus
ou moins efficaces pour séparer hydrocarbures et
eau, par exemple en créant des tourbillons, ou par
«écrémage>>.
Une autre technique est celle des « absorbants », matières poreuses (craie, résidus caoutchouteux qui
fixent le pétrole en leur sein).
Les craies lourdes,
coulent au fond et présentent donc l'inconvénient
de laisser les hydrocarbures au sein même · du
milieu marin, où ils peuvent à nouveau les laisser
échapper.
Les autres présentent à l'inverse l'incon
vénient d'être trop légers et d'être facilement dis
persés et transportés par
le vent.
Des essais de
récupération, en haute mer, par filets spéciaux sont
actuellement
en cours.
A l'opposé
de ces techniques, on peut essayer de
dissoudre le pétrole, ou de le dégrader, p,ar des
moyens chimique ou biologique.
Dans la première
catégorie figurent
les dispersants, actuellement très
controversés en raison de leur toxicité élevée pour
la flore et la faune marine, bien que de nouvelles
générations de produits soient sur ce point nette
ment supérieures aux trois premiers essais faits à
l'époque
du Torrey Canyon.
Leur usage est d'ail
leurs soumis à des réglementations nationales assez
sévères dans la plupart
des pays (la France, par
exemple, en limite l'emploi au cas des zones éloi gnées des côtes ayant un fond de plus de 50 mètres).
Les dispersants, qui doivent être contenus
dans un solvant, ont pour effet la création de gout
telettes d'hydrocarbures suffisamment fines pour
qu'elles
se dispersent dans de larges volumes d'eau,
la proportion de pétrole par mètre cube d'eau
devient ainsi très faible.
Une deuxième catégorie
comporte des produits qui ont au contraire pour
effet de briser les liaisons qui assurent la cohésion des molécules de pétrole entre elles et éventuelle
ment d'en assurer la dégradation (produits biodé
gradants).
La difficulté d'utilisation de ces produits est due
à la nécessité de les répandre de façon relativement
homogène sur la totalité de la surface de la nappe,
ce qui peut se révéler difficile en fonction des
conditions météorologiques.
Mais
il est certain que tous les efforts pour
endiguer une marée noire ne seront jamais qu'un
pis-aller, aux résultats en général médiocres, et que
c'est au problème
de la prévention qu'il conviendra de s'attacher, et que cela ne pourra se faire qu'au
niveau international.
Le sinistre de l' Amoco Cadiz
aura peut-être cette conséquence positive d'avoir
rouvert
le débat et d'en avoir montré l'urgence..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La pollution de l'environnement représente une cause essentielle de la crise écologique globale : atmosphère, sols, eaux continentales et océans sont de plus en plus contaminés par des rejets d'effluents gazeux ou liquides.
- La Pollution des océans et des mers
- La responsabilité des énergies fossiles dans la mortalité liée à la pollution.
- Océans et Mers, espace de conquête
- Dissertation HGGSP : Mers et Océans