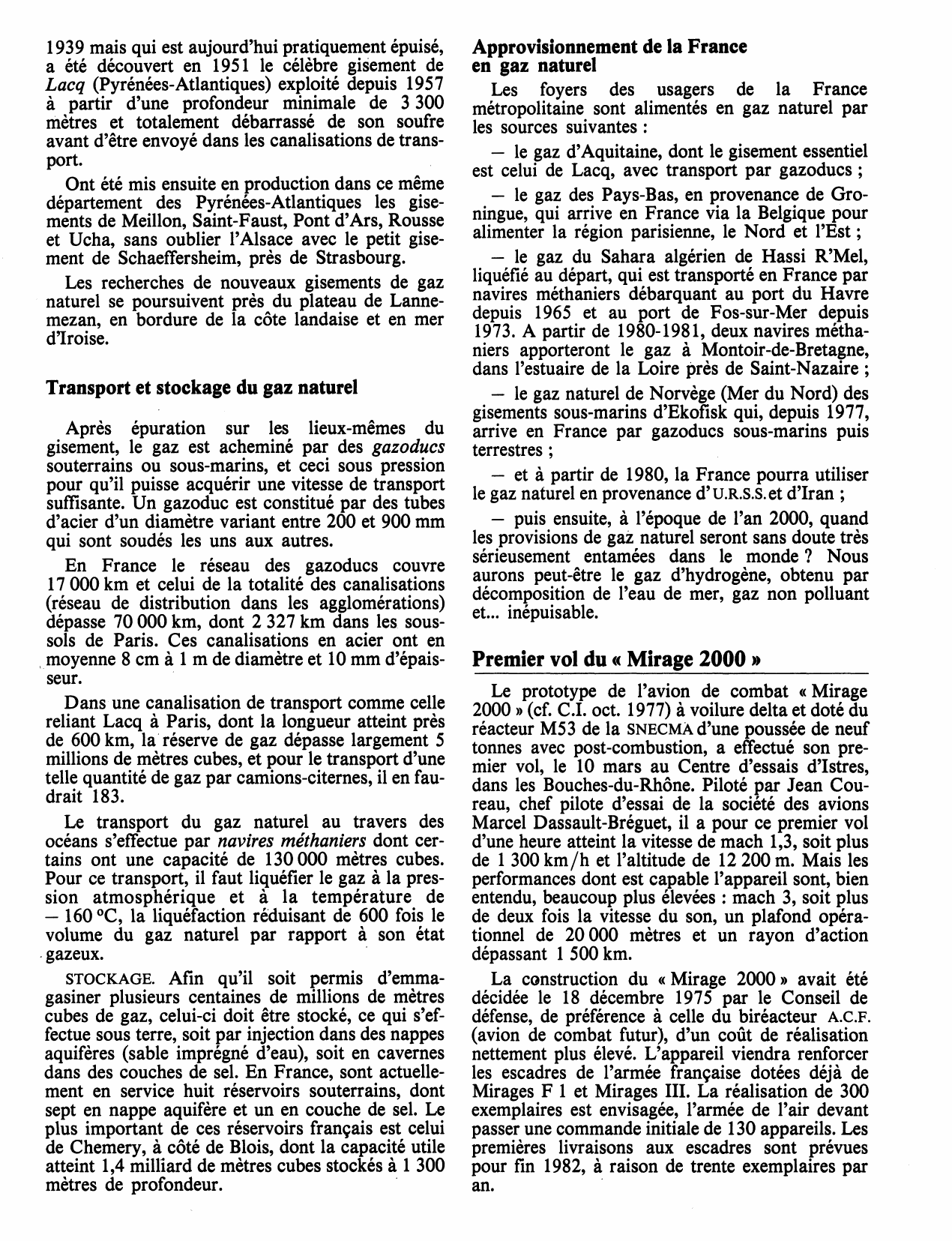Le matériel agricole en 1977 (histoire)
Publié le 23/12/2011

Extrait du document

Le syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles a fait connaître fin février les résultats des acquisitions dans l'année précédente de matériel agricole sur le marché français et ces résultats se sont révélés extrêmement décevants. Si le chiffre d'affaires de l'industrie française a atteint 7 920 millions de francs en 1976, soit une progression en valeur de 4, 7 pour cent, cela correspond malheureusement, en raison de la hausse des prix, à une baisse de 3, 7 pour cent. Sur le marché intérieur, les achats ont en 1977 baissé de plus de 7 pour cent par rapport à 1976, dont une baisse de 14,3 pour cent pour les tracteurs et 21 pour cent pour les moissonneuses-batteuses. Sur une douzaine de matériels, la production a diminué pour neuf d'entre eux. Petite consolation : une augmentation d'achat, d'une année sur l'autre de 4 pour cent pour les ramasseuses presses et 9 pour cent pour les motoculteurs et moto-houes.

«
1939 mais qui est aujourd'hui pratiquement épuisé,
a été découvert en 1951 le célèbre gisement de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) exploité depuis 1957
à partir d'une profondeur minimale de 3 300 mètres et totalement débarrassé de son soufre
avant d'être envoyé dans les canalisations de trans
port.
Ont été mis ensuite en production dans ce même
département des Pyrénées-Atlantiques les gise
ments de Meillon, Saint-Faust,
Pont d'Ars, Rousse
et Ucha, sans oublier l'Alsace avec le petit gise
ment de Schaeffersheim, près de Strasbourg.
Les recherches de nouveaux gisements de gaz
naturel se poursuivent près du plateau de Lanne
mezan, en bordure de la côte landaise et en mer
d'Iroise.
Transport et stockage du gaz naturel
Après épuration sur les lieux-mêmes du
gisement, le gaz est acheminé par des gazoducs souterrains ou sous-marins, et ceci sous pression
pour qu'il puisse acquérir une vitesse de transport
suffisante.
Un gazoduc est constitué par des tubes
d'acier d'un diamètre variant entre 200 et 900 mm
qui sont soudés les uns aux autres.
En France le réseau des gazoducs couvre
1 7
000 km et celui de la totalité des canalisations
(réseau de distribution dans les agglomérations)
dépasse
70 000 km, dont 2 327 km dans les sous
sols de Paris.
Ces canalisations en acier ont en
.
moyenne 8 cm à 1 rn de diamètre et 10 mm d'épais
seur.
Dans une canalisation de transport comme celle
reliant Lacq à Paris, dont la longueur atteint près
de 600 km, la réserve de gaz dépasse largement 5
millions de mètres cubes, et pour le transport d'une
telle quantité de gaz par camions-citernes, il en fau
drait 183.
Le transport du gaz naturel au travers des
océans s'effectue
par navires méthaniers dont cer
tains ont une capacité de 130 000 mètres cubes.
Pour ce transport, il faut liquéfier le gaz à la pres
sion atmosphérique et à la température de
- 160 °C, la liquéfaction réduisant de 600 fois le
volume du gaz naturel par rapport à son état .
gazeux.
STOCKAGE.
Afin qu'il soit permis d'emma
gasiner plusieurs centaines de millions de mètres
cubes de gaz, celui-ci doit être stocké, ce qui s'ef
fectue sous terre, soit par injection dans des nappes
aquifères (sable imprégné d'eau), soit en cavernes
dans des couches de sel.
En France, sont actuelle
ment en service huit réservoirs souterrains, dont
sept en nappe aquifère et un en couche de sel.
Le
plus important de ces réservoirs français est celui
de Chemery, à côté de Blois, dont la capacité utile
atteint 1,4 milliard de mètres cubes stockés à 1
300 mètres de profondeur.
Approvisionnement de la France en gaz naturel
Les foyers des usagers de la France
métropolitaine sont alimentés en gaz naturel par les sources suivantes :
-
le gaz d'Aquitaine, dont le gisement essentiel
est celui de Lacq, avec transport par gazoducs ;
-
le gaz des Pays-Bas, en provenance de Gro
ningue, qui arrive en France via la Belgique pour
alimenter la région parisienne,
le Nord et l'Est;
- le gaz du Sahara algérien de Hassi R'Mel,
liquéfié au départ, qui est transporté en France par
navires méthaniers débarquant au port du Havre
depuis 1965 et au port de Fos-sur-Mer depuis
1973.
A partir de 1980-1981, deux navires métha
niers apporteront
le gaz à Montoir-de-Bretagne,
dans l'estuaire de la Loire près de Saint-Nazaire;
-
le gaz naturel de Norvège (Mer du Nord) des
gisements sous-marins d'Ekofisk qui, depuis 1977,
arrive en France par gazoducs sous-marins puis
terrestres ;
- et à partir de
1980, la France pourra utiliser le gaz naturel en provenance d'U.R.S.S.
et d'Iran ;
- puis ensuite, à l'époque de l'an
2000, quand
les provisions de gaz naturel seront sans doute très
sérieusement entamées dans
le monde ? Nous
aurons peut-être le gaz d'hydrogène, obtenu par
décomposition de l'eau de mer, gaz non polluant
et...
inépuisable.
Premier vol du « Mirage 2000 »
Le prototype de l'avion de combat « Mirage 2000 ,, (cf.
C.l.
oct.
1977) à voilure delta et doté du
réacteur M53 de la SNECMAd'une poussée de neuf
tonnes avec post-combustion, a effectué son pre
mier vol,
le 10 mars au Centre d'essais d'Istres,
dans les Bouches-du-Rhône.
Piloté par Jean Cou
reau, chef pilote d'essai de la société des avions
Marcel Dassault-Bréguet, il a pour ce premier vol
d'une heure atteint
la vitesse de mach 1,3, soit plus de 1 300 km/h et l'altitude de 12 200 m.
Mais les
performances dont est capable l'appareil sont, bien
entendu, beaucoup plus élevées : mach
3, soit plus de deux fois la vitesse du son, un plafond opéra
tionnel de 20 000 mètres et un rayon d'action
dépassant 1 500 km .
La construction du « Mirage 2000 » avait été
décidée le 18 décembre 1975 par le Conseil de
défense, de préférence à celle du biréacteur A.C.F.
(avion de combat futur), d'un coût de réalisation
nettement plus élevé.
L'appareil viendra renforcer
les escadres de l'armée française dotées déjà de
Mirages F 1 et Mirages III.
La réalisation de 300 exemplaires est envisagée, l'armée de l'air devant
passer une commande initiale de 130 appareils.
Les
premières livraisons aux escadres sont prévues
pour fin 1982,
à raison de trente exemplaires par
an.
·.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- IDÉOLOGIE ET RATIONALITÉ DANS L’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE, 1977. Georges Canguilhem
- 1977 Août (Histoire chronologique)
- La catastrophe aérienne de Ténérife, 1977 (histoire)
- Afrique noire d'expression anglaise - Afrique centrale - Corne de l'Afrique de 1944 à 1977 (histoire)
- Structures africaines, Afrique du nord, Afrique noire d'expression française de 1944 à 1977 (histoire)