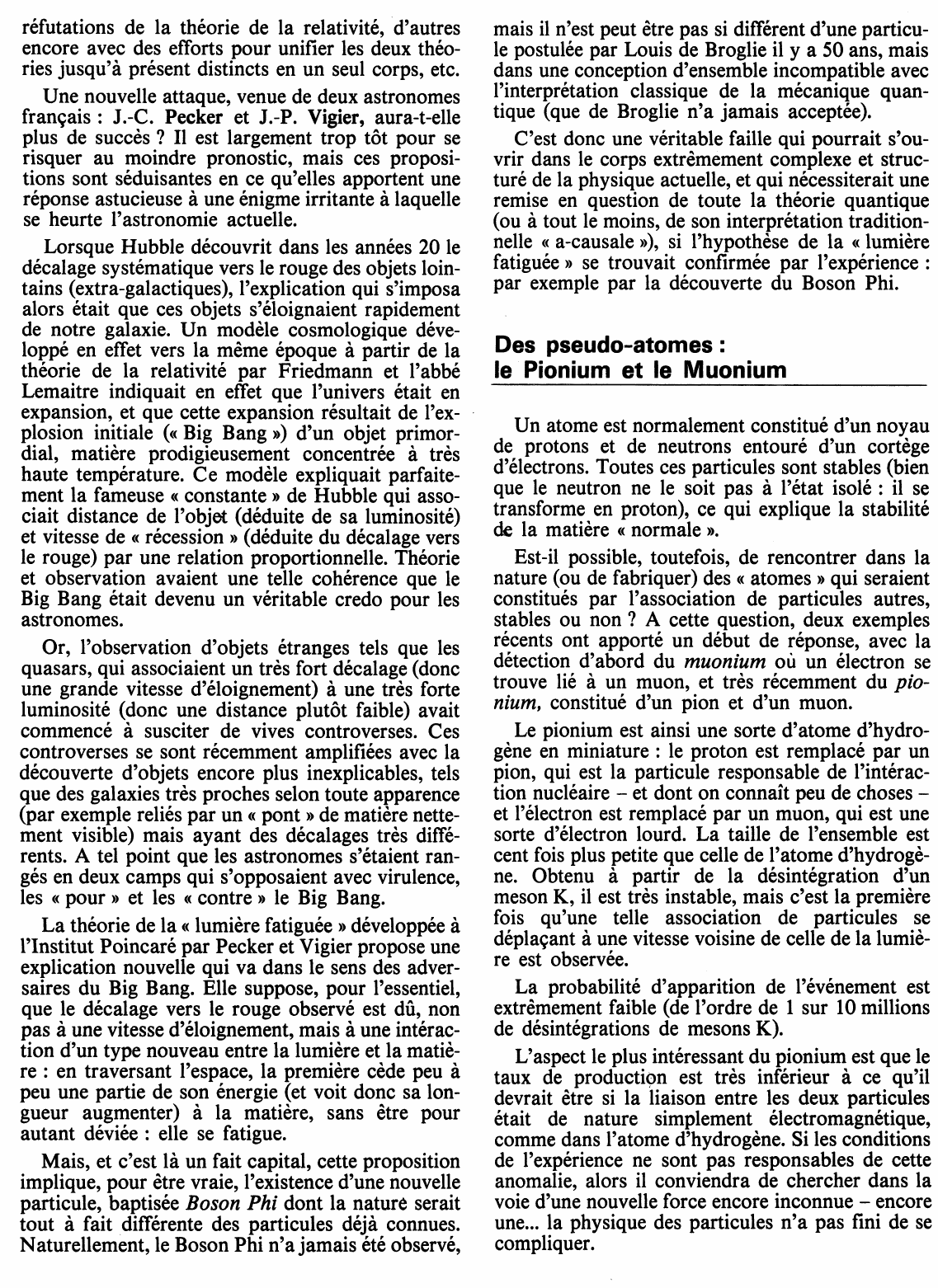Prix Nobel de physique et de chimie
Publié le 16/12/2011

Extrait du document
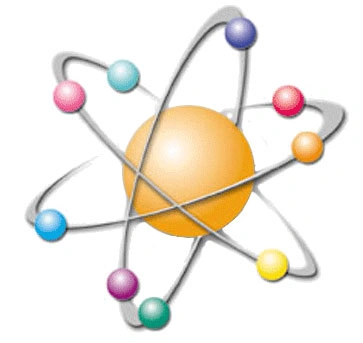
Les prix Nobel qui viennent d'ètre attribués en
Physique et en Chimie offrent un étonnant contraste
en ce qui concerne l'ancienneté des travaux qui
ont été récompensés : plus de 20 ans pour la Chimie,
deux ans à peine pour la Physique (un record
pour la prudente académie suédoise !).
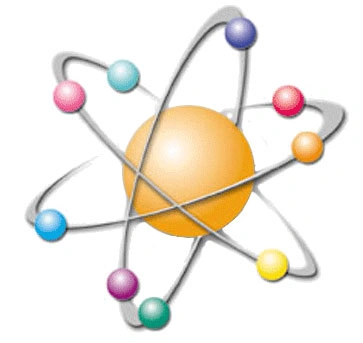
«
réfutations de la théorie de la relativité, d'autres
encore avec des efforts pour unifier les deux théo
ries jusqu'à présent distincts en un seul corps, etc.
Une nouvelle attaque, venue de deux astronomes
français : J.-C.
Pecker et J.-P.
Vigier, aura-t-elle
plus de succès ? Il est largement trop tôt pour se risquer au moindre pronostic, mais ces proposi
tions sont séduisantes en ce qu'elles apportent une réponse astucieuse à une énigme irritante à laquelle se heurte l'astronomie actuelle.
Lorsque Hubble découvrit dans
les années 20 le décalage systématique vers le rouge des objets loin
tains (extra-galactiques), l'explication qui s'imposa
alors était que ces objets s'éloignaient rapidement
de notre galaxie.
Un modèle cosmologique déve loppé en effet vers la mème époque à partir de la
théorie de la relativité par Friedmann et l'abbé
Lemaitre indiquait en effet que l'univers était en expansion, et que cette expansion résultait de l'ex
plosion initiale («Big Bang») d'un objet primor
dial, matière prodigieusement concentrée à très
haute température.
Ce modèle expliquait parfaite
ment la fameuse
« constante » de Hubble qui asso
ciait distance de l'objet (déduite de sa luminosité)
et vitesse
de« récession» (déduite du décalage vers le rouge) par une relation proportionnelle.
Théorie
et observation avaient une telle cohérence que le Big Bang était devenu un véritable credo pour les astronomes.
Or, l'observation d'objets étranges tels que les quasars, qui associaient un très fort décalage (donc
une grande vitesse d'éloignement) à une très forte
luminosité (donc une distance plutôt faible) avait
commencé à susciter de vives controverses.
Ces
controverses
se sont récemment amplifiées avec la
découverte d'objets encore plus inexplicables, tels
que des galaxies très proches selon toute apparence
(par exemple reliés par un
« pont » de matière nette
ment visible) mais ayant des décalages très diffé
rents.
A tel point que les astronomes s'étaient ran
gés en deux camps qui s'opposaient avec virulence,
les « pour » et les « contre » le Big Bang.
La théorie de la
« lumière fatiguée » développée à
l'Institut Poincaré par Pecker et Vigier propose une explication nouvelle qui va dans le sens des adver
saires du Big Bang.
Elle suppose, pour l'essentiel,
que le décalage vers le rouge observé est dû, non
pas à une vitesse d'éloignement, mais à une intérac
tion d'un type nouveau entre la lumière et la matiè
re : en traversant l'espace, la première cède peu à
peu une partie
de son énergie (et voit donc sa lon
gueur augmenter) à la matière, sans ètre pour
autant déviée : elle
se fatigue.
Mais, et c'est là un fait capital, cette proposition
implique, pour ètre vraie, l'existence d'une nouvelle
particule, baptisée
Boson Phi dont la nature serait
tout à fait différente des particules déjà connues.
Naturellement,
le Boson Phi n'a jamais été observé, mais
il n'est
peut ètre pas si différent d'une particu le postulée par Louis de Broglie il y a 50 ans, mais
dans une conception d'ensemble incompatible avec
l'interprétation classique de la mécanique quan
tique (que de Broglie n'a jamais acceptée).
C'est donc
une véritable faille qui pourrait s'ou
vrir dans le corps extrèmement complexe et struc
turé de la physique actuelle, et qui nécessiterait une
remise en question de toute la théorie quantique (ou à tout le moins, de son interprétation tradition
nelle «a-causale»), si l'hypothèse de la «lumière fatiguée» se trouvait confirmée par l'expérience :
par exemple par la découverte du Boson Phi.
Des pseudo-atomes :
le Pionium et le Muonium
Un atome est normalement constitué d'un noyau de protons et de neutrons entouré d'un cortège
d'électrons.
Toutes ces particules sont stables (bien
que
le neutron ne le soit pas à l'état isolé : il se transforme en proton), ce qui explique la stabilité de la matière « normale ».
Est-il possible, toutefois, de rencontrer dans la
nature (ou de fabriquer) des« atomes» qui seraient
constitués par l'association de particules autres,
stables ou non ? A cette question, deux exemples
récents ont apporté un début de réponse, avec la
détection d'abord du muonium où un électron se trouve lié à un muon, et très récemment du pio
nium, constitué d'un pion et d'un muon.
Le pionium est ainsi une sorte d'atome d'hydro gène en miniature : le proton est remplacé par un pion, qui est la particule responsable de l'intérac
tion nucléaire -et dont on connaît peu de choses -
et l'électron est remplacé par un muon, qui est une
sorte d'électron lourd.
La taille
de l'ensemble est
cent fois plus petite que celle de l'atome d'hydrogè ne.
Obtenu à partir de la désintégration d'un
meson K, il est très instable, mais c'est la première
fois qu'une telle association de particules se déplaçant à une vitesse voisine de celle de la lumiè re est observée.
La probabilité d'apparition de l'événement est
extrèmement faible (de l'ordre de 1 sur
10 millions de désintégrations de mesons K).
L'aspect le plus intéressant du pionium est que
le taux de producti9n est très inférieur à ce qu'il
devrait ètre si la liaison entre les deux particules
était de nature simplement électromagnétique,
comme dans l'atome d'hydrogène.
Si les conditions de l'expérience ne sont pas responsables de cette
anomalie, alors il conviendra de chercher dans la
voie d'une nouvelle force encore inconnue -encore
une
...
la physique des particules n'a pas fini de se compliquer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Joseph Thomson par George Paget Thomson Prix Nobel de Physique 1937 Né près de Manchester, en 1856, J.
- Max Planck par Max Von Laüe Prix Nobel de Physique 1914 Né le 23 avril 1858, à Kiel, Max Planck était le sixième enfant d'une famille de juristes.
- Marie Curie par Irène Joliot-Curie Prix Nobel de Chimie 1935.
- Heisenberg Werner Karl , 1901-1976, né à Würzburg, physicien allemand, prix Nobel de physique en 1932.
- Arrhenius Svante, 1859-1927, né à Wijk (près d'Uppsala), physicien et chimiste suédois, professeur de physique à l'université de Stockholm (1891), directeur de l'Institut Nobel de physique et chimie à partir de 1905.