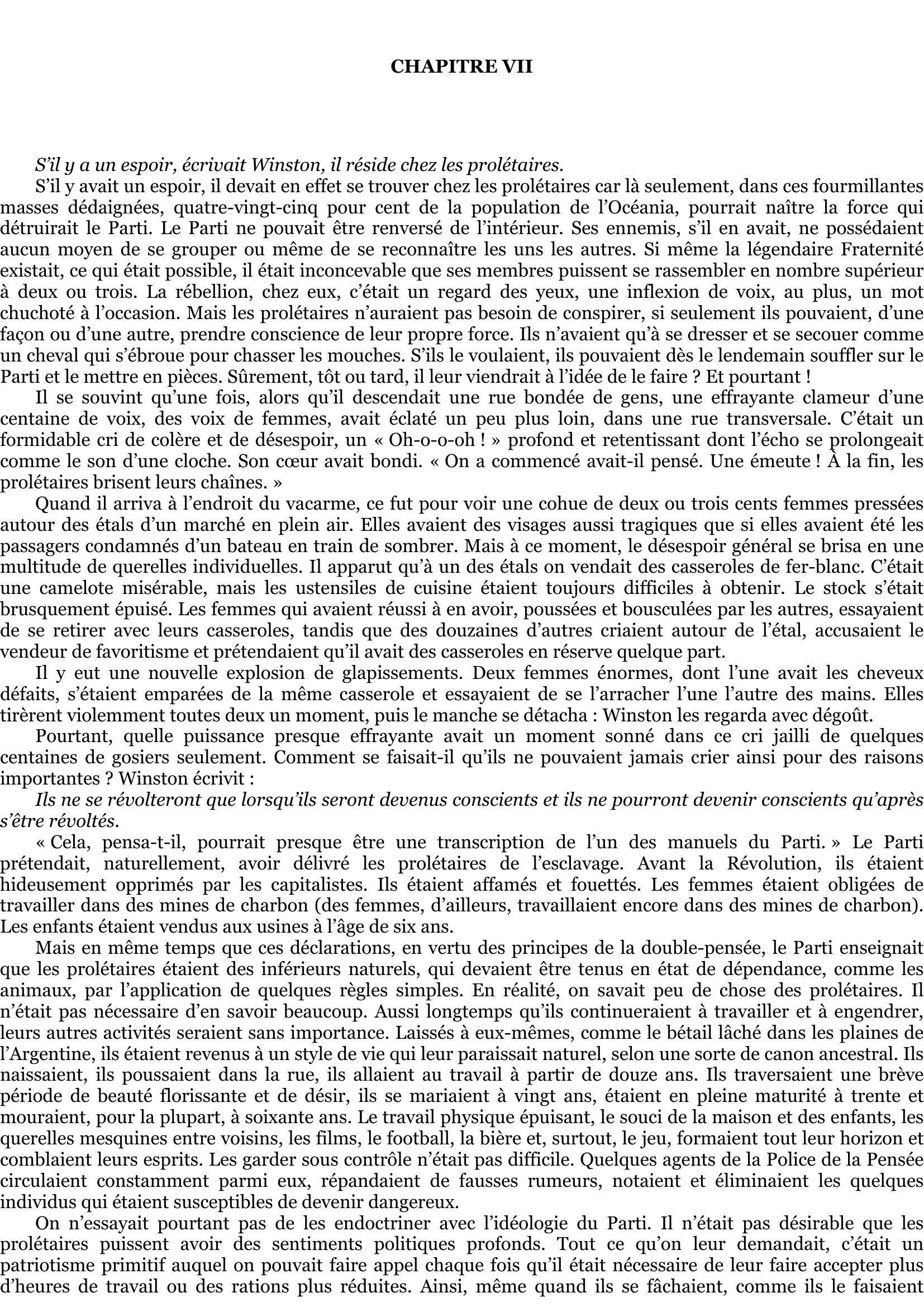thérapeutique n'avait pas agi.
Publié le 31/10/2013

Extrait du document
«
CHAPITRE
VII
S’il
ya un espoir, écrivait Winston, ilréside chezlesprolétaires.
S’il
yavait unespoir, ildevait eneffet setrouver chezlesprolétaires carlàseulement, danscesfourmillantes
masses dédaignées, quatre-vingt-cinq pourcentdelapopulation del’Océania, pourraitnaîtrelaforce qui
détruirait leParti.
LeParti nepouvait êtrerenversé del’intérieur.
Sesennemis, s’ilenavait, nepossédaient
aucun moyen desegrouper oumême desereconnaître lesuns lesautres.
Simême lalégendaire Fraternité
existait, cequi était possible, ilétait inconcevable quesesmembres puissentserassembler ennombre supérieur
à deux outrois.
Larébellion, chezeux,c’était unregard desyeux, uneinflexion devoix, auplus, unmot
chuchoté àl’occasion.
Maislesprolétaires n’auraientpasbesoin deconspirer, siseulement ilspouvaient, d’une
façon oud’une autre, prendre conscience deleur propre force.Ilsn’avaient qu’àsedresser etse secouer comme
un cheval quis’ébroue pourchasser lesmouches.
S’ilslevoulaient, ilspouvaient dèslelendemain soufflersurle
Parti etlemettre enpièces.
Sûrement, tôtoutard, illeur viendrait àl’idée delefaire ? Etpourtant !
Il se souvint qu’unefois,alors qu’ildescendait uneruebondée degens, uneeffrayante clameurd’une
centaine devoix, desvoix defemmes, avaitéclaté unpeu plus loin, dans uneruetransversale.
C’étaitun
formidable cridecolère etde désespoir, un« Oh-o-o-oh ! » profondetretentissant dontl’écho seprolongeait
comme leson d’une cloche.
Soncœur avaitbondi.
« Onacommencé avait-ilpensé.Uneémeute ! Àla fin, les
prolétaires brisentleurschaînes. »
Quand ilarriva àl’endroit duvacarme, cefut pour voirunecohue dedeux outrois cents femmes pressées
autour desétals d’unmarché enplein air.Elles avaient desvisages aussitragiques quesielles avaient étéles
passagers condamnés d’unbateau entrain desombrer.
Maisàce moment, ledésespoir généralsebrisa enune
multitude dequerelles individuelles.
Ilapparut qu’àundes étals onvendait descasseroles defer-blanc.
C’était
une camelote misérable, maislesustensiles decuisine étaienttoujours difficiles àobtenir.
Lestock s’était
brusquement épuisé.Lesfemmes quiavaient réussiàen avoir, poussées etbousculées parlesautres, essayaient
de seretirer avecleurs casseroles, tandisquedesdouzaines d’autrescriaientautourdel’étal, accusaient le
vendeur defavoritisme etprétendaient qu’ilavait descasseroles enréserve quelque part.
Il yeut une nouvelle explosion deglapissements.
Deuxfemmes énormes, dontl’une avaitlescheveux
défaits, s’étaient emparées delamême casserole etessayaient desel’arracher l’unel’autre desmains.
Elles
tirèrent violemment toutesdeuxunmoment, puislemanche sedétacha : Winstonlesregarda avecdégoût.
Pourtant, quellepuissance presqueeffrayante avaitunmoment sonnédanscecri jailli dequelques
centaines degosiers seulement.
Commentsefaisait-il qu’ilsnepouvaient jamaiscrierainsi pourdesraisons
importantes ? Winstonécrivit :Ils
neserévolteront quelorsqu’ils serontdevenus conscients etils ne pourront devenirconscients qu’après
s’être révoltés.« Cela,
pensa-t-il, pourraitpresqueêtreunetranscription del’un desmanuels duParti. » LeParti
prétendait, naturellement, avoirdélivré lesprolétaires del’esclavage.
AvantlaRévolution, ilsétaient
hideusement opprimésparlescapitalistes.
Ilsétaient affamés etfouettés.
Lesfemmes étaientobligées de
travailler dansdesmines decharbon (desfemmes, d’ailleurs, travaillaient encoredansdesmines decharbon).
Les enfants étaientvendus auxusines àl’âge desix ans.
Mais enmême tempsquecesdéclarations, envertu desprincipes deladouble-pensée, leParti enseignait
que lesprolétaires étaientdesinférieurs naturels,quidevaient êtretenus enétat dedépendance, commeles
animaux, parl’application dequelques règlessimples.
Enréalité, onsavait peudechose desprolétaires.
Il
n’était pasnécessaire d’ensavoir beaucoup.
Aussilongtemps qu’ilscontinueraient àtravailler etàengendrer,
leurs autres activités seraientsansimportance.
Laissésàeux-mêmes, commelebétail lâchédanslesplaines de
l’Argentine, ilsétaient revenus àun style devie qui leur paraissait naturel,selonunesorte decanon ancestral.
Ils
naissaient, ilspoussaient danslarue, ilsallaient autravail àpartir dedouze ans.Ilstraversaient unebrève
période debeauté florissante etde désir, ilssemariaient àvingt ans,étaient enpleine maturité àtrente et
mouraient, pourlaplupart, àsoixante ans.Letravail physique épuisant, lesouci delamaison etdes enfants, les
querelles mesquines entrevoisins, lesfilms, lefootball, labière et,surtout, lejeu, formaient toutleurhorizon et
comblaient leursesprits.
Lesgarder souscontrôle n’étaitpasdifficile.
Quelques agentsdelaPolice delaPensée
circulaient constamment parmieux,répandaient defausses rumeurs, notaientetéliminaient lesquelques
individus quiétaient susceptibles dedevenir dangereux.
On n’essayait pourtantpasdeles endoctriner avecl’idéologie duParti.
Iln’était pasdésirable queles
prolétaires puissentavoirdessentiments politiquesprofonds.Toutcequ’on leurdemandait, c’étaitun
patriotisme primitifauquelonpouvait faireappel chaque foisqu’il était nécessaire deleur faire accepter plus
d’heures detravail oudes rations plusréduites.
Ainsi,même quand ilssefâchaient, commeilslefaisaient.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on s'exuser en disant "j'ai agi inconsciemment" ?
- > Peut-on s’excuser en disant : « J’ai agi inconsciemment » ?
- thérapeutique.
- Nous commencerons par ce lexique guerrier, métaphores militaires , métaphores du combat qui caractérisent l'action thérapeutique, l'organisation de la lutte contre le cancer mais aussi l'engagement du patient contre la maladie depuis le début du 20ème siècle.
- Cytokines Les cytokines Benjamin Bertin 06 février 2012 But: définir et présenter les cytokines, leurs principales propriétés et activités biologiques, leurs récepteurs et les voies de transduction du signal associées, les utilisations des cytokines en thérapeutique.