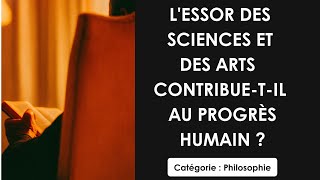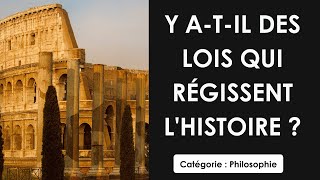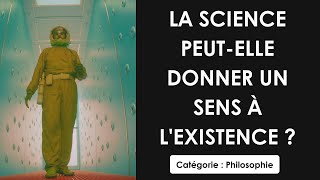Xavier ARSÈNE-HENRY. La ville.
Publié le 22/03/2011

Extrait du document
On reproche souvent à la ville de favoriser l'anonymat. L'individu s'y trouve perdu ; il ne se sent plus épaulé par un réseau de relations, alors que, dans un village, tous les visages lui sont familiers. Mais ne doit-on pas lutter contre la sécurité qu'apporte une telle restriction? Est-il souhaitable de rester comme un enfant qui ne se sent protégé qu'aux abords de sa mère ? Sommes-nous certains que la crainte d'être jugés par eux qui peuvent nous identifier soit un sentiment bien respecta-le ? N'est-ce pas au contraire lorsque nous sommes seuls juges de nos actes, dans l'anonymat, que, libres d'opter, notre conscience seule intervient et non le « qu'en-dira-t-on « ? Il semble bien que l'anonymat de la ville, en dehors de toutes contraintes dues à un voisinage imposé, nous offre l'indépendance de choisir en fonction de nos goûts et de notre tempérament : choisir ses amis, ses relations, choisir ses activités. D'autre part, avons-nous pris conscience de l'enrichissement de cette multiplicité de contacts quotidiens que nous offre la vie urbaine, de la multiplicité des occasions d'échanges, de la multiplicité des mobiles et des formes de groupes humains auxquels nous pouvons adhérer? Ce n'est pas parce qu'il faut faire effort, pour sortir d'un anonymat possible, qu'il faut condamner la ville. Bien au contraire. D'aucuns regrettent, avec le self-service, de ne plus avoir l'occasion de « causette « avec la crémière ou l'épicier du coin. Pourquoi ne pas remonter plus loin et souhaiter revenir au temps du « porteur d'eau « et du ramoneur savoyard... en abandonnant l'eau courante et le chauffage collectif ! En contrepartie de la disparition progressive de ce type de contacts, reconnaissons que la mobilité qui nous est offerte dans la ville nous permet, au cours d'une seule journée, de multiplier les occasions d'autres dialogues de nature différente. La ville, c'est aussi, pour chacun, la remise en cause continuelle de sa situation confortable. Il y est impossible de ne pas suivre le mouvement, sinon on est broyé. Cette perpétuelle évolution exige une continuelle adaptation. Nous sommes contraints d'être disponibles, d'être en éveil, prêts à réagir, de nous poser des questions. En ville, l'instabilité des contraintes nous oblige à remettre en cause ce que nous avons cru définitivement acquis. L'enrichissement naît de cette insécurité et nous appelle à une lutte continue, au lieu de nous laisser nous installer dans une satisfaisante tranquillité. En ville, devant la diversité des situations, devant la profusion des choix, nous ne pouvons plus nous contenter de jouer un unique personnage, remplissant une seule fonction. Cette multiplicité de personnages que nous sommes amenés à être, nous aide à modeler et à réfléchir l'unité de notre personne. Aussi bien, la ville elle-même, par sa complexité, est l'expression tangible de cette personnalisation. C'est seulement en ville qu'il est possible de localiser le plus d'éléments d'équipements, pour les rendre accessibles à tous Beaucoup de choses y sont à tout le monde. Il s'y établit un équilibre entre ce qui est individuel, privé, inaliénable, et ce qui est « aussi « aux autres ; cet équilibre accroît la sensation de solidarité entre les hommes et devrait les aider à découvrir le « prochain «. Chacun devant faire apport aux autres de soi-même, dans le respect du bien commun. C'est aussi en ville que s'impose à nous le besoin de troquer l'efficacité pour soi contre l'efficacité pour les autres. En fait, seuls profitent des avantages de la ville ceux qui acceptent d'entrer dans une mentalité urbaine. Bien évidemment, il importe que la ville elle-même se prête à ces rapports humanisants. Ce qui suppose que l'urbaniste qui en dresse les plans soit lui-même pénétré de la mentalité urbaine. Nous tenterons plus loin de tracer les grands axes de cet univers bâti tel que nous le concevons. Mais d'ores et déjà nous pouvons affirmer que la ville enrichissante ne saurait être la ville d'hier, même rénovée : c'est une ville convertie, libérée de la mentalité individualiste actuelle. Vous ferez de ce texte soit un résumé, soit une analyse. Vous indiquerez nettement en tête de l'exercice le mot « résumé « ou le mot « analyse «. Vous choisirez ensuite dans le texte un thème qui offre une réelle consistance et auquel vous attachez un intérêt particulier. Vous en préciserez soigneusement les données, et vous exposerez, en les justifiant, vos propres vues sur la question.
Liens utiles
- VILLE DONT LE PRINCE EST UN ENFANT (La). (résumé) Henry de Montherlant
- Une approche géocritique de la ville africaine
- L'homme et la ville
- exposé Henry Cochin, article « A propos de quelques tableaux impressionnistes »
- EXPOSE SUR L’INCARNATION DE MICHEL HENRY