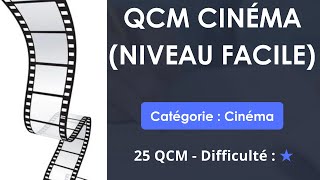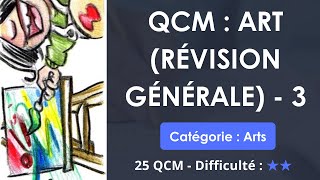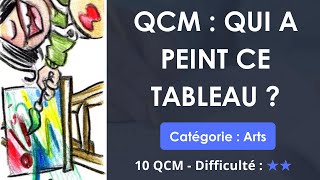LE BALLET DE COUR
Publié le 16/11/2018

Extrait du document
BALLET DE COUR. A l’apogée du classicisme, le grand courtisan qui aurait rougi de monter sur scène pour déclamer une strophe de Corneille ou de Racine se réjouit d’exécuter une entrée ou simplement quelques pas dans un ballet dont, il est vrai, le premier danseur n’est autre que Louis XIV. C’est assez dire la faveur que connaît le ballet dans les différentes cours françaises, de la Renaissance à 1670, date à laquelle le monarque se retire de la scène.
Dans bien des domaines, les Italiens avaient été les initiateurs. Ils restèrent tout au long du siècle des maîtres admirés. Sous leur influence, le ballet de cour à la française imposa son esthétique du mirage et déploya en plein triomphe du classicisme ses inventions miraculeuses et ses fastes baroques.
Repères historiques
Le ballet de cour se distingue des danses populaires comme des danses mondaines, bien que le passage au spectacle proprement dit se soit parfois fait progressivement. Il est défini par M.-F. Christout, en dépit de ses transformations, comme une « danse figurée à évolutions concertées, accompagnée d’une musique appropriée, souvent soutenue par un thème poétique, mythologique ou héroïque, interprétée par des danseurs de qualité dans un climat de faste inhabituel ».
Le ballet de cour est né en Italie à l’occasion des fêtes, des manifestations folkloriques et des entrées princières. Cortèges et défilés de chars se déploient dans les villes entièrement livrées au spectacle. Les canti (deux chœurs dont les chants se répondent dans les rues de la ville) et les trionfi (avec chars et cortèges) donnèrent naissance aux « mascarades de cour », qui unissent musique et danse à une action dramatique.
Charles VIII et Louis XII avaient été séduits par les danses données en leur honneur en Italie. François Ier fit venir en France des artistes italiens. Sous Charles IX, on danse en 1573 le Ballet des ambassadeurs polonais, qui se compose, d’après Brantôme, de « tours, contours et destours, d’entrelasseurs et meslanges. affrontements et arrests ». En 1581 est donné le Ballet comique de la reine, avec un faste considérable. Le ballet fait alors partie de la vie des cours. De 1589 à 1610, on compte plus de huit cents ballets — surtout des mascarades, auxquelles Henri IV prend volontiers part, et où domine la fantaisie burlesque. En 1610 triomphe le Ballet d’Al-cine. Ensuite, le ballet mélodramatique (ballet d’action avec intrigue à tendance romanesque) a la faveur, jusqu’au retour du ballet-mascarade en 1621. Puis le genre connaît un bref déclin, renaît avec le Ballet de la douairière de Billebahaut (1626). Conscient du succès du ballet, Richelieu tente de l’exploiter en y greffant des thèmes politiques, avec, par exemple, le Ballet des quatre monarchies chrétiennes (1635) ou celui de la Prospérité des armes de France (1641), sans réel succès.
Sous Louis XIV, le ballet devient de plus en plus mythologique et contribue à déifier le souverain dès les premières apparitions du monarque dans le Ballet de Cassandre (1651) et dans la Nuit (1653). Les créations se succèdent, sous l’égide de Lully pour la musique et de Benserade pour les vers. En 1661, le roi décide de protéger les danseurs professionnels et fonde l’Académie royale de danse. A la même époque, Molière et Lully inaugurent la comédie-ballet (une comédie avec des entrées de ballet intercalées), qui triomphe à son tour dans les fêtes royales. Le déclin du ballet ne commence qu’après 1670, quand le monarque cesse de danser en public.
Formes et thèmes : une esthétique du mirage
La conception du ballet et sa composition ont évolué au cours du siècle. Parfois figuratif avec des « danses d’action », parfois non figuratif et laissant la part principale à la « danse pure », non narrative, il comporte le
«
plus
souvent des entrées, des figures, des récits et des
vers.
Plusieurs ouvrages traitent des questions théoriques
s'y rapportant et prouvent à quel point il est pris au
sérieux à l'époque : Idée des spectacles anciens et nou
veaux, de l'abbé Michel de Pure (1668); Des ballets
anciens et modernes selon les règles du théâtre, du père
Menestrier (1682), ainsi qu'une partie de la Prati que du
théâtre, de l'abbé d'Aubignac (1657).
Le ballet se divise en trois parties : l'ouverture, où le
sujet est exposé par un récit en musique ou par un dialo
gue déclamé; les entrées, qui ne doivent être ni trop
nombreuses ni trop diverses; le grand ballet, qui termine
le spectacle.
Le livret est souvent anonyme ou collectif,
mais un écrivain a la charge des récits chantés ainsi
que des vers dédiés aux personnes de qualité.
Benserade
excella dans cet art.
A son apogée, le ballet se caractérise par la diversité
de ses thèmes.
Mythologique, héroïque, allégorique, il
puise son inspiration partout.
Les sujets font appel aux
dieux aussi bien qu'aux héros de l'histoire antique, de la
chevalerie médiévale, du roman précieux ou du roman à
la mode.
L'imagination des poètes s'évade dans l'exo
tisme et la plus grande fantaisie, bien que les théoriciens
recommandent une certaine unité de sujet.
Placé sous le signe de Protée, puis sous celui d' Apol
lon à mesure qu'on avance dans le règne de Louis XIV,
le ballet déploie les fastes du spectaculaire le plus raf
finé.
Avec l'opéra et les pièces à machines, il devient le
refuge de l'imaginaire, confond à plaisir la réalité et les
apparences.
Grâce à l'amélioration constante des techni
ques de la scène, à l'utilisation massive de décors somp
tueux, de cos:umes bizarres et de jeux de lumière raffi
nés, le ballet l> • i mpo e comme un art complet, placé sous
le signe du mouvement et de l'artifice.
L'habile mélange
de la musique.
de figures, de la parole chantée ou parlée,
crée un lieu privilégié, quasi magique, où le monarque
s'exhibe entouré de ses principaux courtisans.
Dans ce
jeu des miroirs et de la séduction, la Cour se plaît à
égarer puis à reconnaître sa propre image, magnifiée par
les prodiges de la scène.
BlBL!OGRAPH lE Sur le ballet en général, on peut consuher l'Histoire du ballet,
de M.-F.
Christout, P.U.F., «Que sais-je? ''• 1964.
Du même
auteur, un ouvrage essentiel.
le Baller de cour de Louis XIV
(1643-1672), thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres,
A.
et J.
Picard, Paris.
1967.
Pour la période antérieure, le très
bon livre de Ma rgaret Mc Gowan, 1 'Arr du baller de cour ( 1581-
1642), Paris.
C.N.R.S .
.
1964.
richement illustré, fait autorité.
J.-P.
RYNGAERT.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'histoire du ballet, qui commença en France au XVI e siècle sous l'influence des artistes italiens invités à la cour, n'a cessé de s'enrichir des influences extérieures.
- Balthazar de Beaujoyeux et le ballet de Cour
- Le ballet de cour
- Sur l’école cubaine de ballet
- commentaire: De la cour de La bruyère in les "Caractères"