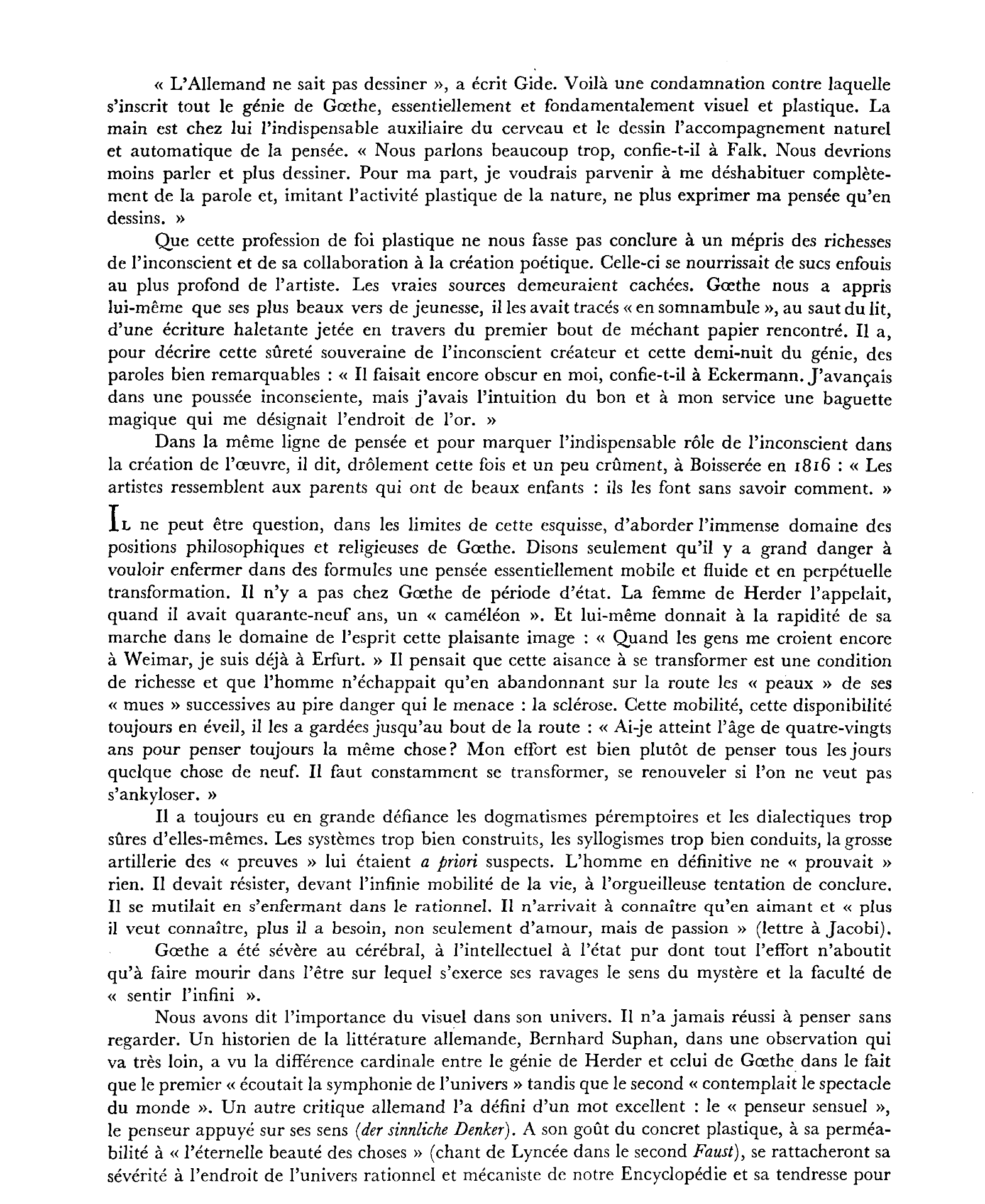Goethe, Johann Wolfgang von
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
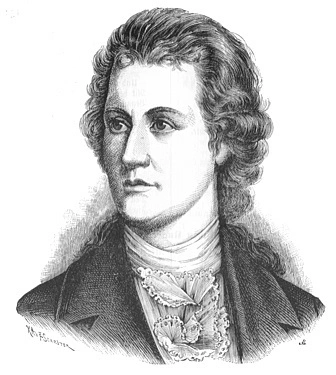
Ecrivain allemand né à Francfort-sur-le-Main, mort à Weimar (1749- 1832). Etudes de droit à Leipzig (1765-1768), à Strasbourg (1770- 1771); stage pratique à la Cour suprême de l'Empire à Wetzlar (1772); avocat à Francfort (1772- 1775); conseiller de légation secret (c.-à-d. ministre) du duc de Saxe-Weimar, activité dans l'administration intérieure, toutes branches (1776); voyage en Italie (1785-1788); inspecteur des travaux publics, du théâtre et de l'Université d'Iéna (1788-1832). La naissance de Goethe, descendant d'une des familles patriciennes de la ville libre de Francfort-sur-le-Main, coïncide avec celle du Mouvement allemand, en plein essor après la guerre civile (1756-1763) pour la réunion de l'Allemagne et la réforme de la Constitution de l'Empire. A ce mouvement, Goethe donna son expression décisive sur le plan littéraire, fondant ainsi la littérature allemande moderne. Il sut présenter les faits d'une manière lyrique, exaltant ainsi les valeurs les plus profondes. Son activité politique, son voyage en Italie et son étude des sciences naturelles lui permirent de placer son explication de l'homme dans une perspective universelle. Son explication lyrique des forces profondes apparaît à travers sa présentation du grand homme, seul être politique, dans le Götz (1773), sa description du conflit entre individu et société dans Les Souffrances du Jeune Werther (1774), sa motivation de la révolution des traditions populaires contre le despotisme dans Egmont (1788). La Révolution française, qu'il considéra dès Valmy comme le commencement d'une nouvelle époque de l'histoire mondiale, fut rejetée par lui dès l'abord, parce qu'elle était une rupture rationaliste et artificielle d'avec la réalité et les traditions; il lui opposa l'image d'une liaison interne entre noblesse et bourgeoisie dans son grand roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795). Admirateur de Napoléon (rencontres de 1808 à Erfurt et Weimar), en qui il voyait le promoteur d'une union européenne, il voulait préserver néanmoins l'autonomie culturelle de chaque nation. Après 1815, à mi-chemin entre Metternich et le libéralisme, il traçait avec son Faust les lignes de force de son riche et inquiétant héritage spirituel.
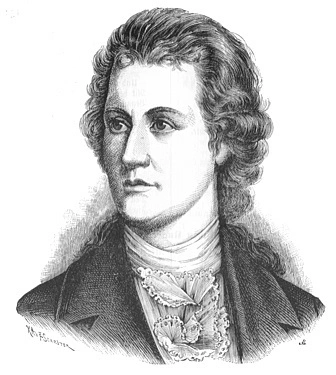
«
« L'Allemand ne sait pas dessiner », a écrit Gide.
Voilà une condamnation contre laquelle
s'inscrit
tout le génie de Gœthe, essentiellement et fondamentalement visuel et plastique.
La
main est chez lui l'indispensable auxiliaire du cerveau et le dessin l'accompagnement naturel
et automatique de la pensée.
« Nous parlons beaucoup trop, confie-t-il à Falk.
Nous devrions
moins
parler et plus dessiner.
Pour ma part, je voudrais parvenir à me déshabituer complète
ment de la parole et, imitant l'activité plastique de la nature, ne plus exprimer ma pensée qu'en
dessins.
»
Que cette profession de foi plastique ne nous fasse pas conclure à un mépris des richesses
de l'inconscient et de sa collaboration à la création poétique.
Celle-ci se nourrissait de sucs enfouis
au plus profond de l'artiste.
Les vraies sources demeuraient cachées.
Gœthe nous a appris
lui-même
que ses plus beaux vers de jeunesse, il les avait tracés« en somnambule »,au saut du lit,
d'une écriture haletante jetée en travers du premier bout de méchant papier rencontré.
Il a,
pour décrire cette sûreté souveraine de l'inconscient créateur et cette demi-nuit du génie, des
paroles bien
remarquables : « Il faisait encore obscur en moi, confie-t-il à Eckermann.
J'avançais
dans une poussée inconsciente, mais j'avais l'intuition du bon et à mon service une baguette
magique qui me désignait l'endroit de l'or.
»
Dans la même ligne de pensée et pour marquer l'indispensable rôle de l'inconscient dans
la création de l'œuvre, il dit, drôlement cette fois et un peu crûment, à Boisserée en 1816 : « Les
artistes ressemblent
aux parents qui ont de beaux enfants : ils les font sans savoir comment.
»
IL ne peut être question, dans les limites de cette esquisse, d'aborder l'immense domaine des
positions philosophiques
et religieuses de Gœthe.
Disons seulement qu'il y a grand danger à
vouloir enfermer dans des formules une pensée essentiellement mobile et fluide et en perpétuelle
transformation.
Il n'y a pas chez Gœthe de période d'état.
La femme de Herder l'appelait,
quand il avait quarante-neuf ans, un « caméléon ».
Et lui-même donnait à la rapidité de sa
marche dans le domaine de l'esprit cette plaisante image : « Quand les gens me croient encore
à
Weimar, je suis déjà à Erfurt.
» Il pensait que cette aisance à se transformer est une condition
de richesse
et que l'homme n'échappait qu'en abandonnant sur la route les « peaux » de ses
« mues » successives au pire danger qui le menace : la sclérose.
Cette mobilité, cette disponibilité
toujours
en éveil, il les a gardées jusqu'au bout de la route : « Ai-je atteint l'âge de quatre-vingts
ans
pour penser toujours la même chose? Mon effort est bien plutôt de penser tous les jours
quelque chose de neuf.
Il faut constamment se transformer, se renouveler si l'on ne veut pas
s'ankyloser.
»
Il a toujours eu en grande défiance les dogmatismes péremptoires et les dialectiques trop
sûres d'elles-mêmes.
Les systèmes trop bien construits, les syllogismes trop bien conduits, la grosse
artillerie des
« preuves >> lui étaient a priori suspects.
L'homme en définitive ne « prouvait »
rien.
Il devait résister, devant l'infinie mobilité de la vie, à l'orgueilleuse tentation de conclure.
Il se mutilait en s'enfermant dans le rationnel.
Il n'arrivait à connaître qu'en aimant et « plus
il veut connaître, plus il a besoin, non seulement d'amour, mais de passion » (lettre à Jacobi).
Gœthe a été sévère au cérébral, à l'intellectuel à l'état pur dont tout l'effort n'aboutit
qu'à faire mourir dans l'être sur lequel s'exerce ses ravages le sens du mystère et la faculté de
« sentir l'infini ».
Nous avons dit l'importance du visuel dans son univers.
II n'a jamais réussi à penser sans
regarder.
Un historien de la littérature allemande, Bernhard Suphan, dans une observation qui
va très loin, a vu la différence cardinale entre le génie de Herder et celui de Gœthe dans le fait
que le premier« écoutait la symphonie de l'univers» tandis que le second «contemplait le spectacle
du monde ».
Un autre critique allemand l'a défini d'un mot excellent : le « penseur sensuel »,
le penseur appuyé sur ses sens (der sinnliche Denker).
A son goût du concret plastique, à sa perméa
bilité à« l'éternelle beauté des choses» (chant de Lyncée dans le second Faust), se rattacheront sa
sévérité à
l'endroit de l'univers rationnel et mécaniste de notre Encyclopédie et sa tendresse pour.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werthers (Sprache & Litteratur).
- Johann Wolfgang von Goethe (Sprache & Litteratur).
- Johann Wolfgang von Goethe - idiomas.
- Goethe (Johann Wolfgang von), 1749-1832, né à Francfort-sur-le-Main, écrivain allemand.
- Johann Wolfgang von Goethe - Biography.