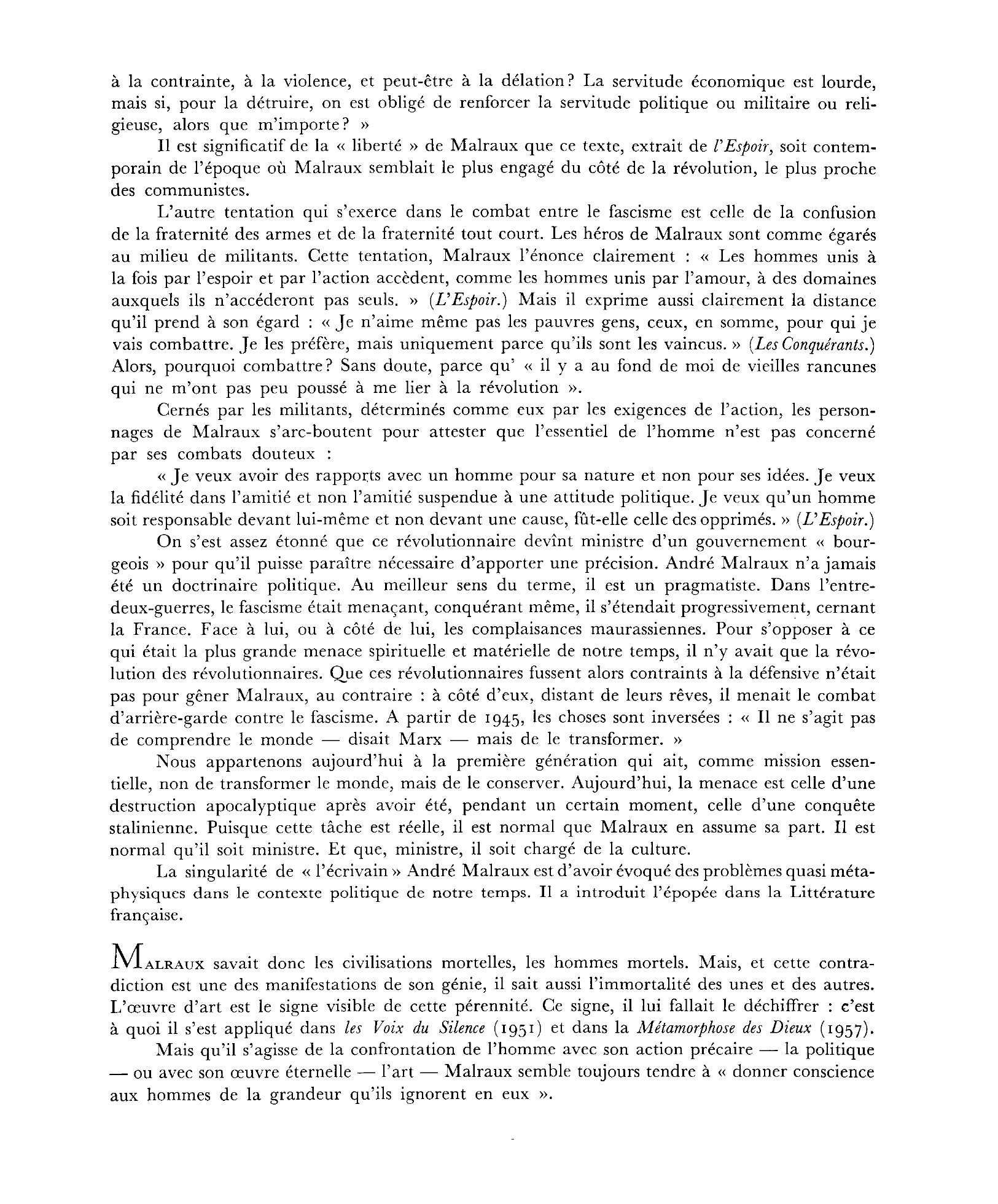Malraux, André
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
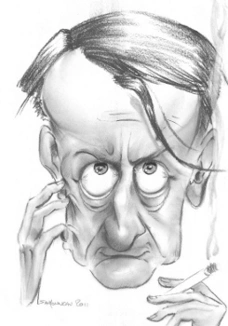
Ecrivain et homme politique français. Né à Paris en 1901. Après des études secondaires, il prit part à diverses expéditions de recherches archéologiques. Il entra également en contact avec les dirigeants communistes du Sud-Est asiatique, puis mena diverses campagnes politiques. Défenseur de Dimitrov, accusé par les nazis, il devient le président du Comité mondial antifasciste. Membre des brigades internationales en Espagne, il soutient la cause des républicains espagnols. Prisonnier en 1940, il s'évade, rejoint le maquis et fait la campagne d'Alsace-Lorraine. Après 1945, il s'associe aux activités politiques du général de Gaulle. Plusieurs fois ministre de l'Information et des Affaires culturelles, il est à diverses reprises renvoyé spécial du général.
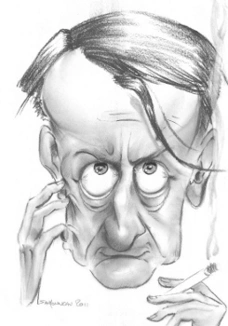
«
r
r i
à la contrainte, à la violence, et peut-être à la délation? La servitude économique est lourde,
mais si, pour la détruire, on est obligé de renforcer la servitude politique ou militaire ou reli
gieuse, alors
que m'importe? »
Il est significatif de la « liberté » de Malraux que ce texte, extrait de l'Espoir, soit contem
porain de l'époque où Malraux semblait le plus engagé du côté de la révolution, le plus proche
des communistes.
L'autre tentation qui s'exerce dans le combat entre le fascisme est celle de la confusion
de la fraternité des armes et de la fraternité tout court.
Les héros de Malraux sont comme égarés
au milieu de militants.
Cette tentation, Malraux l'énonce clairement : « Les hommes unis à
la fois par l'espoir et par l'action accèdent, comme les hommes unis par l'amour, à des domaines
auxquels ils n'accéderont pas seuls.
» (L'Espoir.) Mais il exprime aussi clairement la distance
qu'il prend à son égard : «Je n'aime même pas les pauvres gens, ceux, en somme, pour qui je
vais combattre.
Je les préfère, mais uniquement parce qu'ils sont les vaincus.» (Les Conquérants.)
Alors, pourquoi combattre? Sans doute, parce qu' « il y a au fond de moi de vieilles rancunes
qui ne m'ont pas peu poussé à me lier à la révolution ».
Cernés par les militants, déterminés comme eux par les exigences de l'action, les person
nages de Malraux s'arc-boutent pour attester que l'essentiel de l'homme n'est pas concerné
par ses combats douteux :
«Je veux avoir des rappor:ts avec un homme pour sa nature et non pour ses idées.
Je veux
la fidélité dans l'amitié et non l'amitié suspendue à une attitude politique.
Je veux qu'un homme
soit responsable devant lui-même et non devant une cause, fût-elle celle des opprimés.» (L'Espoir.)
On s'est assez étonné que ce révolutionnaire devînt ministre d'un gouvernement « bour
geois » pour qu'il puisse paraître nécessaire d'apporter une précision.
André Malraux n'a jamais
été un doctrinaire politique.
Au meilleur sens du terme, il est un pragmatiste.
Dans l'entre
deux-guerres, le fascisme était menaçant, conquérant même, il s'étendait progressivement, cernant
la France.
Face à lui, ou à côté de lui, les complaisances maurassiennes.
Pour s'opposer à ce
qui était la plus grande menace spirituelle et matérielle de notre temps, il n'y avait que la révo
lution des révolutionnaires.
Que ces révolutionnaires fussent alors contraints à la défensive n'était
pas pour gêner Malraux, au contraire : à côté d'eux, distant de leurs rêves, il menait le combat
d'arrière-garde contre le fascisme.
A partir de r 945, les choses sont inversées : « Il ne s'agit pas
de comprendre le monde -disait Marx - mais de le transformer.
»
Nous appartenons aujourd'hui à la première génération qui ait, comme mission essen
tielle,
non de transformer le monde, mais de le conserver.
Aujourd'hui, la menace est celle d'une
destruction apocalyptique après avoir été, pendant un certain moment, celle d'une conquête
stalinienne.
Puisque cette tâche est réelle, il est normal que Malraux en assume sa part.
Il est
normal qu'il soit ministre.
Et que, ministre, il soit chargé de la culture.
La singularité de «l'écrivain» André Malraux est d'avoir évoqué des problèmes quasi méta
physiques dans le contexte politique de notre temps.
Il a introduit l'épopée dans la Littérature
française.
MALRAux savait donc les civilisations mortelles, les hommes mortels.
Mais, et cette contra
diction est une des manifestations de son génie, il sait aussi l'immortalité des unes et des autres.
L'œuvre d'art est le signe visible de cette pérennité.
Ce signe, il lui fallait le déchiffrer : c'est
à quoi il s'est appliqué dans les Voix du Silence (1951) et dans la Métamorphose des Dieux (1957).
Mais qu'il s'agisse de la confrontation de l'homme avec son action précaire - la politique
-ou avec son œuvre éternelle- l'art- Malraux semble toujours tendre à « donner conscience
aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux ».
103.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Condition humaine (la) d'André Malraux
- VOIE ROYALE (La) d'André Malraux (résumé & analyse)
- Métamorphose des dieux (la). Essai d'André Malraux (analyse détaillée)
- ANTIMÉMOIRES d'André Malraux (fiche de lecture)
- CONQUÉRANTS (Les) André Malraux (résumé & analyse)