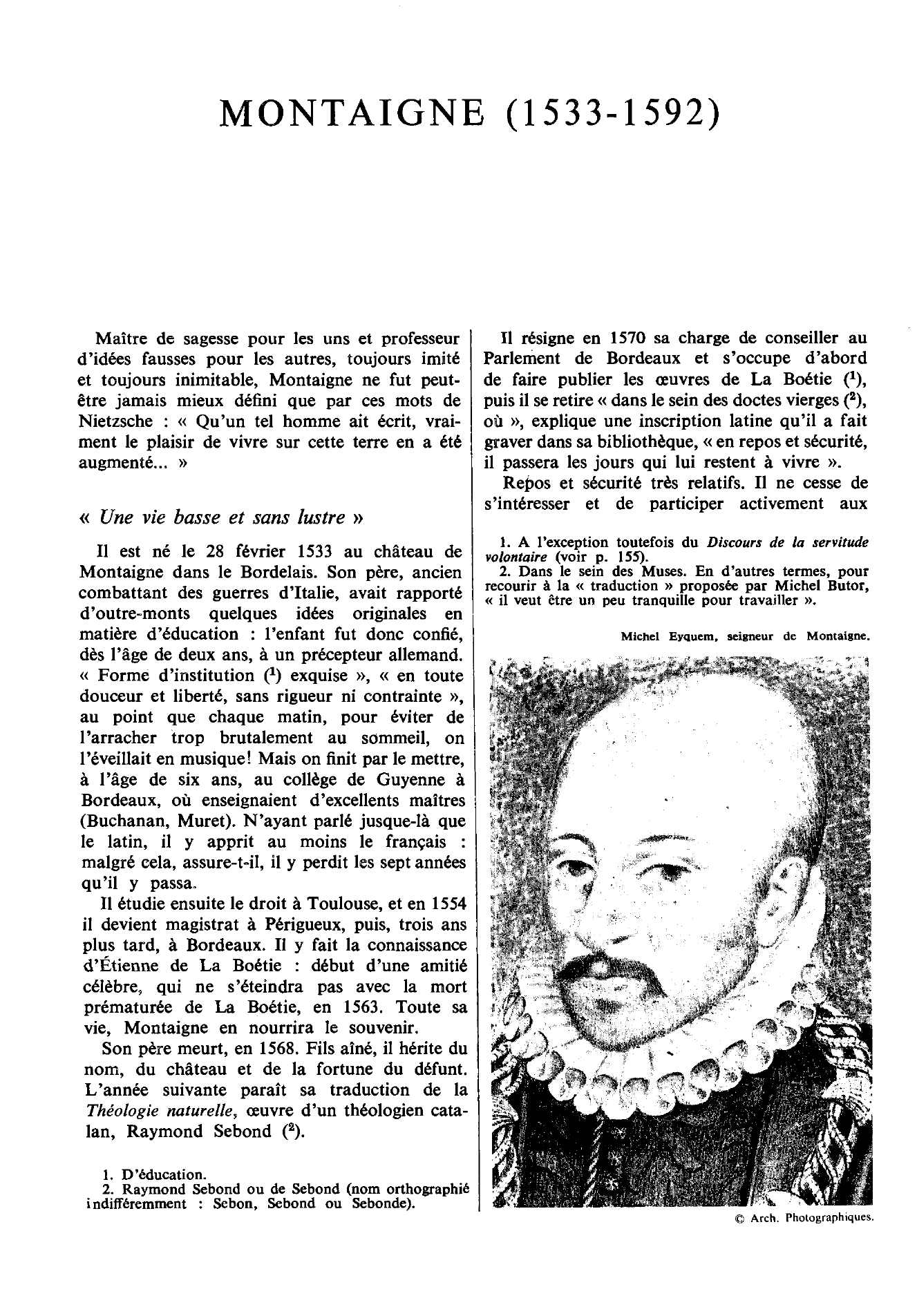Montaigne
Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Michel Eyquem de Montaigne, dit Né en : 1533 Mort en : 1592 Famille : Un de ses ancêtres, portugais d'origine, était un gros négociant en vins et en poissons salés. Il s'était installé à Bordeaux et s'était enrichi. Son père avait fait les guerres d'Italie. Sa famille s'est anoblie en achetant une charge de magistrat (noblesse de robe). Études : Son père se préoccupe de son éducation. Montaigne connaît une enfance en pleine liberté. Puis il apprend le latin avant le français. Il fait ses études au collège de Guyenne à Bordeaux, et son droit, sans doute à Toulouse. La magistrature 1554-1571 : Il est conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis au parlement de Bordeaux. Il devient l'ami d'Étienne de La Boétie, magistrat lui aussi, dont la mort prématurée (1563) le bouleverse. En 1565, il épouse Françoise de La Chassaigne, fille d'un magistrat bordelais. La retraite 1568 : À la mort de son père, il se retire dans son château. Il mène la vie d'un gentilhomme campagnard et se consacre à la lecture et à l'écriture. 1580 : Il fait un voyage pour raison de santé et par curiosité intellectuelle (Paris, Plombières, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie). La mairie 1581-1585 : Il est maire de Bordeaux. La dernière retraite 1586-1588 : Il se retire à nouveau dans son château. 1588 : Il vient à Paris pour faire paraître une seconde édition des Essais. Le voyage est périlleux et mouvementé. 1588-1592 : Il relit et retouche encore son œuvre et meurt en 1592 dans son château.
Œuvres 1569 : Traduction de la Théologie naturelle de Raymond Sebond. 1571 : Il fait publier les Œuvres de La Boétie. 1580 : Première édition des Essais. 1588 : Deuxième édition des Essais. 1595 : Troisième édition posthume des Essais avec des additions, édition préparée par Mlle de Gournay, sa « fille d'alliance « (presque fille adoptive). 1774 : Première édition du Journal de voyage.

«
MONTAIGNE (1533-1592)
Maître de sagesse pour les uns et professeur
d'idées fausses pour les autres, toujours imité
et toujours inimitable, Montaigne ne fut peut
être jamais mieux défini que par ces mots de
Nietzsche :
« Qu'un tel homme ait écrit, vrai
ment
le plaisir de vivre sur cette terre en a été
augmenté...
»
« Une vie basse et sans lustre »
Il est né le 28 février 1533 au château de
Montaigne dans le Bordelais.
Son père, ancien
combattant des guerres d'Italie, avait rapporté
d'outre-monts quelques idées originales en
matière d'éducation : l'enfant fut donc confié,
dès l'âge de deux ans, à un précepteur allemand.
« Forme d'institution ( 1
) exquise >>, « en toute
douceur et liberté, sans rigueur ni contrainte
»,
au point que chaque matin, pour éviter de
l'arracher
trop brutalement au sommeil, on
l'éveillait en musique! Mais on finit par
le mettre,
à 1 'âge de six ans,
au collège de Guyenne à
Bordeaux, où enseignaient d'excellents maîtres
(Buchanan, Muret).
N'ayant parlé jusque-là que
le latin,
il y apprit au moins le français :
malgré cela, assure-t-il,
il y perdit les sept années
qu'il y passa.
Il étudie ensuite
le droit à Toulouse, et en 1554
il devient magistrat à Périgueux, puis, trois ans
plus tard, à Bordeaux.
II y fait la connaissance
d'Étienne de
La Boétie : début d'une amitié
célèbre, qui ne s'éteindra pas avec la mort
prématurée de La Boétie, en
1563.
Toute sa
vie, Montaigne en nourrira
le souvenir.
Son père meurt, en 1568.
Fils aîné, il hérite du
nom, du château et de la fortune du défunt.
L'année suivante paraît sa traduction de la
Théologie naturelle, œuvre d'un théologien cata
lan, Raymond
Sebond (2).
1.
D'éducation.
2.
Raymond Sebond ou de Sebond (nom orthographié
indifféremment : Sebon, Sebond ou Sebonde).
Il résigne en 1570 sa charge de conseiller au
Parlement de Bordeaux et s'occupe
d'abord
de faire publier les œuvres de La Boétie (1),
puis il se retire « dans le sein des doctes vierges ( 2),
où », explique une inscription latine qu'il a fait
graver dans sa bibliothèque,
« en repos et sécurité,
il passera les jours qui lui restent à vivre ».
Repos et sécurité très relatifs.
Il ne cesse de
s'intéresser et de participer activement aux
1.
A l'exception toutefois du Discours de la servitude
volontaire (voir p.
155).
2.
Dans le sein des Muses.
En d'autres termes, pour
recourir à la « traduction » proposée par Michel Butor, « il veut être un peu tranquille pour travailler ».
Michel Eyquem, seigneur de Montaigne.
© Arch.
Photographiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne
- Analyse de l'essai Des Cannibales, Montaigne.
- Que philosopher, c'est apprendre à mourir Essais de Montaigne
- vertu et Montaigne texte
- J'aime mieux forger mon âme, que la meubler - Michel de Montaigne (1533-1592)