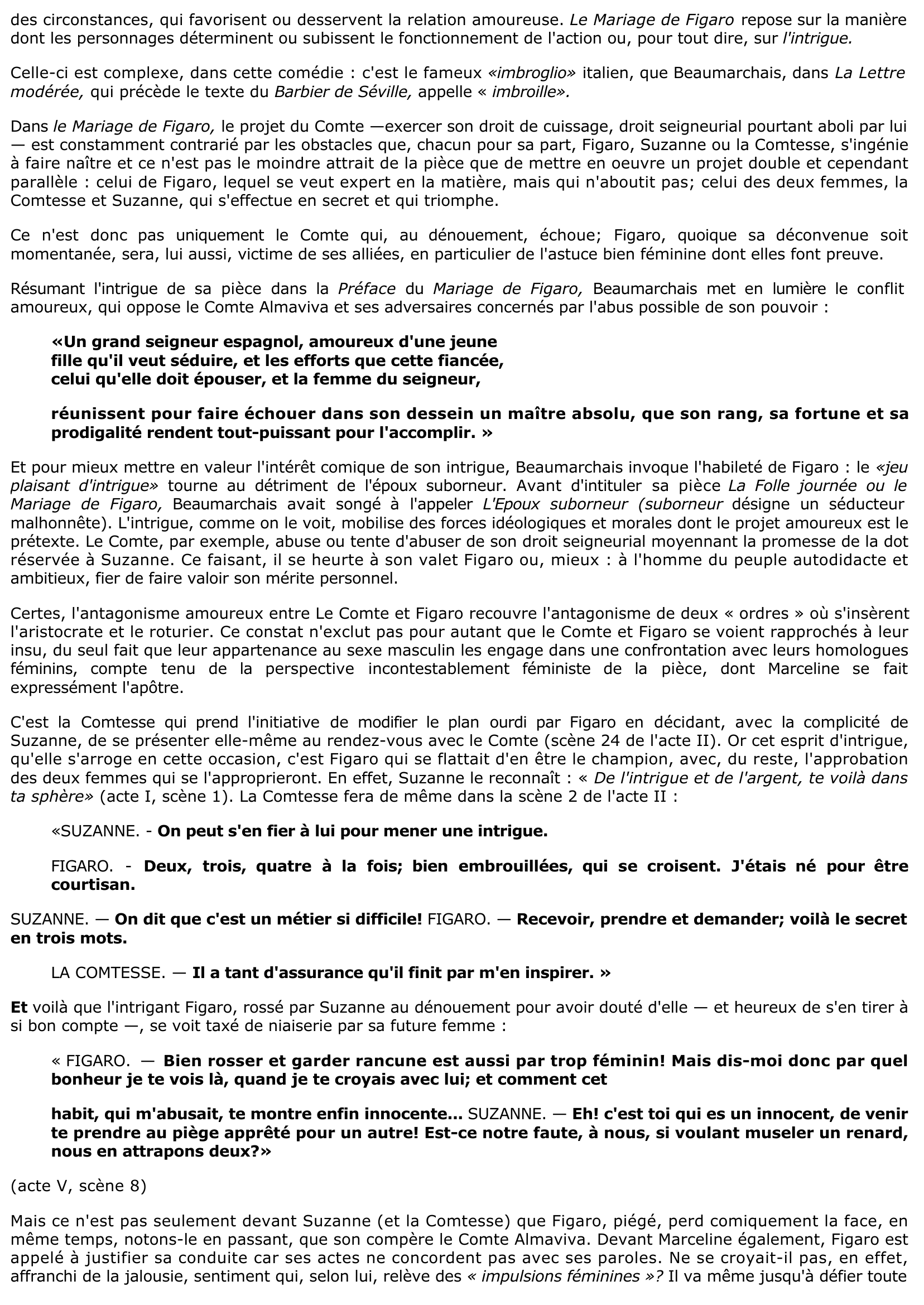En fait d'amour, vois-tu, trop n'est pas même assez. Beaumarchais
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
des circonstances, qui favorisent ou desservent la relation amoureuse.
Le Mariage de Figaro repose sur la manière dont les personnages déterminent ou subissent le fonctionnement de l'action ou, pour tout dire, sur l'intrigue.
Celle-ci est complexe, dans cette comédie : c'est le fameux «imbroglio» italien, que Beaumarchais, dans La Lettre modérée, qui précède le texte du Barbier de Séville, appelle « imbroille».
Dans le Mariage de Figaro, le projet du Comte —exercer son droit de cuissage, droit seigneurial pourtant aboli par lui — est constamment contrarié par les obstacles que, chacun pour sa part, Figaro, Suzanne ou la Comtesse, s'ingénieà faire naître et ce n'est pas le moindre attrait de la pièce que de mettre en oeuvre un projet double et cependantparallèle : celui de Figaro, lequel se veut expert en la matière, mais qui n'aboutit pas; celui des deux femmes, laComtesse et Suzanne, qui s'effectue en secret et qui triomphe.
Ce n'est donc pas uniquement le Comte qui, au dénouement, échoue; Figaro, quoique sa déconvenue soitmomentanée, sera, lui aussi, victime de ses alliées, en particulier de l'astuce bien féminine dont elles font preuve.
Résumant l'intrigue de sa pièce dans la Préface du Mariage de Figaro, Beaumarchais met en lumière le conflit amoureux, qui oppose le Comte Almaviva et ses adversaires concernés par l'abus possible de son pouvoir :
«Un grand seigneur espagnol, amoureux d'une jeunefille qu'il veut séduire, et les efforts que cette fiancée,celui qu'elle doit épouser, et la femme du seigneur,
réunissent pour faire échouer dans son dessein un maître absolu, que son rang, sa fortune et saprodigalité rendent tout-puissant pour l'accomplir.
»
Et pour mieux mettre en valeur l'intérêt comique de son intrigue, Beaumarchais invoque l'habileté de Figaro : le «jeu plaisant d'intrigue» tourne au détriment de l'époux suborneur.
Avant d'intituler sa pièce La Folle journée ou le Mariage de Figaro, Beaumarchais avait songé à l'appeler L'Epoux suborneur (suborneur désigne un séducteur malhonnête).
L'intrigue, comme on le voit, mobilise des forces idéologiques et morales dont le projet amoureux est leprétexte.
Le Comte, par exemple, abuse ou tente d'abuser de son droit seigneurial moyennant la promesse de la dotréservée à Suzanne.
Ce faisant, il se heurte à son valet Figaro ou, mieux : à l'homme du peuple autodidacte etambitieux, fier de faire valoir son mérite personnel.
Certes, l'antagonisme amoureux entre Le Comte et Figaro recouvre l'antagonisme de deux « ordres » où s'insèrentl'aristocrate et le roturier.
Ce constat n'exclut pas pour autant que le Comte et Figaro se voient rapprochés à leurinsu, du seul fait que leur appartenance au sexe masculin les engage dans une confrontation avec leurs homologuesféminins, compte tenu de la perspective incontestablement féministe de la pièce, dont Marceline se faitexpressément l'apôtre.
C'est la Comtesse qui prend l'initiative de modifier le plan ourdi par Figaro en décidant, avec la complicité deSuzanne, de se présenter elle-même au rendez-vous avec le Comte (scène 24 de l'acte II).
Or cet esprit d'intrigue,qu'elle s'arroge en cette occasion, c'est Figaro qui se flattait d'en être le champion, avec, du reste, l'approbationdes deux femmes qui se l'approprieront.
En effet, Suzanne le reconnaît : « De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère» (acte I, scène 1).
La Comtesse fera de même dans la scène 2 de l'acte II :
«SUZANNE.
- On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue.
FIGARO.
- Deux, trois, quatre à la fois; bien embrouillées, qui se croisent.
J'étais né pour être courtisan.
SUZANNE.
— On dit que c'est un métier si difficile! FIGARO.
— Recevoir, prendre et demander; voilà le secret en trois mots.
LA COMTESSE.
— Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer.
»
Et voilà que l'intrigant Figaro, rossé par Suzanne au dénouement pour avoir douté d'elle — et heureux de s'en tirer àsi bon compte —, se voit taxé de niaiserie par sa future femme :
« FIGARO.
— Bien rosser et garder rancune est aussi par trop féminin! Mais dis-moi donc par quel bonheur je te vois là, quand je te croyais avec lui; et comment cet
habit, qui m'abusait, te montre enfin innocente...
SUZANNE.
— Eh! c'est toi qui es un innocent, de venir te prendre au piège apprêté pour un autre! Est-ce notre faute, à nous, si voulant museler un renard,nous en attrapons deux?»
(acte V, scène 8)
Mais ce n'est pas seulement devant Suzanne (et la Comtesse) que Figaro, piégé, perd comiquement la face, enmême temps, notons-le en passant, que son compère le Comte Almaviva.
Devant Marceline également, Figaro estappelé à justifier sa conduite car ses actes ne concordent pas avec ses paroles.
Ne se croyait-il pas, en effet,affranchi de la jalousie, sentiment qui, selon lui, relève des « impulsions féminines »? Il va même jusqu'à défier toute.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Scène 1 de l’acte IV du Mariage de Figaro: En fait d’amour, vois-tu, trop n’est pas même assez. Beaumarchais
- Phèdre Acte II, Scène V (extrait) HIPPOLYTE Je vois de votre amour l'effet prodigieux.
- « Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. » Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, II, 2. Commentez cette citation.
- "Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, Madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes." Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. Commentez cette citation.
- Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, II, 2. Commentez cette citation.