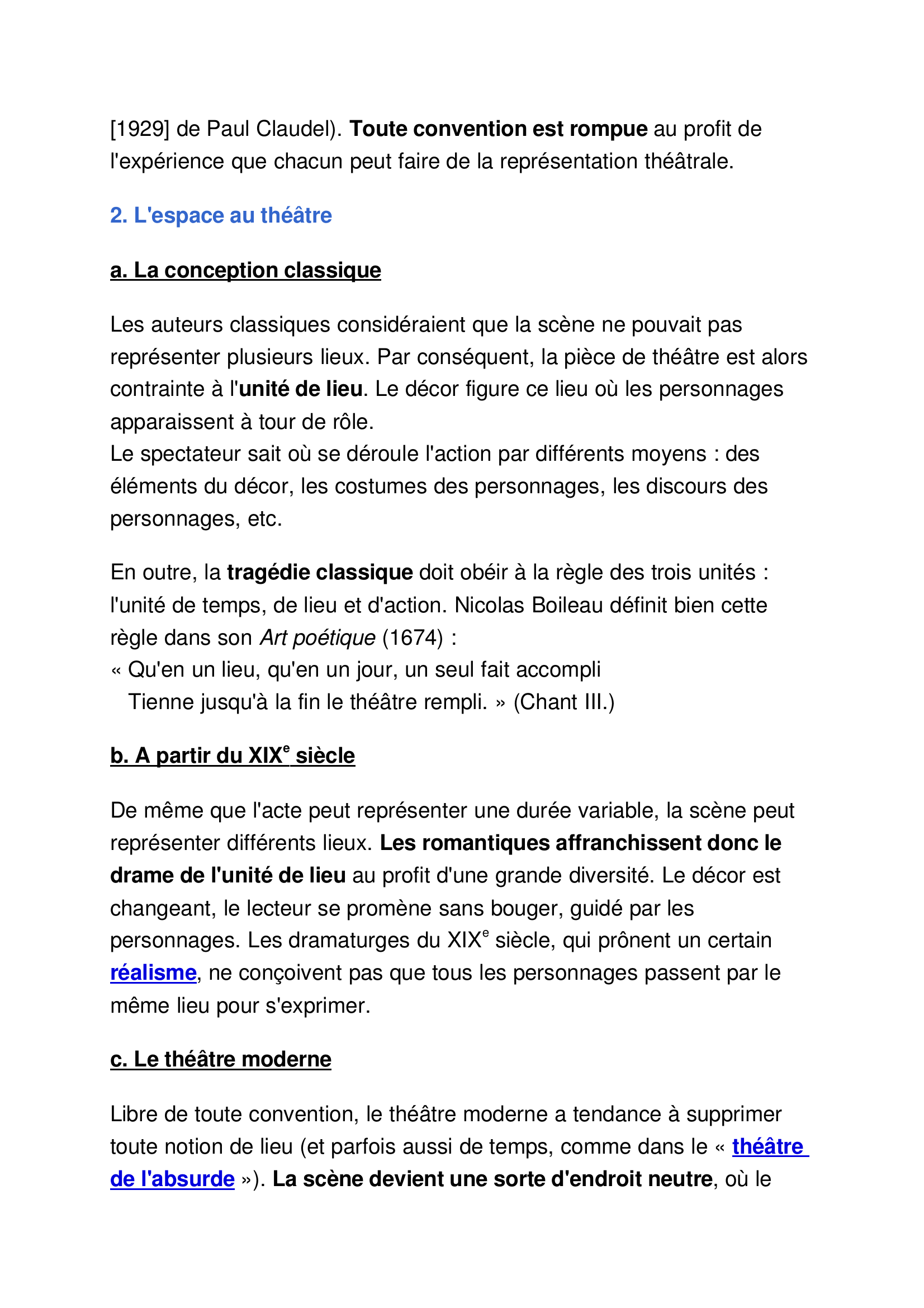Temps & Théâtre
Publié le 12/10/2013

Extrait du document

Le texte dramatique présente de nombreuses spécificités. La plus importante est la représentation théâtrale du texte devant un public. Cette réunion des interprètes et des spectateurs implique une conception particulière de l'espace et du temps. 1. Le temps au théâtre a. La conception classique Il est évident que le temps consacré à la représentation théâtrale ne peut pas totalement se superposer avec le temps du déroulement de l'intrigue. C'est pourquoi les auteurs classiques ont instauré l'unité de temps qui contraint les dramaturges à cadrer l'intrigue en vingt-quatre heures. Les actes représentent les moments essentiels de l'action, les entractes marquent les pauses pendant lesquelles le temps de l'intrigue continue à se dérouler. Des indices permettent alors au spectateur de se rendre compte de l'écoulement du temps (par exemple, l'alternance jour/nuit). b. A partir du XIXe siècle Les romantiques entreprennent de modifier les conventions du théâtre classique qu'ils jugent trop rigides. Ils ne conçoivent pas qu'une action ne dure que vingt-quatre heures. Ils délivrent donc l'action qui dure le temps qui lui convient, sans que le temps de la représentation en soit modifié. c. Le théâtre moderne Au XXe siècle, les dramaturges et les metteurs en scène innovent en superposant totalement le temps de l'action et celui de la représentation (par exemple, en faisant participer activement le public). A l'inverse, ils rompent parfois tout lien avec le temps en mettant en scène des pièces excessivement longues (comme Le Soulier de satin [1929] de Paul Claudel). Toute convention est rompue au profit de l'expérience que chacun peut faire de la représentation théâtrale. 2. L'espace au théâtre a. La conception classique Les auteurs classiques considéraient que la scène ne pouvait pas représenter plusieurs lieux. Par conséquent, la pièce de théâtre est alors contrainte à l'unité de lieu. Le décor figure ce lieu où les personnages apparaissent à tour de rôle. Le spectateur sait où se déroule l'action par diff&e...

«
[1929] de Paul Claudel). Toute convention est rompue au profit de
l'expérience que chacun peut faire de la repr ésentation th éâ trale.
2. L'espace au th
éâ tre
a. La conception classique
Les auteurs classiques consid
éraient que la sc ène ne pouvait pas
repr
ésenter plusieurs lieux. Par cons équent, la pi èce de th éâ tre est alors
contrainte
à l' unit é de lieu . Le d écor figure ce lieu o ù les personnages
apparaissent
à tour de r ôle.
Le spectateur sait o
ù se d éroule l'action par diff érents moyens : des
é
léments du d écor, les costumes des personnages, les discours des
personnages, etc.
En outre, la trag
édie classique doit ob éir à la r ègle des trois unit és :
l'unit
é de temps, de lieu et d'action. Nicolas Boileau d éfinit bien cette
r
ègle dans son Art po étique (1674) :
« Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'
à la fin le th éâ tre rempli.
» (Chant III.) b. A partir du XIX e si ècle De m ême que l'acte peut repr ésenter une dur ée variable, la sc ène peut repr ésenter diff érents lieux. Les romantiques affranchissent donc le drame de l'unit é de lieu au profit d'une grande diversit é. Le d écor est changeant, le lecteur se prom ène sans bouger, guid é par les personnages. Les dramaturges du XIX e si ècle, qui pr ônent un certain r éalisme , ne con çoivent pas que tous les personnages passent par le m ême lieu pour s'exprimer. c. Le th éâ tre moderne Libre de toute convention, le th éâ tre moderne a tendance à supprimer toute notion de lieu (et parfois aussi de temps, comme dans le « th éâ tre de l'absurde »). La sc ène devient une sorte d'endroit neutre , o ù le . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Taine a dit du théâtre de Racine : « Dans ce théâtre, qui ne parle ni de son temps ni de sa vie, je trouve l'histoire de sa vie et de son temps. » Expliquer et discuter ce jugement. ?
- BEJART, Madeleine (1618-1672) Sa famille est connue pour avoir fondé, avec Molière, en 1643, l'Illustre-Théâtre qu'elle dirige un temps.
- En quoi le théâtre expose-t-il des scènes tout à fait fictives et en même temps expose des faits ou idées qui révèlent de la réalité ?
- « Notre volonté est de mettre sur scène la société, la présenter et provoquer vis-à-vis d'elle des regards critiques. C'est une fonction du théâtre. Elle n'est pas nouvelle. Molière, et bien avant lui, Sophocle l'avaient ainsi comprise. Mais dans le même temps, le théâtre doit être un lieu où se libèrent les forces de l'imagination, où s'organise le rêve. Ces deux fonctions ne sont pas contradictoires. »
- En vous référant aux pièces de théâtre que vous avez lues, étudiées, ou vu jouer, dites les réflexions que vous inspirent ces remarques d'un directeur de troupe théâtrale : « Notre volonté est de mettre sur scène la société, la présenter et provoquer vis-à-vis d'elle des regards critiques. C'est une fonction du théâtre. Elle n'est pas nouvelle. Molière l'avait bien compris. Mais dans le même temps, le théâtre doit être un lieu où se libèrent les forces de l'imagination, où s'organise l