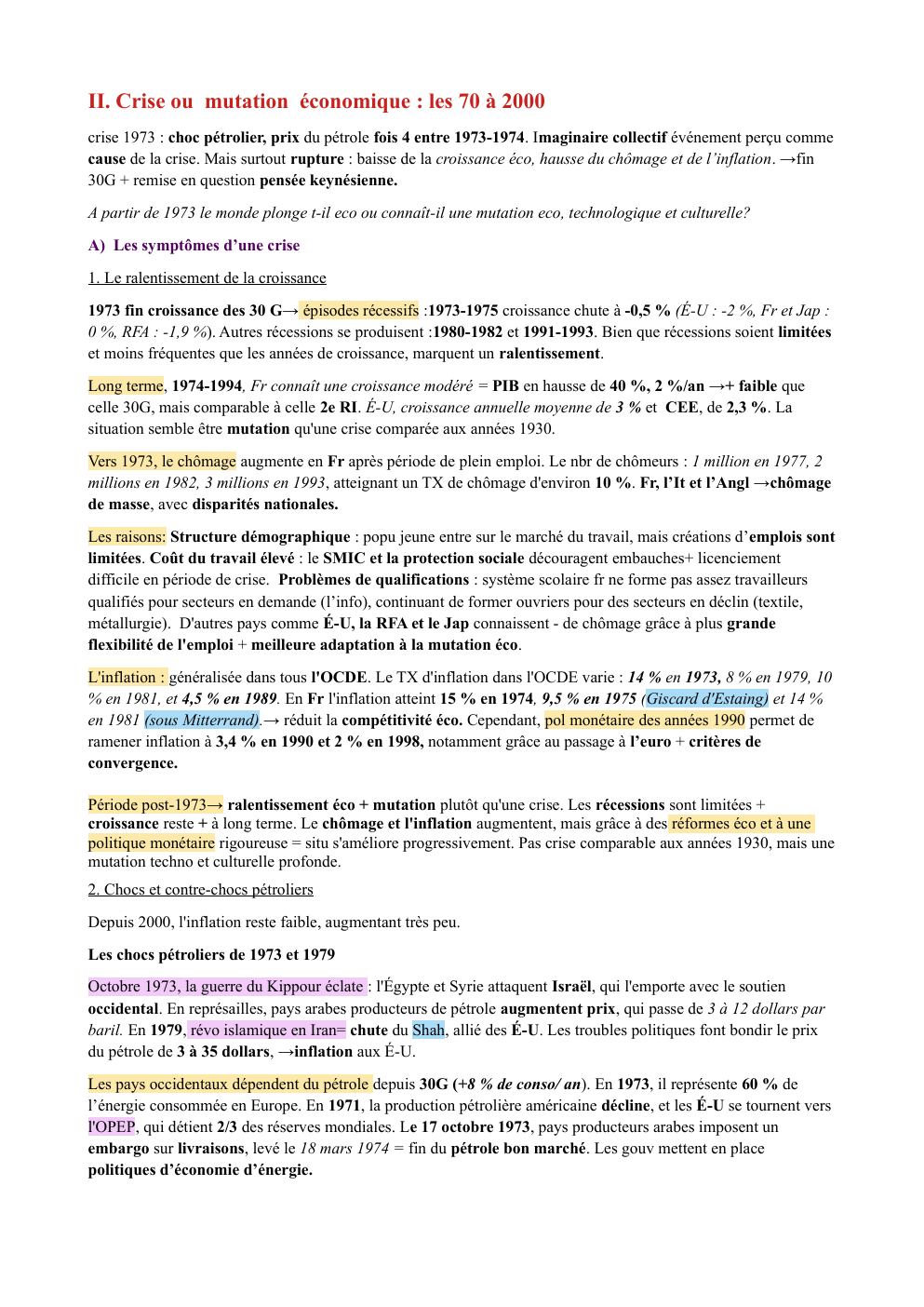Mutation et choc pétrolier
Publié le 15/04/2025
Extrait du document
«
II.
Crise ou mutation économique : les 70 à 2000
crise 1973 : choc pétrolier, prix du pétrole fois 4 entre 1973-1974.
Imaginaire collectif événement perçu comme
cause de la crise.
Mais surtout rupture : baisse de la croissance éco, hausse du chômage et de l’inflation.
→fin
30G + remise en question pensée keynésienne.
A partir de 1973 le monde plonge t-il eco ou connaît-il une mutation eco, technologique et culturelle?
A) Les symptômes d’une crise
1.
Le ralentissement de la croissance
1973 fin croissance des 30 G→ épisodes récessifs :1973-1975 croissance chute à -0,5 % (É-U : -2 %, Fr et Jap :
0 %, RFA : -1,9 %).
Autres récessions se produisent :1980-1982 et 1991-1993.
Bien que récessions soient limitées
et moins fréquentes que les années de croissance, marquent un ralentissement.
Long terme, 1974-1994, Fr connaît une croissance modéré = PIB en hausse de 40 %, 2 %/an →+ faible que
celle 30G, mais comparable à celle 2e RI.
É-U, croissance annuelle moyenne de 3 % et CEE, de 2,3 %.
La
situation semble être mutation qu'une crise comparée aux années 1930.
Vers 1973, le chômage augmente en Fr après période de plein emploi.
Le nbr de chômeurs : 1 million en 1977, 2
millions en 1982, 3 millions en 1993, atteignant un TX de chômage d'environ 10 %.
Fr, l’It et l’Angl →chômage
de masse, avec disparités nationales.
Les raisons: Structure démographique : popu jeune entre sur le marché du travail, mais créations d’emplois sont
limitées.
Coût du travail élevé : le SMIC et la protection sociale découragent embauches+ licenciement
difficile en période de crise.
Problèmes de qualifications : système scolaire fr ne forme pas assez travailleurs
qualifiés pour secteurs en demande (l’info), continuant de former ouvriers pour des secteurs en déclin (textile,
métallurgie).
D'autres pays comme É-U, la RFA et le Jap connaissent - de chômage grâce à plus grande
flexibilité de l'emploi + meilleure adaptation à la mutation éco.
L'inflation : généralisée dans tous l'OCDE.
Le TX d'inflation dans l'OCDE varie : 14 % en 1973, 8 % en 1979, 10
% en 1981, et 4,5 % en 1989.
En Fr l'inflation atteint 15 % en 1974, 9,5 % en 1975 (Giscard d'Estaing) et 14 %
en 1981 (sous Mitterrand).→ réduit la compétitivité éco.
Cependant, pol monétaire des années 1990 permet de
ramener inflation à 3,4 % en 1990 et 2 % en 1998, notamment grâce au passage à l’euro + critères de
convergence.
Période post-1973→ ralentissement éco + mutation plutôt qu'une crise.
Les récessions sont limitées +
croissance reste + à long terme.
Le chômage et l'inflation augmentent, mais grâce à des réformes éco et à une
politique monétaire rigoureuse = situ s'améliore progressivement.
Pas crise comparable aux années 1930, mais une
mutation techno et culturelle profonde.
2.
Chocs et contre-chocs pétroliers
Depuis 2000, l'inflation reste faible, augmentant très peu.
Les chocs pétroliers de 1973 et 1979
Octobre 1973, la guerre du Kippour éclate : l'Égypte et Syrie attaquent Israël, qui l'emporte avec le soutien
occidental.
En représailles, pays arabes producteurs de pétrole augmentent prix, qui passe de 3 à 12 dollars par
baril.
En 1979, révo islamique en Iran= chute du Shah, allié des É-U.
Les troubles politiques font bondir le prix
du pétrole de 3 à 35 dollars, →inflation aux É-U.
Les pays occidentaux dépendent du pétrole depuis 30G (+8 % de conso/ an).
En 1973, il représente 60 % de
l’énergie consommée en Europe.
En 1971, la production pétrolière américaine décline, et les É-U se tournent vers
l'OPEP, qui détient 2/3 des réserves mondiales.
Le 17 octobre 1973, pays producteurs arabes imposent un
embargo sur livraisons, levé le 18 mars 1974 = fin du pétrole bon marché.
Les gouv mettent en place
politiques d’économie d’énergie.
Organisation éco du pétrole : Marché dominé par les "7 Sœurs", compagnies pétrolières maj américaines + anglohollandaises (dont BP) →Imposent prix bas aux États producteurs, avec une part nationale de 50 %.
Des 1960,
3 nouv compagnies rejoignent ce groupe, dont la française CFP (Total).
Pour contrer monopole, les pays
arabes,Venezuela, Mexique créent l'OPEP.
Ils cherchent à augmenter leur part nationale + nationaliser leurs
ressources.
En Libye et en Algérie (1972), le pétrole nationalisé, obligeant les "7 Sœurs" à renégocier.
Contre-choc pétrolier ;1985, Yamani, ministre saoudien du pétrole, augmente la prod pour faire baisser prix et
garder le contrôle de l’OPEP.
La concu des nouveaux producteurs ("Nopep" : Norvège, Gabon, R-U) pousse
Arabie saoudite à réagir = Prix chutent d’environ 20 dollars le baril en 1985-1986.
La part de l'OPEP dans la
prod mondiale passe de 52 % en 1973 à 28 % en 1985.
Certains gisements finissent non rentables (Nigeria, mer
du Nord).
Pour pays occidentaux, cette baisse réduit facture pétrolière + coïncide avec baisse de la valeur $.
Dès 1973, rente pétrolière transforme flux financiers mondiaux.
Les pays de la Triade (Europe occidentale, Amérique du
Nord, Japon), principaux pôles éco, deviennent bénéficiaires de l'afflux de capitaux.
Des flots $ arrivent →ces
régions + sont transformés en investissements divers.
Les pays export utilisation diversifiée de la manne pétrolière : Certains, l'Indonésie et Venezuela, investissent
dans programmes éducatifs, des infra routières + équipements pour améliorer niveau de vie de la population.
Sont confrontés à une croiss démographique importante, tentent d’accompagner cette dynamique par le
développement.
D'autres, comme Nigeria, l'Irak et l'Iran, orientent leur rente →l'urbanisation + dév militaire→souvent
gaspillage des ressources + absence d'amélioration significative du niv de vie, voire catastrophes socio-éco.
Par
ex : Libye de Kadhafi,en 1972 nationalise petrole renversée par Fr et Angl, n'a pas su tirer parti de sa richesse
pétrolière.
L’Algérie adopte un modèle de dév à la soviétique, investissant dans des complexes métallurgiques et
des réformes agricoles, se révèlent peu rentables.
Les petits États pétroliers du Golfe (Qatar, Émirats arabes unis), avec faible popu, connaissent un enrichissement
rapide.
Ils modernisent leurs infra (gratte-ciel, projets urbains) + attirent main-d'œuvre étrangère + place partie de
leur fortune dans investissements occidentaux, à Wall Street et à Londres.
L’Iran connaît une révo islamiste en 1979, qui impose lois religieuses strictes+ consacre partie de la manne
pétrolière au financement de groupes armés.
Arabie saoudite utilise ses revenus pour moderniser ses forces
armées et dév le pays tout en soutenant certaines causes religieuses.
Les conséquences éco mondiales : qlq petits États pétroliers ont su exploiter la rente pour améliorer les conditions
de vie et les infrastructures, mais restent dépendants du secteur tertiaire + peu industrialisés.
D’autres pays ont
mal géré leurs ressources, tombant dans l’« embarras de richesse » : Libye, l'Irak, l'Algérie, où projets indu
lourds pas été rentables.
Le Venezuela, qui a privilégié les pol sociales sans investissements productifs →fragilisé
lorsque le prix du pétrole chute.
1985, la valeur réelle du pétrole est divisée par 8 = endettement de nbr pays exportateurs + ruine éco.
Les pays
non prod, comme l'Inde, subissent également effets de la hausse des prix, grevant leur balance commerciale et
affectant leur développement.
Pour Triade (Amérique du Nord, CEE, Japon), facture pétrolière augmente fortement.
Entre
1972-1981, coût des importations pétrole passe de 1,5 % à 4,5 % du PIB.
La hausse du prix pétrole + $
pénalisent les secteurs les + conso d'énergie (métallurgie, chauffage domestique au mazout, agriculture).
→ la stagflation : l'éco stagne/régresse avec forte inflation, remet en cause équilibres éco + affaiblissant les éco
occidentales.
Bien que choc pétrolier soit facteur déclencheur, n'est pas la cause unique mais un élément
aggravant d'une situ éco déjà fragile.
3.
Épuisement du modèle fordiste
La fin du cercle vertueux fordiste: Après 2GM, la croissance éco a été stimulée par cercle vertueux basé sur les
inno, diffu du taylorisme depuis E.-U., main-d'œuvre abondante +qualifiée (baby-boom et immigration).
→ gains
de productivité, malgré une réduc du temps de travail.
Les profits générés étaient réinvestis dans l'éco ou
redistribués dans salaires.
Cependant, un déséquilibre pouvait apparaître : privilégier investissement risquait
sous-conso, a l’inverse augmentation exces salaires menaçait l'inflation ou perte de compétitivité.
Durant 30G,
un compromis entre investissements/salaires, favorise hausse des revenus +conso, ainsi que gains de produ
soutenus, notamment 1960.
Cependant, s'est essoufflée vers fin des années 1960 et début 1970.
Les facteurs de la rupture : croissance éco continue d’augmenter, mais la conso ralenti en raison d’un TX
d’équipement élevé + demande en baisse.
Parallèlement, les profits entreprises se dégradent, plus après le choc
pétrolier.
Les secteurs (la métallurgie,textile) sont fortement impactés par la hausse des coûts des matières
premières, y compris entreprises n’utilisant pas directement le pétrole car l’augmentation des prix chez les soustraitants.
Les salaires augmentent, sans gains de prod, cause = les mouv sociaux comme Mai 68 en Fr (accords de Grenelle) ou
« automne chaud » de 1969 en It.
→inflation, parfois aggravée par l’indexation des salaires sur l’inflation,(Fr
avec le SMIC).
Les entreprises se retrouvent confrontées à coûts croissants = faillites + licenciements, notamment
dans les secteurs en diffi.
Pour réduire coûts, entreprises investissent dans l'automatisation ou délocalisent=
montée du chômage.
Les éléments amplificateurs de la crise : Les flux financiers privés, peu après guerre, deviennent....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE JAPON (1945-1973) DU CHOC ATOMIQUE AU CHOC PÉTROLIER
- choc pétrolier
- La crise économique de 1974 et le choc pétrolier de 1973 (Histoire)
- Question à réponse courte n° 1 : le premier choc pétrolier (1973) : causes, conséquences
- Le choc pétrolier frappe l'Europe