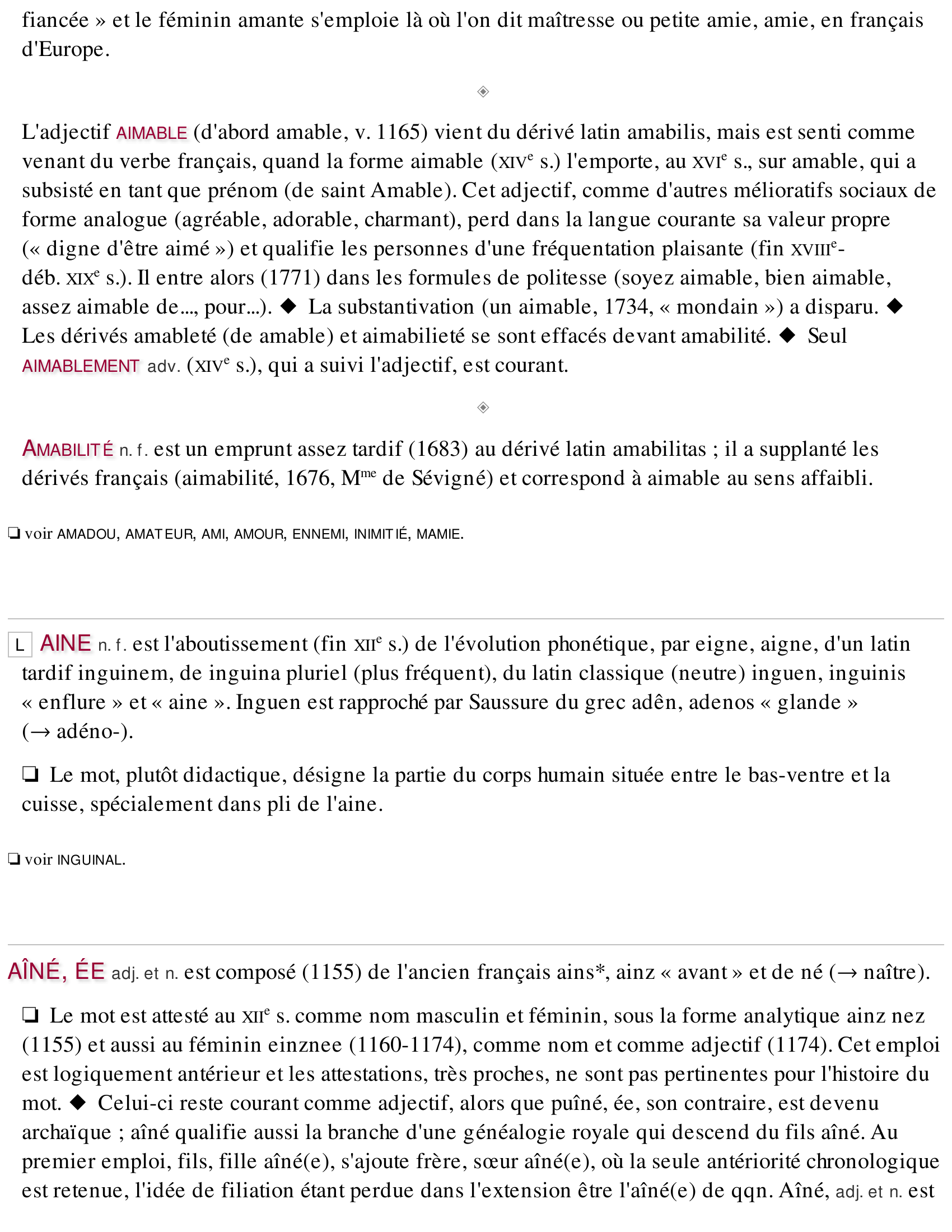AIMER v.
Publié le 29/04/2014

Extrait du document
«
fia n cée » e t l e f é m in in
am an te
s 'e m plo ie l à o ù l 'o n d it
maîtr e sse
o u
peti te a m ie , a m ie ,
e n f ra n çais
d'E uro pe.
◈
L'a d je cti f
AIM ABLE
( d 'a b ord
am ab le ,
v .
1 165) v ie n t d u d ériv é l a ti n
am ab ilis ,
m ais e st s e n ti c o m me
ven an t d u v erb e f ra n çais , q uan d l a f o rm e
aim ab le
(
XIV
e
s .) l 'e m porte , a u
XV I
e
s ., s u r
am ab le ,
q ui a
su bsis té e n ta n t q ue p ré n om ( d e s a in t
Am ab le
).
C et a d je cti f , c o m me d 'a u tr e s m élio ra ti f s s o cia u x d e
fo rm e a n alo g ue
(a g ré ab le , a d ora b le , c harm an t) ,
p erd d an s l a l a n gue c o ura n te s a v ale ur p ro pre
(« d ig ne d 'ê tr e a im é » ) e t q ualif ie l e s p ers o n nes d 'u n e f ré q uen ta ti o n p la is a n te ( fin
XV III
e
-
déb .
XIX
e
s .) .
I l e n tr e a lo rs ( 1 771) d an s l e s f o rm ule s d e p olite sse
(s o yez a im ab le , b ie n a im ab le ,
asse z a im ab le d e..., p our...) .
◆
L a s u bsta n ti v ati o n (
un a im ab le ,
1 734, « m on dain » ) a d is p aru .
◆
Les d ériv és
am ab le té
( d e
am ab le
) e t
aim ab ilie té
s e s o n t e ffa cés d evan t
am ab ilité .
◆
S eul
AIM ABLE M ENT
adv.
(
XIV
e
s .) , q ui a s u iv i l 'a d je cti f , e st c o ura n t.
◈
A MABIL IT É
n.
f .
e st u n e m pru n t a sse z ta rd if ( 1 683) a u d ériv é l a ti n
am ab ilita s ;
i l a s u ppla n té l e s
dériv és f ra n çais (
aim ab ilité ,
1 676, M
me
d e S év ig né) e t c o rre sp on d à
aim ab le
a u s e n s a ffa ib li.
❏
voir
AM AD OU
,
AM AT EU R
,
AM I
,
AM OUR
,
EN NEM I
,
IN IM IT IÉ
,
MAM IE
.
L AIN E
n.
f .
e st l 'a b outi s se m en t ( fin
XII
e
s .) d e l 'é v olu ti o n p ho n éti q ue, p ar
eig ne, a ig ne,
d 'u n l a ti n
ta rd if
in guin em ,
d e
in guin a
p lu rie l ( p lu s f ré q uen t) , d u l a ti n c la ssiq ue ( n eutr e )
in guen , i n guin is
« e n flu re » e t « a in e » .
In guen
e st r a p pro ché p ar S au ssu re d u g re c
ad ên , a d en os
« g la n de »
(→ a d én o-).
❏
L e m ot, p lu tô t d id acti q ue, d ésig ne l a p arti e d u c o rp s h u m ain s itu ée e n tr e l e b as-v en tr e e t l a
cu is se , s p écia le m en t d an s
pli d e l 'a in e.
❏
voir
IN G UIN AL
.
AÎN É
,
ÉE
adj.
e t n .
e st c o m posé ( 1 155) d e l 'a n cie n f ra n çais
ain s* , a in z
« a v an t » e t d e
né
(→ n aîtr e ).
❏
L e m ot e st a tte sté a u
XII
e
s .
c o m me n om m asc u lin e t f é m in in , s o us l a f o rm e a n aly ti q ue
ain z n ez
(1 155) e t a u ssi a u f é m in in
ein zn ee
( 1 160-1 174), c o m me n om e t c o m me a d je cti f ( 1 174).
C et e m plo i
est l o g iq uem en t a n té rie ur e t l e s a tte sta ti o n s, tr è s p ro che s, n e s o n t p as p erti n en te s p our l 'h is to ir e d u
mot.
◆
C elu i- c i r e ste c o ura n t c o m me a d je cti f , a lo rs q ue
puîn é, é e ,
s o n c o n tr a ir e , e st d even u
arc haïq ue ;
aîn é
q ualif ie a u ssi l a b ra n che d 'u n e g én éalo g ie r o yale q ui d esc e n d d u
fils a în é.
A u
pre m ie r e m plo i,
fils , f ille a în é(e ),
s 'a jo ute
frè re , s œ ur a în é(e ),
o ù l a s e ule a n té rio rité c hro n olo g iq ue
est r e te n ue, l 'i d ée d e f ilia ti o n é ta n t p erd ue d an s l 'e xte n sio n
êtr e l 'a în é(e ) d e q qn.
Aîn é,
adj.
e t n .
e st.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’amour et ses techniques : L’Art d’aimer d’Ovide
- Aimer dans Don Juan
- devoir d'aimer
- Aimer ou solitude
- AIMER SANS SAVOIR QUI (résumé & analyse) Lope Félix de Vega Carpio