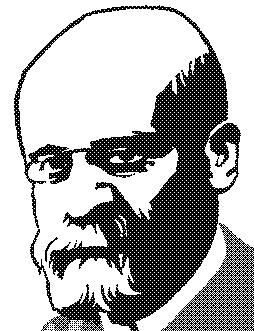DURKHEIM (Émile)
Né à Épinal en 1858 d'une famille de rabbins, il entre en 1879, à l'École normale supérieure où il fait des études de philosophie ; dès
1887, il est nommé à l'université de Bordeaux professeur de pédagogie et de sciences sociales. En 1893, il soutient sa thèse sur la Division du travail social et en 1895, publie les Règles de la méthode sociologique. Il fonde en 1896 l'« Année Sociologique «, et fait paraître l'année suivante son étude sur Le Suicide. Nommé à la
Sorbonne à partir de 1900, son activité essentielle se partage entre son enseignement et la direction de l'« Année Sociologique « ; s'il publie
encorè en 1912 une étude sur Les Formes élémentaires de la vie religieuse, ce sont ses élèves qui, après sa mort, survenue en 1917, éditeront ses cours et ses articles.
<> On considère Durkheim comme le fondateur de la sociologie : il serait le premier à lui avoir donné le statut de science. L'école allemande de Dilthey (1833-1911) et Weber (1864-1920) considérait les sciences humaines comme des « sciences « tout à fait particulières : l'observateur et l'observé étant de même nature,. les phénomènes étudiés sont immédiatement intelligibles, et il s'agit non d'expliquer mais de comprendre. Durkheim, disciple de Comte, propose de considérer les faits sociaux comme des choses. Il ne s'agit pas d'identifier ceux-ci avec les phénomènes naturels comme le fait l'école italienne — Pareto (1848-1923) — et d'expliquer
par exemple le suicide à partir des variations de température. La sociologie doit appliquer la méthode des sciences
positives, c'est-à-dire observer, comparer et expliquer un fait social par un autre fait social : l'expérimentation n'y est pas production de phénomènes répétables, mais étude des
variations corrélatives de certains phénomènes. C'est ainsi qu'en étudiant les taux de suicide, Durkheim montre qu'ils
varient en fonction des milieux sociaux (les protestants se suicident plus que les catholiques, etc.), des divorces, des
crises économiques, etc. On peut concevoir alors que la sociologie naît par l'élaboration de ce nouvel objet que
constituent ce que nous nommons aujourd'hui les corrélations fonctionnelles entre diverses variables.
· Durkheim développe une certaine conception de la société qui est héritée du positivisme et influe profon‑
dément sur ses analyses. Dans son étude sur la division du travail, il montre comment deux types de solidarité peuvent relier les hommes : une solidarité mécanique, fondée sur la similitude qui est de règle dans les sociétés archaïques entre les individus, et une solidarité organique qui résulte de la différenciation des individus qui, au sein des sociétés modernes, occupent des fonctions hétérogènes. Les économistes expliquent le passage de l'une à l'autre forme par la nécessité d'une répartition des tâches en vue de l'accroissement de la production ; mais il faut pour cela une conscience de l'individualité qui ne peut résulter que de la division du travail : c'est le caractère de plus en plus dense des sociétés et leur extension qui brisent progressivement les similitudes, accroissent les différenciations entre les individus,
et provoquerit la division du travail.
Cette explication présente les thèmes fondamentaux de la
sociologie durkheimienne en rapport avec sa conception de la société : c'est la forme des collectivités qui détermine les
attitudes individuelles ; il y a une véritable conscience collective. En faisant de la société une réalité distincte des institutions et des individus, qui ne peuvent exister sans elle, Durkheim donne un prolongement à la sociolâtrie comtienne (1).
1. « Le croyant s'incline devant Dieu, parce que c'est de Dieu qu'il croit tenir l'être, et particulièrement son être mental, son âme. Nous avons des raisons d'éprouver ce sentiment pour la collectivité. «