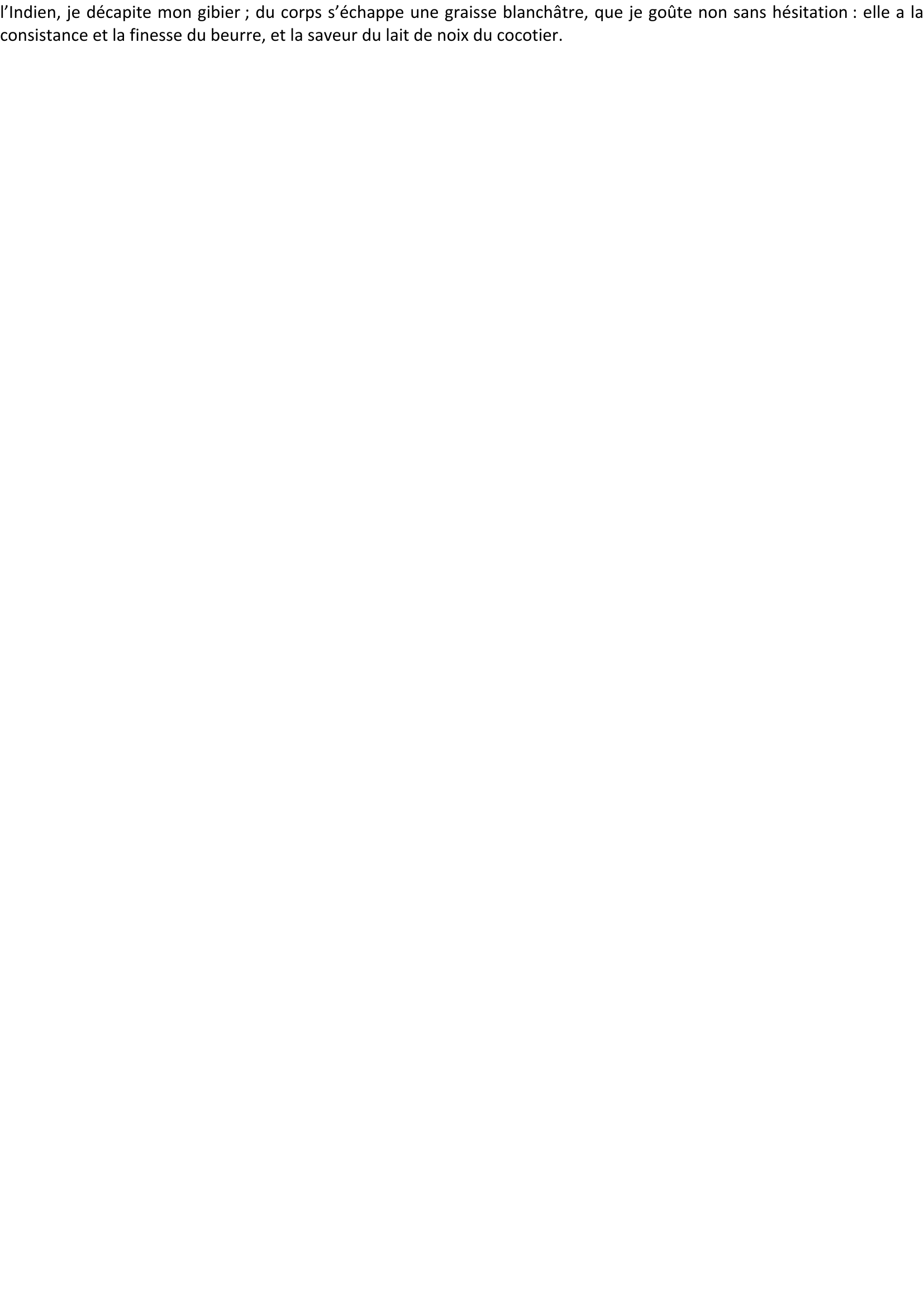faible défense contre le froid glacial à mille mètres d'altitude.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
faible défense contre le froid glacial à mille mètres d'altitude. À cette pièce unique se réduisent les maisons construites par les indigènes ; mais dans celles du gouvernement, une ièce seulement est aussi utilisée. C'est là que se trouve étalée à même le sol toute la richesse de l'Indien, dans un ésordre qui scandalisait nos guides, caboclos du sertão voisin, et où l'on distingue avec peine les objets d'origine résilienne et ceux de fabrication locale. Parmi les premiers, généralement, on trouve hache, couteaux, assiettes d'émail t récipients métalliques, chiffons, aiguille et fil à coudre, parfois quelques bouteilles et même un parapluie. Le mobilier st aussi rudimentaire : quelques tabourets bas, de bois, d'origine guarani, également employés par les caboclos ; paniers de toutes tailles et de tous usages, qui illustrent la technique du « croisé en marqueterie » si fréquente en Amérique du Sud ; tamis à farine, mortier de bois, pilons de bois ou de pierre, quelques poteries, enfin, une quantité rodigieuse de récipients de formes et d'usages divers, confectionnés avec Yabobra, gourde vidée et desséchée. Quelle difficulté pour se procurer ces pauvres objets ! La distribution préalable, à toute la famille, de nos bagues, colliers et broches de verroterie est parfois insuffisante pour établir l'indispensable contact amical. Même l'offre d'une quantité de milreis en disproportion monstrueuse avec l'indigence de l'ustensile laisse le propriétaire indifférent. « Il ne peut pas. » Si l'objet était de sa fabrication il le donnerait volontiers, mais lui-même l'a acquis il y a longtemps d'une vieille femme qui est seule à savoir confectionner ce genre de choses. S'il nous le donne, comment le remplacer ? » La vieille femme 'est, bien entendu, jamais là. Où ? « Il ne sait pas » - geste vague - « dans la forêt... ». D'ailleurs, que valent tous nos milreis pour ce vieil Indien, tremblant de fièvre, à cent kilomètres du plus proche magasin des blancs ? On se sent honteux 'arracher à ces hommes si dépourvus un petit outil dont la perte sera une irréparable diminution... Mais souvent, c'est une autre histoire. Cette Indienne veut-elle me vendre ce pot ? « Certes, elle veut bien. alheureusement il ne lui appartient pas. À qui alors ? Silence. - À son mari ? Non. - À son frère ? Non plus. À son fils ? as davantage. » Il est à la petite-fille. La petite-fille possède inévitablement tous les objets que nous voulons acheter. ous la considérons - elle a trois ou quatre ans - accroupie près du feu, absorbée par la bague que, tout à l'heure, j'ai assée à son doigt. Et ce sont alors, avec la demoiselle, de longues négociations où les parents ne prennent aucune part. Une bague et cinq cents reis la laissent indifférente. Une broche et quatre cents reis la décident. Les Kaingang cultivent un peu la terre, mais la pêche, la chasse et la collecte forment leurs occupations essentielles. Les procédés de pêche sont si pauvrement imités des blancs que leur efficacité doit être faible : une branche souple, un hameçon brésilien fixé par un peu de résine au bout d'un fil, parfois un simple chiffon en guise de filet. La chasse et la collecte règlent cette vie nomade de la forêt, où pendant des semaines les familles disparaissent, où nul ne les a suivies dans leurs retraites secrètes et leurs itinéraires compliqués. Nous avons parfois rencontré leur petite troupe, au détour du sentier, sortie de la forêt pour y disparaître aussitôt ; les hommes en tête, armés de la bodoque, arc servant à projeter des boulettes pour la chasse aux oiseaux, avec, en bandoulière, le carquois de vannerie qui contient les projectiles d'argile séchée. Ensuite les femmes, transportant toute la richesse de la famille dans une hotte suspendue par une écharpe de tissu ou un large bandeau d'écorce prenant appui sur le front. Ainsi voyagent enfants et objets domestiques. Quelques mots échangés, nous retenant les chevaux, eux ralentissant à peine leur allure et la forêt retrouve son silence. Nous savons seulement que la prochaine maison sera - comme tant d'autres - vide. Pour combien de temps ? Cette vie nomade peut durer des jours et des semaines. La saison de la chasse, celle des fruits - jaboticaba, orange et lima - provoquent des déplacements massifs de toute la population. Dans quels abris vivent-ils au fond des bois ? Dans uelles cachettes retrouvent-ils leurs arcs et leurs flèches, dont on ne rencontre que par hasard des exemplaires oubliés dans un coin de maison ? De quelles traditions, rites, croyances renouent-ils les liens ? Le jardinage tient aussi sa place dans cette économie primitive. En pleine forêt, on traverse parfois les défrichements ndigènes. Entre les hautes murailles des arbres, une pauvre verdure occupe quelques dizaines de mètres carrés : ananiers, patates douces, manioc, maïs. Le grain est d'abord séché au feu, puis pilé au mortier par les femmes travaillant eules ou à deux. La farine est mangée directement ou agglomérée avec de la graisse pour former un gâteau compact ; es haricots noirs s'ajoutent à cette nourriture ; le gibier et le porc semi-domestique apportent l'élément carné. La viande st toujours rôtie, enfilée sur une branche au-dessus du feu. Il faut aussi mentionner les koro, larves pâles qui pullulent dans certains troncs d'arbres pourrissants. Les Indiens, blessés par les railleries des blancs, n'avouent plus leur goût pour ces bestioles et se défendent énergiquement de les anger. Il suffit de parcourir la forêt pour voir à terre, sur vingt ou trente mètres de longueur, la trace d'un grand pinheiro abattu par la tempête, déchiqueté, réduit à l'état de fantôme d'arbre. Les chercheurs de koro ont passé par là. t quand on pénètre à l'improviste dans une maison indienne, on peut apercevoir, avant qu'une main rapide ne l'ait issimulée, une coupe toute grouillante de la précieuse friandise. Aussi n'est-ce pas chose facile que d'assister à l'extraction des koro. Nous méditons longuement notre projet, comme des conspirateurs. Un Indien fiévreux, seul dans un village abandonné, semble une proie facile. On lui met la hache dans a main, on le secoue, on le pousse. Peine perdue, il semble tout ignorer de ce que nous voulons de lui. Sera-ce un nouvel chec ? Tant pis ! Nous lançons notre dernier argument : nous voulons manger des koro. On arrive à traîner la victime devant un tronc. Un coup de hache dégage des milliers de canaux creux au plus profond du bois. Dans chacun, un gros nimal de couleur crème, assez semblable au ver à soie. Maintenant il faut s'exécuter. Sous le regard impassible de l'Indien, je décapite mon gibier ; du corps s'échappe une graisse blanchâtre, que je goûte non sans hésitation : elle a la consistance et la finesse du beurre, et la saveur du lait de noix du cocotier. XVIII PANTANAL Après ce baptême, j'étais prêt pour les vraies aventures. L'occasion allait s'en présenter pendant la période des vacances universitaires qui, au Brésil, ont lieu de novembre à mars, c'est-à-dire durant la saison des pluies. Malgré cet nconvénient, je formai le projet de prendre contact avec deux groupes indigènes, l'un fort mal étudié et peut-être déjà ux trois quarts disparu : les Caduveo de la frontière paraguayenne ; l'autre, mieux connu mais encore plein de romesses : les Bororo, dans le Mato Grosso central. De plus, le Musée national de Rio de Janeiro me suggérait d'aller econnaître un site archéologique qui se trouvait sur mon chemin et dont la mention traînait dans les archives sans que ersonne ait eu l'occasion de s'en occuper. Depuis lors, j'ai circulé bien souvent entre São Paulo et le Mato Grosso, tantôt en avion, tantôt en camion, tantôt nfin par le train et le bateau. Ce sont ces derniers moyens de transport que j'ai utilisés en 1935-36 ; en effet, le gisement ont je viens de parler se trouvait au voisinage de la voie ferrée, non loin du point terminal qu'elle atteignait à Porto sperança, sur la rive gauche du Rio Paraguay. Il y a peu à dire de ce lassant voyage ; la compagnie de chemin de fer de la Noroeste vous amenait d'abord à Bauru, en leine zone pionnière ; on y prenait le « nocturne » de Mato Grosso qui traversait le sud de l'État. Au total, trois jours de oyage dans un train chauffé au bois, roulant à vitesse réduite, s'arrêtant souvent et longtemps pour s'approvisionner en ombustible. Les wagons étaient aussi en bois et passablement disjoints : au réveil, on avait le visage recouvert d'une ellicule d'argile durcie, formée par la fine poussière rouge du sertão s'insinuant dans chaque pli et dans chaque pore. Le wagon-restaurant était déjà fidèle au style alimentaire de l'intérieur : viande fraîche ou séchée selon l'occasion, riz et haricots noirs avec, pour absorber le jus, la farinha : pulpe de maïs ou de manioc frais, déshydratée à la chaleur et broyée en poudre grossière ; enfin le sempiternel dessert brésilien, tranche de pâte de coing ou de goyave accompagnée de fromage. À chaque station, des gamins vendaient pour quelques sous aux voyageurs des ananas juteux à pulpe jaune qui procuraient un rafraîchissement providentiel. On entre dans l'État de Mato Grosso peu avant la station de Tres-Lagoas, en traversant le Rio Parana, si vaste que, malgré les pluies déjà commencées, le fond apparaît encore en maints endroits. Ensuite commence le paysage qui me deviendra à la fois familier, insupportable et indispensable pendant mes années de voyage dans l'intérieur, car il caractérise le Brésil central depuis le Parana jusqu'au bassin amazonien : plateaux sans modelé ou faiblement ondulés ; orizons lointains, végétation broussailleuse avec, de temps à autre, des troupeaux de zébus qui se débandent au passage du train. Beaucoup de voyageurs commettent un contresens en traduisant Mato Grosso par « grande forêt » : le mot forêt se rend par le féminin mata, tandis que le masculin exprime l'aspect complémentaire du paysage sud-américain. ato Grosso, c'est donc exactement « grande brousse » ; et nul terme ne pourrait être mieux approprié à cette contrée sauvage et triste, mais dont la monotonie offre quelque chose de grandiose et d'exaltant. Il est vrai que je traduis aussi sertão par brousse. Le terme a une connotation un peu différente. Mato se rapporte à un caractère objectif du paysage : la brousse, dans son contraste avec la forêt ; tandis que sertão se réfère à un aspect ubjectif : le paysage par rapport à l'homme. Le sertão désigne donc la brousse, mais s'opposant aux terres habitées et cultivées : ce sont les régions où l'homme ne possède pas d'installation durable. L'argot colonial fournit peut-être un équivalent exact avec « bled ». Parfois le plateau s'interrompt pour faire place à une vallée boisée, herbeuse, presque riante sous le ciel léger. Entre ampo Grande et Aquidauana, une cassure plus profonde laisse apparaître les falaises flamboyantes de la serra de Maracaju dont les gorges abritent déjà, à Corrientes, un garimpo, c'est-à-dire un centre de chercheurs de diamants. Et voici que tout change. Sitôt passé Aquidauana, on entre dans le pantanal : le plus grand marécage du monde, qui occupe le bassin moyen du Rio Paraguay. Vue d'avion, cette région de rivières serpentant à travers les terres plates donne le spectacle d'arcs et de méandres où stagnent les eaux. Le lit même du fleuve apparaît cerné de courbes pâles, comme si la nature avait hésité avant de lui donner son actuel et temporaire tracé. Au sol, le pantanal devient un paysage de rêve, où les troupeaux de zébus se réfugient comme sur des arches flottantes au sommet des buttes ; tandis que, dans les marais submergés, les bandes de grands oiseaux : flamants, aigrettes, hérons, forment des îles compactes, blanches et roses, moins plumeuses encore que les frondaisons en éventail des palmiers carandá qui sécrètent dans leurs feuilles une précieuse cire, et dont les osquets clairsemés rompent seuls la perspective faussement riante de ce désert aquatique. Le lugubre Porto Esperança, si mal nommé, subsiste dans ma mémoire comme le site le plus bizarre qu'on puisse rouver à la surface du globe, à l'exception peut-être de Fire Island dans l'État de New York, que je me plais maintenant à ui joindre, les deux endroits offrant cette analogie de rassembler les données les plus contradictoires, mais chacun dans ne clé différente. La même absurdité géographique et humaine s'y exprime, ici comique et là sinistre. Swift aurait-il inventé Fire Island ? C'est une flèche de sable dépourvue de végétation, qui s'étend au large de Long sland. Elle est tout en longueur, mais sans largeur : quatre vingts kilomètres dans un sens, deux à trois cents mètres dans 'autre. Du côté de l'océan la mer est libre, mais si violente qu'on n'ose se baigner ; vers le continent, toujours paisible
« l’Indien, jedécapite mongibier ; ducorps s’échappe unegraisse blanchâtre, quejegoûte nonsans hésitation : elleala consistance etlafinesse dubeurre, etlasaveur dulait denoix ducocotier.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FTIMP012 ESPAGNE Superficie : 504 783 km2 Point culminant : Mulhacen 3 481 m Pays de forte altitude moyenne (660 mètres), l'Espagne est le premier vignoble d'Europe et le troisième producteur mondial de vin.
- Le droit est-il l'instrument du fort ou la défense du faible ?
- C.E. 29 juill. 1950, COMITÉ DE DÉFENSE DES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES DES EXPERTS-COMPTABLES BREVETÉS PAR L'ÉTAT, Rec. 492
- C. E. 28 mai 1971, MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT C. FÉDÉRATION DE DÉFENSE DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET ACTUELLEMENT DÉNOMMÉ «VILLENOUVELLE EST», Rec. 409, concl. Braibant.
- Comment étudier les propriétés sonores d'un groupe de violons pacés à environ 5 mètres d'un sonomètre